Alessandro Baricco,
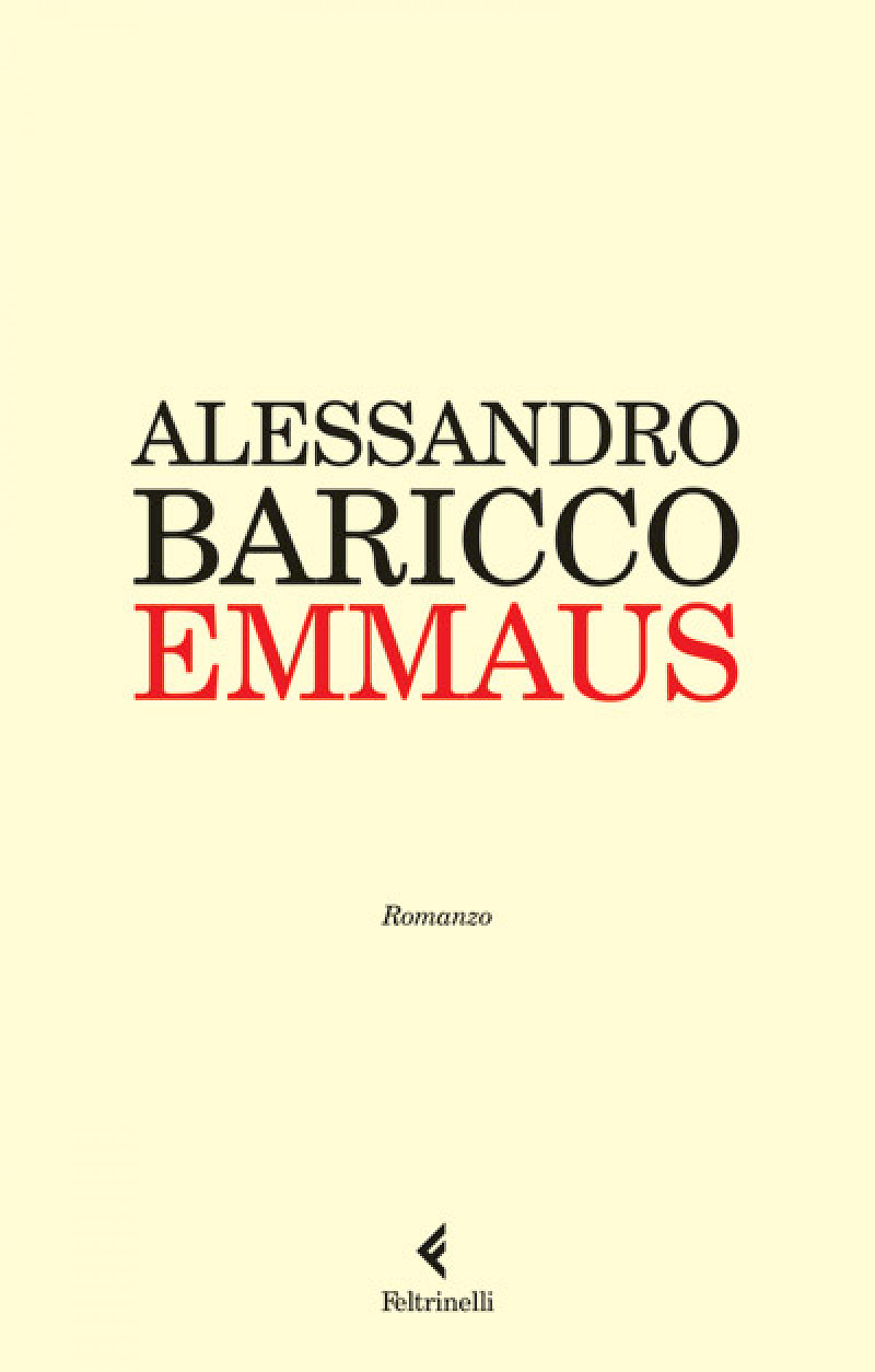
Alessandro Baricco, le formidable auteur de Soie et de City , raconte le basculement progressif de quatre adolescents catholiques, fascinés par la beauté évidente et tragique d’Andre, jeune femme fascinante qui leur ouvre les portes de la vie comme celles de la mort. Emmaüs s’impose comme un roman initiatique lumineux.
Ils sont quatre. Bobby, Luca, le Saint et le narrateur. Ils ont la foi, la vraie, celle qui rend fort, absolu, certain. Ils sont quatre. Ils jouent de la guitare à l’église, rendent service à l’hôpital, s’occupent des « larves », les vieillards, changent leur poche d’urine, tentent de les faire rire. Ils prennent les choses très au sérieux, trop au sérieux. Ils pensent suivre les enseignements des adultes, sans réaliser qu’ils sont déjà loin, bien plus loin que leurs parents, qu’ils cheminent vers le point où se déchire le voile, où se perdent l’innocence, l’assurance, la confiance simple en toutes choses. Au placard, les secours de la religion.
On croit, et il ne semble pas y avoir d’autre possibilité. Néanmoins, on croit avec férocité, et avidité, non dans une foi tranquille, mais dans une passion incontrôlée, comme un besoin physique, une nécessité. C’est le germe de quelque folie — l’ombre évidente d’un orage à l’horizon. Mais pères et mères ne lisent pas la bourrasque qui approche, au contraire ils ne lisent que le faux message d’un doux consentement aux orientations de la famille : ainsi ils nous laissent prendre le large.
Tout d’abord ils ne voient rien venir. Ils pensent leur trajectoire toute tracée, rectiligne et simple, dans le sillage de celle du Christ. Pas de sexe avant le mariage, seulement de longs attouchements en douce, dans la maison de leurs parents. Survient Andre, jeune femme incandescente, intangible, objet de tous les ragots et de fantasmes inavoués. Ils n’ont d’yeux que pour elle, tandis qu’elle ignore jusqu’à leurs prénoms. C’est dans le bruissement des salons et dans le brouhaha des bars qu’ils apprennent son histoire, qu’ils la contemplent en coin. Elle semble appartenir à un autre univers, irrémédiablement séparé du leur — et pas seulement pour une question de classe, de privilèges. C’est aussi, c’est surtout sa sexualité affichée, désinvolte, sa façon de regarder la mort en face, son détachement spirituel, métaphysique, qui la place hors de portée et attise le désir des garçons.
Nous l’avions vue d’autres fois, passer simplement, lumineuse dans le sillon de son élégante apparition, derrière de grandes lunettes sombres. Des sacs de boutiques de mode pendus à son bras plié en V, comme les Françaises dans les films. Elles ont la main relevée et la maintiennent en l’air, paume vers le ciel, déployée, attendant que quelqu’un y dépose un objet délicat, un fruit par exemple.
Les premiers temps, ils parlent aux adultes, se targuent de savoir que dire, que faire, puis soudain ils ne savent plus. Un incident survient, en entraîne un autre, jusqu’à ce que cette spirale implacable fasse vaciller la lumière de la foi. C’est l’adieu à la normalité ennuyeuse et confortable de leur existence bigote et protégée. La bourrasque s’est levée et, peu à peu, tous les quatre empruntent des chemins différents : l’un gravit la montagne malgré l’orage, l’autre fait demi-tour, dévale la pente. Le sens éclate, les certitudes roulent sous les pierres du sentier.
Il voulait qu’elle sache pourquoi nous croyions, et en quoi. Il devait lui dire qu’il existait une autre manière d’être au monde, et que nous pensions que c’était là le chemin à suivre, la vérité et la vie. Il dit que sans le vertige des cieux il ne restait que la terre, soit bien peu. Il dit que chaque homme portait en lui l’espoir d’un sens plus élevé et plus noble des choses, qu’on nous avait appris que cette espérance devenait certitude dans la pleine lumière de la révélation, et devoir quotidien dans la pénombre de notre vie. Ainsi nous travaillons à l’instauration du Règne, dit-il […]
Traduit de l’italien par Lise Caillat, Baricco écrit dans une langue précise, incisive, au plus près des yeux écarquillés de ces gamins qui découvrent le monde à travers la nudité enfin révélée du corps d’une femme, sur scène, le temps d’un improbable spectacle. Corps pris dans un mouvement sans recherche de sens, corps qui danse non pas en quête de beauté mais pour le simple fait d’être là, d’être vrai. C’est cette découverte brutale, fébrile, brûlante de la vérité, d’une autre vérité que celle de l’Église, qui incarne l’expérience fondatrice du narrateur et de ses amis. Expérience tragique, pour eux qui pensaient que le tragique était l’apanage d’une classe sociale supérieure — celle d’Andre et de sa famille —, le privilège des nantis et des aristocrates. Il n’en est rien, finalement.
Alors qu’en ce qui nous concerne — il conviendrait de dire que le tragique, nous ne pouvons nous le permettre, et peut-être qu’un destin non plus —, nos pères et nos mères diraient que nous ne pouvons nous le permettre. Nous avons donc des tantes qui passent leur vie en fauteuil roulant suite à des attaques d’apoplexie répétées — elles bavent poliment et regardent la télévision. Pendant ce temps, dans leurs familles à eux, des grands-pères en complet signé se balancent, tragiques, sous des poutres auxquelles ils se sont pendus après plusieurs échecs financiers.
Les lieux où tout se passe : il s’agit de Turin, probablement — la ville de l’enfance de Baricco. Une enfance empreinte de religiosité, de messes, de tours à bicyclette. L’auteur ne nomme cependant pas le cadre — le réalisme ne l’intéresse pas, pas plus que l’autobiographique. Ce cadre ne sert qu’à décrire le monde dans lequel évoluent les héros du roman : un monde où l’on éteint la lumière en quittant la pièce, où les fauteuils du salon sont recouverts de cellophane, et les balcons protégés de la poussière des avenues par d’immuables stores verts. Un monde figé, un monde petit-bourgeois où la normalité règne en maître, tout autant que la foi. Mais quand celle-ci se perd, en même temps qu’un regard, derrière la vitre d’une voiture :
C’était bel et bien une pipe, dit ensuite Bobby, qui connaissait la chose — le seul d’entre nous qui savait, vraiment, ce que c’était. Il avait eu une petite amie qui faisait ça. Alors il confirma que c’était une pipe, aucun doute là-dessus. Nous continuâmes à marcher en silence, et il était clair que chacun de nous essayait de remettre les choses en perspective, pour visualiser plus précisément ce qui s’était passé derrière la portière de la voiture.
L’affection est présente, l’humour également. À travers la quête progressive et involontaire d’un autre milieu, si proche et qui leur paraissait pourtant inatteignable, inavouable : celui d’Andre, celui des bars, des prostituées — un univers nocturne au sein duquel la ville prend un autre visage et leur offre soudain une liberté dont ils n’osaient pas rêver. Une liberté inconditionnelle et effrayante.
Il faut vaincre une bonne dose de dégoût, face à la saleté, aux odeurs, et autres détails — pourtant nous en sommes capables, et nous en retirons en échange une chose difficile à exprimer — comme une certitude, la consistance pierreuse d’une certitude. Nous sortons dans l’obscurité plus forts, et en apparence plus vrais. Cette obscurité qui chaque soir engloutit Andre et ses aventures dissolues, bien qu’à d’autres latitudes de l’existence, arctiques, extrêmes. Aussi absurde que cela puisse être, nous avons les mêmes ténèbres, tous.
Au commencement de la lecture, une vague appréhension : et si Baricco avait choisi de nous embarquer dans une histoire de culs-bénis au lourd parfum d’encens ? Ce serait bien mal le connaître : c’est un beau roman initiatique qu’il nous offre ; une histoire prise entre le calme et la tempête ; le récit des yeux qui s’ouvrent, de la vie qui se cueille à pleines dents. La lumière jaillit, les corps se donnent, avant de tomber des balcons. On en ressort lucide, avec au ventre une joie secrète, profonde — comme d’une confession ?
Cet article est précédemment paru dans la revue Indications n o 397.