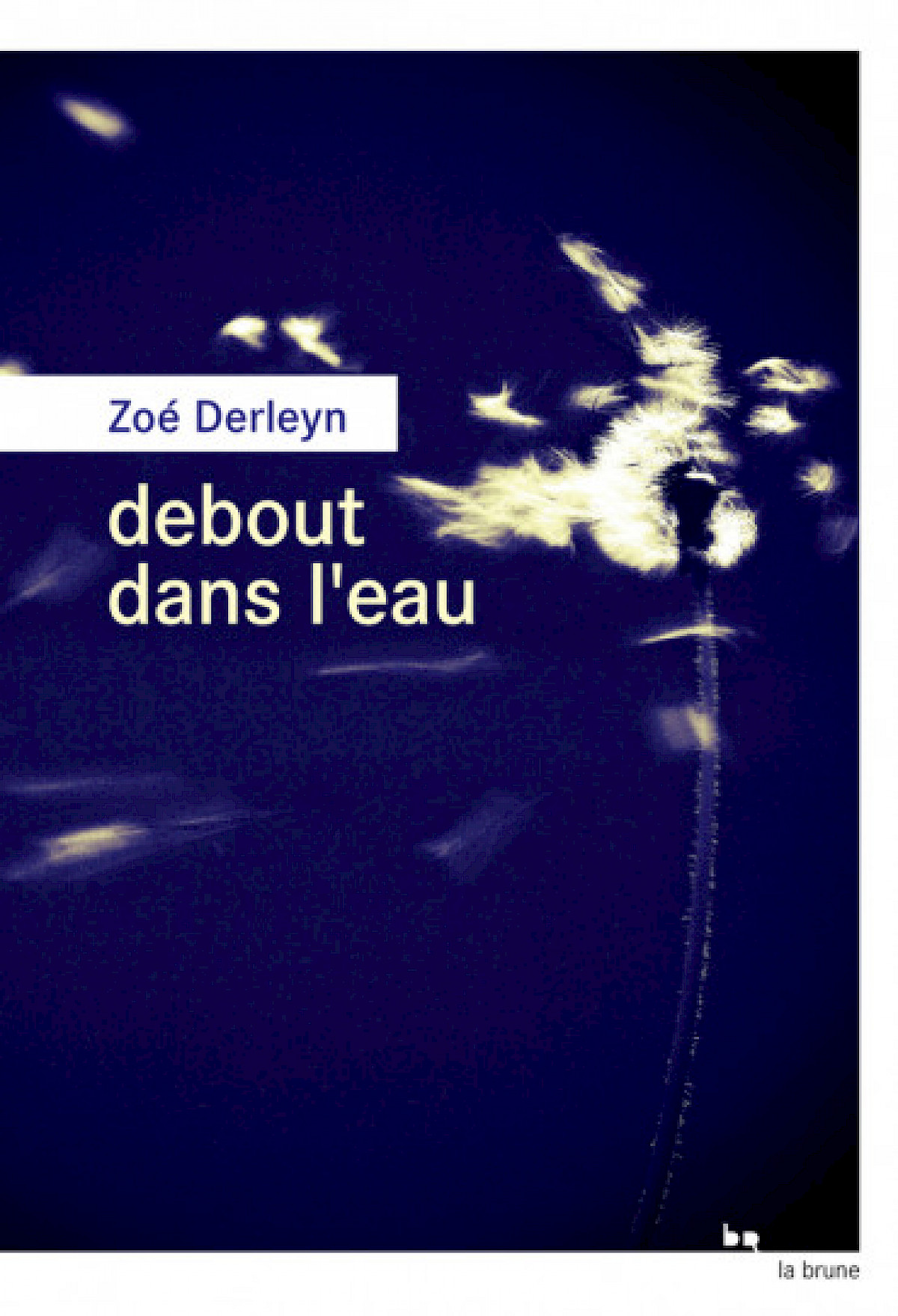
Avec Debout dans l’eau , Zoé Derleyn signe son premier roman où la nature s’érige en protectrice d’une enfant dont le monde vole en éclats. Le récit explore avec pudeur les liens qui se tissent silencieusement entre des êtres.
Dehors, un étang ; dedans, un grand-père qui se meurt. Dans Debout dans l’eau, l’histoire nous est contée par une voix, celle d’une petite fille de onze ans, bientôt douze, dont les repères sont bouleversés par la mort qui s’est invitée dans son quotidien. En effet, son grand-père s’éteint à petit feu dans la chambre de la maison de campagne qui abrite la petite depuis que sa mère l’a abandonnée, à l’âge de trois ans. Dans ce premier roman lumineux, publié aux éditions Le Rouergue, Zoé Derleyn dresse les contours d’une nature refuge, et aborde avec poésie la force des liens de filiation qui s’expriment au-delà des silences.
L’étang-refuge
Le roman s’ouvre sur une scène saisissante de couleurs et de sensations : la petite baigne dans l’étang avec lequel elle a d’ores et déjà fusionné, la nature est son refuge ; l’élément liquide, sa maison :
« Debout, de l’eau jusqu’à la taille, je suis capable de rester immobile dans l’étang très longtemps. Mes pieds disparaissent peu à peu dans la vase. À travers le reflet de mon maillot rouge, j’aperçois mes jambes, tronquées aux chevilles. Je laisse les poissons s’approcher de moi jusqu’à ce qu’ils m’embrassent les mollets, les genoux, les cuisses. Je ne bouge pas, j’oscille légèrement, je respire au rythme de l’eau, je fais partie de l’étang. »
Cet étang, qui apparaît pratiquement comme une entité douée de vie et de volonté (« l’étang s’enroule autour de la maison dans une étreinte tiède »), incarne dans le roman un espace tout à la fois fascinant et effrayant. Il est d’abord le décor des fantasmes d’une enfant pour qui la solitude déploie un espace de création de fictions réconfortantes : l’étendue d’eau devient alors un espace de jeu, de compétition même, face à un public imaginaire. Cette appropriation du lieu par la narratrice la rend ainsi apte à capter toutes les variations olfactives, chromatiques et sensorielles de son espace :
« [...] l’odeur des berges est douceâtre, collante. Déjections d’oies et herbe humide échauffées par le soleil. L’odeur à fleur d’eau est celle de la pluie, du ruissellement, l’odeur d’une brise qui se propage depuis les peupliers, glisse le long des branches des saules pour venir rider la surface sombre de l’étang. »
Et même, lorsque réveillée au milieu de la nuit par un grand-père autoritaire et en colère pour une barque non-amarrée, la forçant alors à affronter cette fois une masse noire, froide et sans limite, la petite apprivoise l’espace et le fait sien. Plus tard, l’étang se révèle le catalyseur d’une séquence réaliste magique au cours de laquelle la narratrice voit une baleine s’ébrouer à la surface de l’eau, révélant à nouveau la potentialité créatrice du lieu.
À la recherche de l’atemporalité
Nimbé de cette aura magique et protectrice, l’étang semble évoluer en dehors du temps aux yeux de la narratrice, contrairement au reste de son environnement, devenu insécurisant depuis que le grand-père habite une des chambres de la maison, dans l’attente de l’ultime voyage. Et pourtant, la narratrice s’obstine à vouloir figer le temps dans ce réel devenu chaos :
« Je sais bien qu’il va mourir. Bientôt. Je sais bien que sans l’oxygène de la machine, il serait déjà mort. Mais j’ai du mal à croire que cela va réellement se produire. J’ai l’impression que je pourrais rester assise là, sur son lit, éternellement. Il ne va pas mourir maintenant. Ni maintenant ni maintenant. »
Ainsi, lorsqu’une nouvelle infirmière arrive à la maison pour s’occuper de son grand-père, ou lorsqu’un jeune homme est engagé pour s’occuper du jardin, la jeune fille est submergée par des émotions qu’elle ne parvient pas à identifier. Là où le langage se fait précis, vivant et sensoriel dans le refuge du jardin et de la solitude, en dehors, ce n’est que silence pour la narratrice qui peine à identifier ses émotions, distinguant à peine la colère de l’émoi face à l’irruption d’une nouvelle présence masculine au milieu d’un univers féminin, figure ambivalente, perçue comme une menace, mais investie des fantasmes nocturnes pré-adolescents. Le ressenti ne se verbalise alors pratiquement jamais, tout est filtré par le regard, ou refusé à l’entendement sauf lorsqu’une question précise et directe est adressée spontanément à la grand-mère de la narratrice :
« − Tu crois qu’elle va venir ?
Elle hausse les épaules, prétend ne pas savoir de qui je parle.
− Qui ?
− Elle. Maman. Tu crois qu’elle va venir ?
Ma grand-mère pèle une carotte comme si elle voulait la punir . »
C’est là un des rares instants où la voix de la narratrice est perçue directement par le lecteur pour révéler de manière crue l’absence d’une mère.
Une parenté complexe
Le roman soulève ainsi la question de la parenté, pas forcément choisie ni même consciente. Ici, elle s’exprime dans les silences et surtout dans l’absence d’un être autrefois craint, évoqué tantôt par des souvenirs qui dressent le portrait d’un homme froid, obstiné et autoritaire, tantôt dans un présent désormais douloureux puisque le grand-père n’est plus qu’une ombre pesant sur un quotidien bouleversé. Et pourtant, même si elle n’est pas saisie par l’enfant-narratrice, la ressemblance s’établit au fil des pages, se concrétisant dans les goût de la petite, son caractère, son attitude face au jardin, dont elle prend soin comme d’un héritage précieux.
Le roman de Zoé Derleyn se lit avec douceur et mélancolie. Le style sobre et poétique confère au récit une force évocatrice dont on se délecte au fil des pages.