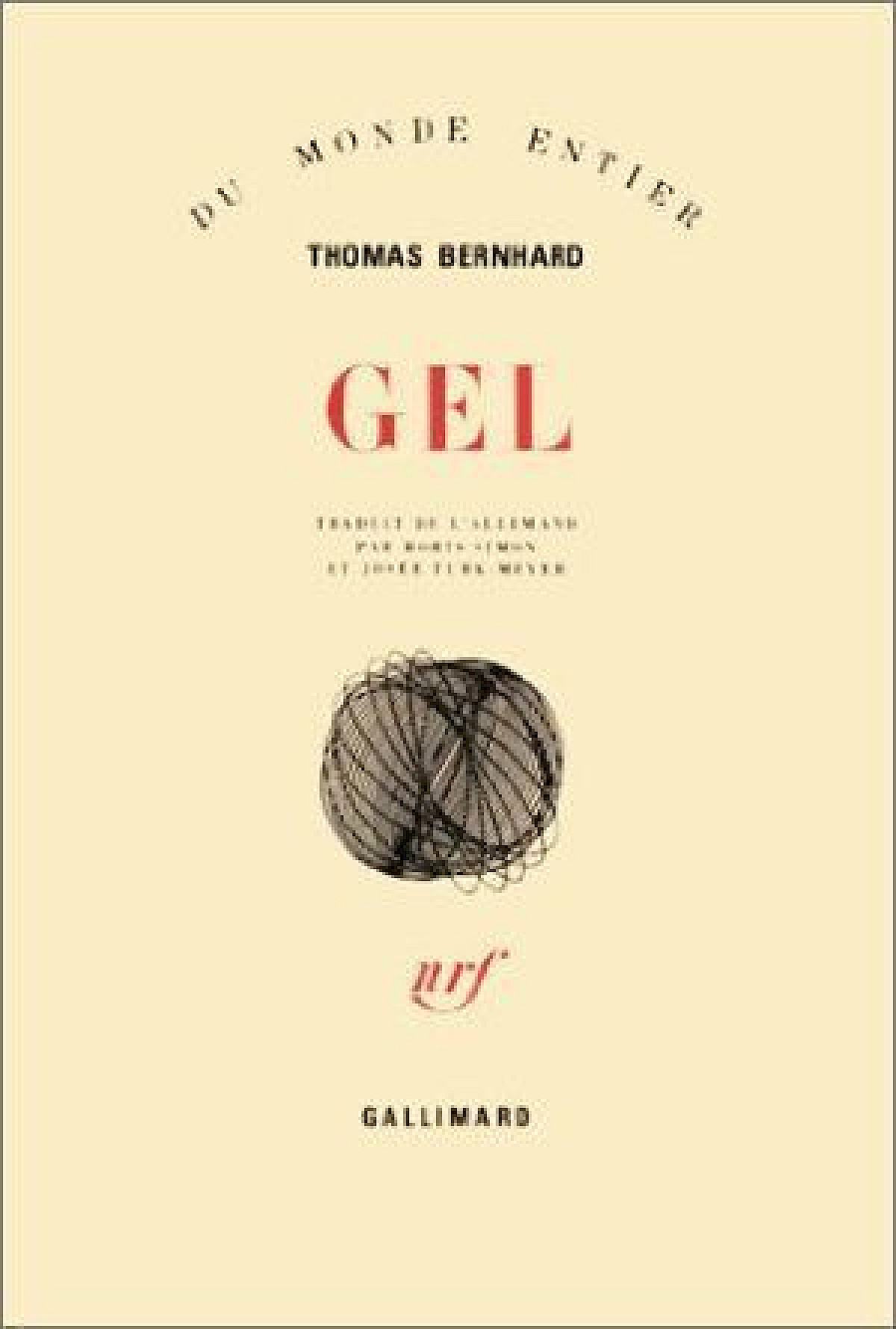
Entre les pages
Entre les pages
de Gel de Thomas Bernhard
se cache un profond désir
qu’arrive l’été,
comme un brûlant appel
à la convalescence…
La vie, c’est comme une forêt où, toujours, on découvre des poteaux indicateurs et des repères, jusqu’au moment où on n’en rencontre plus. Et la forêt est infinie et la faim ne cesse qu’avec la mort. Et toujours on avance dans des couloirs d’où l’on ne peut jeter un regard à l’extérieur. Même l’univers est trop étroit en certains cas. Mais je refuse d’indiquer à qui les ignore les chemins qui mènent au point où j’en suis à présent. Je travaille avec mes conceptions durement arrachées au chaos, par moi seul.

Oh, il y a de l’ironie sans doute à parler d’un livre intitulé de la sorte en début d’été : Gel… Un amour de la contradiction en tout cas. Comme une révolte contre la nature. L’intelligence est plus cruelle que l’animalité de notre condition. Pour vous dire, sur la couverture du mon exemplaire, (celui d’un ami en fait), j’ai noté un sous-titre de mon cru : Notes sur le drame de l’intelligence … ou de la bêtise ?, et c’est bien de ça qu’il s’agit. Dans l’étrange théâtre de ce cher Thomas Bernhard, il n’y a que deux protagonistes : le maître ; le disciple. Celui qui parle ; celui qui écoute. L’un, qui vit ; l’autre, qui observe. Sauf le climat, c’est à peu prêt tout comme intrigue. Le climat, comme un baromètre de l’âme, c’est celui de la folie. Une folie furieuse, un delirium tremens. Folie puisque celui qui éduque ‒ ici le Peintre, Strauch, le Maître ‒ n’a strictement rien à dire, sinon peut-être l’absurdité d’un monde peuplé de gens mutilés . Absurdité totale, complète, sans rémission ; une espèce d’absurdité parfaite ; comme une œuvre d’art avec laquelle l’homme ne parviendra jamais à rivaliser.
Le langage dans lequel s’exprime le maître touche à un délire sans limite, dont le seul et unique aboutissement logique est la mort – par crime, suicide, ou divers accidents. Vite, cette hallucination verbale touche par effet de contagion le compagnon d’infortune qui avait pour mission, au départ, de l’observer, mais dont les notes sont maintenant toutes envenimées. Le fatras d’opinions, d’idées, de phrases, constitue un véritable poison humecté par son objet d’étude l’empêchant de sortir la tête du courant d’eau glacée dans lequel il se sent peu à peu couler. Ce sont vingt-sept jours d’une extériorité impossible ; cauchemar d’ethnologue pour une observation qui ne sait plus où elle va.
Avec son sans-gêne habituel, il s’installa dans le vestibule et me lut à haute voix un passage de son Pascal. « Tout tourne, dit-il, toujours autour du malheur, du malheur intégral », et je ne compris pas ce qu’il voulait dire, « toujours autour d’un seul et unique acte de violence. » Il dit : « Faire entrer en ligne de compte ce qui tue. » Et : « La mort rend tout infâme. Je pars pour descendre dans quelque agglomération de pensées, et j’interromps mon voyage, car le but que je me suis posé n’admet pas, ne peut admettre une arrivée.
Avec ça, le décor du drame est toujours identique, cette campagne autrichienne, lugubre, terrible, sans issue. Un village de haute montage proprement haïssable en tous points. D’une stricte laideur. D’une laideur pure et simple. Tout comme, du reste, les gens qui l’habitent. En effet, les seconds rôles de cette pièce sont tenus par des individus de la race d’un fossoyeur, d’une aubergiste, d’un ingénieur ou d’un boucher, race d’ouvriers ou de curés, de subordonnés : d’esclaves. Des fonctions comme des masques de la dépossession, de l’obéissance. Histoire de tirer un trait, une fois pour toute, sur monde du travail à l’ère du capitalisme totalitaire : servitude du corps ; avilissement des âmes.
De cette espèce de servitude, de ce profond avilissement de la servitude, de cette servitude sans fond où le plus asservi à son tour, comme ces moujiks que nous dépeint Gorki dans ses immortelles souvenirs d’enfance, et qui se jugeraient assez heureux s’ils pouvaient réussir à rosser chaque jour leur femme sans la tuer, afin de pouvoir recommencer le lendemain.
Constante lâcheté, veulerie, couardise : la servitude bestiale de la fourmilière. Les plus bas instincts circulant à l’air libre sous un ciel d’apocalypse. Les plus froids calculs côtoyant sans remords des intérêts égoïstes pourris jusqu’à la moelle, la mesquinerie primaire, la lutte sans merci pour la survie de la matière humaine en voie de décomposition. Ce tableau cauchemardesque de la misère, de la déchéance humaine, est analysé en détail par ce spécialiste de l’effroi qu’est le héros de Bernhard, le peintre Strauch. Condamné à une terrifiante lucidité, voici l’incarnation sur terre de l’esprit de destruction, c’est le nihilisme incarné. Un pessimiste de génie… Un authentique martyr de la pensée critique qui veut se maintenir coûte que coûte à son point culminant, comme au bord d’un précipice. Seule la souffrance endurée toute une vie est à même de conduire à cet état infernale, clairvoyance extrême qui ne laisse rien en place : encore un pas et c’est la disparition… Cette sorte de terrorisme de la vérité à tout prix qu’on ne lit que chez un Pascal ou chez un Schopenhauer, rayons d’un soleil noir desquels on préfère généralement se tenir à distance, tellement ses brûlures ne pardonne pas.
« Au commencement est la fin » : cette phrase contient selon lui la raison originelle de toute chose comme celle-ci : une table est aussi une fenêtre ; et une fenêtre est aussi la femme qui est debout devant, un ruisseau est à la fois la montagne qui s’y reflète, une ville est aussi l’air qui flotte au-dessus de cette ville… Ainsi, enlacé sur lui-même, englouti en lui-même, l’homme est perdu… Des issues ? Pas de réponse…
Inutile d’affirmer que ce livre, ainsi que, d’une certaine manière, l’œuvre toute entière de Thomas Bernhard, n’est qu’une métaphore, ou une mise en abyme de la littérature. De ce dédoublement de la parole qu’est le lieu de l’écriture, et qui n’est pourtant pas un lieu mais une question qui marche en boucle à travers le temps, un dialogue avec le silence. Désertique silence où se cherchent des visages avec qui communiquer, des interlocuteurs, et, sinon des amis, des opposants ou des contradicteurs, des âmes errants dans un vide insoutenable, peuplant une éternelle absence.
Ce qui fascine à ce point dans les récits de Bernard, c’est cette possession despotique, cette espèce de rage bourdonnante qui s’empare de vous à mesure que la lecture se fait, comme l’écho d’un écho. Ce n’est pas que de l’exaltation ; ce n’est pas que de l’effroi. C’est un exil lointain. Mais condamné à l’immobilité. Une errance qui n’avance pas, qui reste au pied du mur… Cette existence retranchée laisse voir de manière fulgurante ce qu’il en est de la liberté humaine. Elle est une sorte d’impasse absolue, un seuil invisible à franchir pour arracher quelque chose dans ce vertigineux abîme de l’esprit, et le surmonter. Nous sommes et resterons toujours ce jeune étudiant en médecine au bord du gouffre ; et ce peintre en proie au ressassement infini. Notre enquête à leur côté n’est rien d’autre qu’une bagarre pour ne pas crever de froid dans cet univers glacé qu’est le monde.
On apprend ainsi peu à peu à marcher avec grâce même dans les sentiers étroits qui passent comme des ponts au-dessus d’effrayants précipices, et l’on remporte comme butin la plus extrême souplesse de mouvement.
Entre le pages de Gel se cache un profond désir qu’arrive l’été, comme un brûlant appel à la convalescence… Je m’exerce en conséquence à cette vie hors d’elle-même. De cette poésie, mes pupilles sont devenues ses amoureuses pupilles.