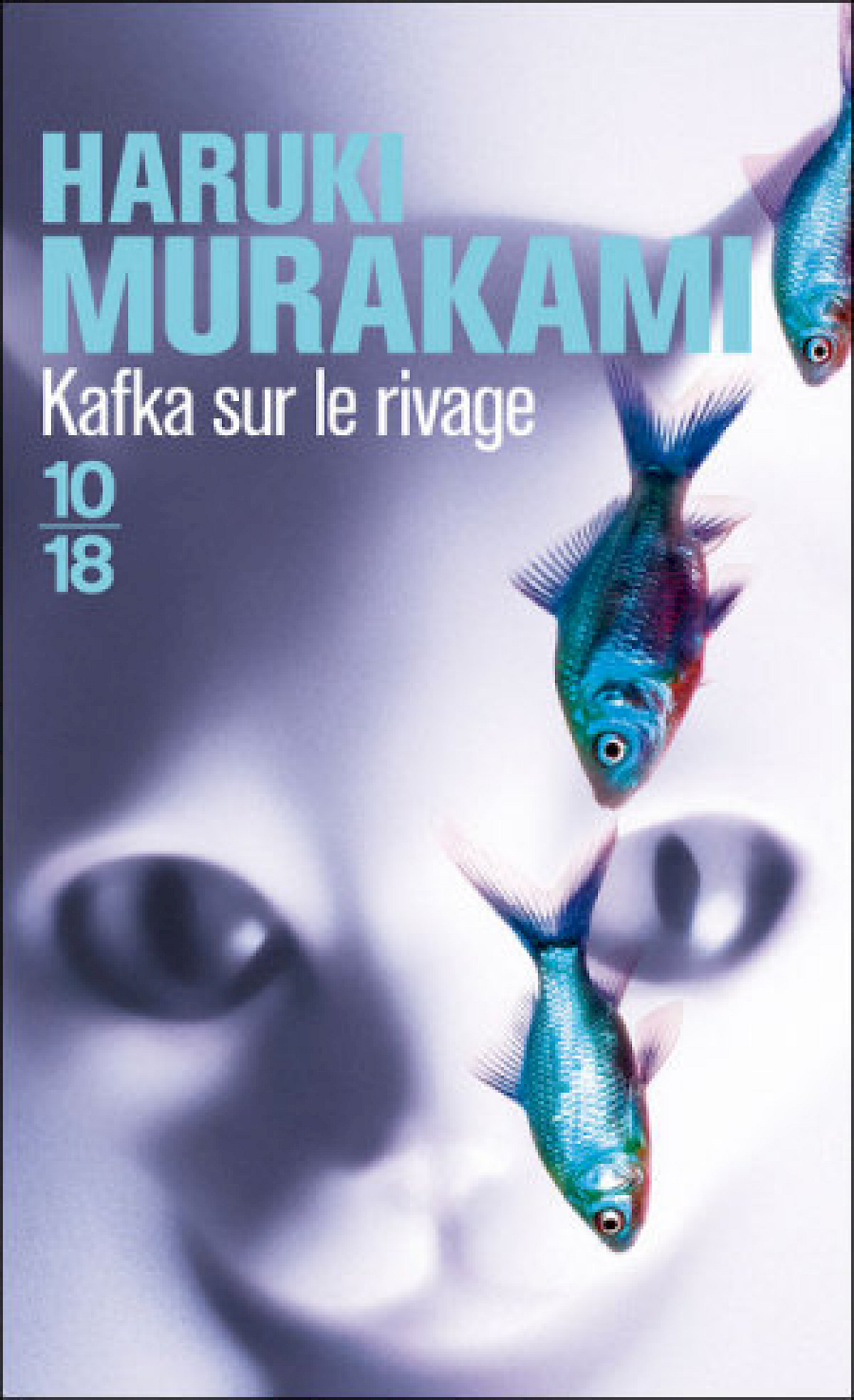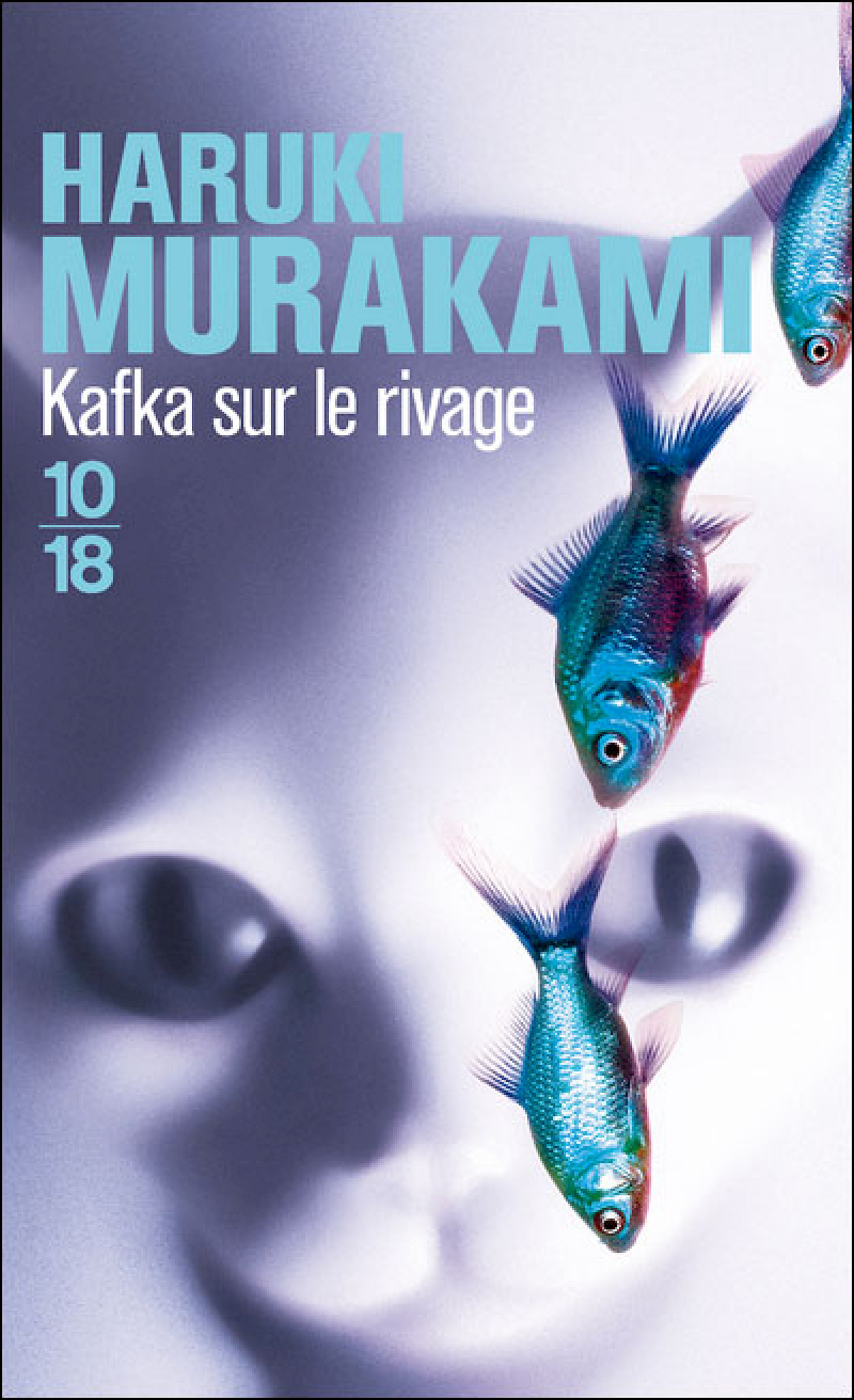
Le prologue nous présente un gosse de riches introverti, âgé de quinze ans, le narrateur, qui s’ouvre de son projet de fugue à un camarade. L’écriture est naturelle, la narration fluide et agréable, on se dit qu’on est partis pour un road movie classique . Quoique… Il y a l’interlocuteur, un garçon dont on perçoit très vite la nature énigmatique, voire inquiétante. De plus, un arrière-plan nauséeux s’esquisse. Notre aspirant-fugueur ne parle plus à son père, sa mère et sa sœur ont disparu. Il est question de prédiction, « constamment présente, telle une mystérieuse étendue d’eau noire » (p.16), de destin, de tempête et de fuite obligée. Des informations se retranchent derrière chaque phrase, il faut se préparer à la pêche aux indices. Mais… indices de quoi ?La vie de l’adolescent n’était pas rose : « Je ne me rappelais plus quand j’avais ri pour la dernière fois. » (p.15) Et la compassion nous étreint : « Dans l’immensité du monde, tu ne vois nulle part d’espace pour toi – un espace minuscule te suffirait, pourtant. Tu cherches une voix, mais tu ne rencontres qu’un profond silence. » (p.16) Sa fragilité émeut : « Le mur que j’avais érigé autour de moi s’écroulait parfois (…) je me retrouvais tout nu, exposé au monde (…) dans la confusion la plus totale. » (pp15-16) Pourtant, nous avons affaire à un garçon exceptionnellement volontaire, intelligent et organisé, qui a passé les deux années qui précèdent à préparer sa fugue. Naturellement grand, il a pratiqué la course à pied, la musculation, la nage, le judo… pour acquérir une carrure et des pectoraux qui masquent son âge. De même, il a mémorisé le contenu de tous ses cours et lu des centaines de livres, il se passionne pour la philosophie, la beauté, l’art. C’est qu’il a souhaité devenir « plus fort que n’importe qui ». (p15) Un développement solitaire qui impressionne mais donne froid dans le dos car il ne repose que sur la volonté de survie.
Le car de nuit qui emporte notre jeune héros, Kafka Tamura, de Tokyo vers le sud et le doux climat du Shikoku, démarre. En route ! Vers la grande aventure. Épique ou intérieure ?
Dès le chapitre II, un second fil narratif se dessine autour d’enquêtes menées par l’armée d’occupation américaine dans le Japon de 1946. Un dossier secret conservé par le Ministère de la Défense, où il est question d’un traumatisme subi par un groupe d’écoliers partis se balader en montagne. Dans une forêt, ils avaient entamé une cueillette de champignons, quand ils ont commencé à s’écrouler : « Toute force les avait quittés et j’avais l’impression de serrer des cadavres dans mes bras. Pourtant, ils respiraient normalement. (…) Leurs yeux grands ouverts paraissaient fixés sur quelque chose. De temps à autre, leurs paupières clignaient. Ils ne dormaient pas. (…) J’ai ressenti une sensation étrange à leur contact, comme si je touchais du vide. » (pp24-25) Au fil des investigations, on écartera l’intoxication alimentaire ou les essais chimiques d’une expérience militaire. Mais alors ? Il y a une atmosphère de complot et de fantastique (qui évoque Les 4 400 ou X-Files , deux séries télé, mais aussi des films comme Picnic at Hanging Rock , Virgin Suicides ou Le Village des damnés ).
L’alternance s’installe entre les deux fils, puis un troisième se tisse autour d’un vieil homme, Nakata, un simple d’esprit qui possède d’étranges pouvoirs et qui, gagnant sa vie en récupérant des chats perdus, va croiser la route d’un psychopathe. Un Nakata qui se révèlera l’un des enfants traumatisés dans la montagne un demi-siècle plus tôt !
L’intrigue est passionnante, car la fugue de Kafka se mue en quête où tout fait sens , il y a des aventures, des rebondissements, des rencontres bouleversantes. La jeune Sakura, qui héberge un temps l’adolescent, l’aime et le protège comme… une sœur. Mademoiselle Saeki, une quinquagénaire belle et fascinante, et son adjoint, l’ambigu Oshima, gardiens de la multiséculaire bibliothèque privée Komura, qui accueillent (et cachent) le héros dans leur antre dédié à l’Art et à la Connaissance. Etc.
Interpellé par les nombreuses zones d’ombre du roman, le lecteur se demande ce qui s’est passé dans la montagne, bien sûr, mais s’interroge aussi sur les conséquences du phénomène à travers le temps, les générations. Si le héros doit fuir son père et sa funeste prédiction, si Nakata, à son tour, se met en route pour accomplir une mission, il doit bien y avoir un lien. Et que signifient le singulier tableau dissimulé dans la bibliothèque Komura, les paroles du disque enregistré par Mademoiselle Saeki, les absences du jeune héros, qui se réveille un jour maculé de sang, ou le choix de son prénom d’emprunt ?
Nous venons de baliser l’entrée dans le livre, à l’instar d’un faisceau lumineux projeté sur le seuil d’un labyrinthe de galeries souterraines. Mais… à présent que le roman déroule pleinement sa matière, nous découvrons une luxuriance et une complexité telles qu’il s’avère impossible d’en rendre compte ! Seule une analyse transversale nous permettra d’appréhender une partie de la substance.
Il y a la diversité des tons, d’abord.
Murakami peut se montrer assez cru, comme lors de la description du rêve érotique d’une jeune femme : « j’avais encore la sensation de la verge de mon mari dans mon vagin. ( ..) mon sexe était humide comme après un véritable rapport. » (pp132-133) Mais les envolées poétiques ou lyriques sont légion : « Je continue à progresser (…) comme si les battements d’un cœur géant me poussaient en avant. Ce chemin mène à un lieu particulier de moi-même. Une lumière d’où sourdent les ténèbres, un lieu où naissent des échos silencieux. Je veux voir ce qu’il y a là. Je suis porteur d’une lettre hermétiquement scellée, d’un message secret destiné à moi-même. » (pp543-544) Et combien d’autres accents : le fantastique (rose avec Nakata qui sait parler aux chats ou faire pleuvoir des poissons, noir quand il est question d’un esprit du Mal tentant de s’incarner), le policier, la science-fiction ou le thriller, l’animisme, voire le mysticisme, l’incantatoire. Enfin, le récit intègre d’innombrables digressions didactiques ou philosophiques. Qui ne sont jamais du remplissage mais un approfondissement du parcours du héros ou du sens du livre.

Ainsi, quand Oshima commente la sonate en fa mineur de Schubert : « (…) les œuvres qui possèdent une sorte d’imperfection sont celles qui parlent le plus à nos cœurs, précisément parce qu’elles sont imparfaites. (…) Un sens de l’imperfection, s’il est artistique, intense, stimule ta conscience, maintient ton esprit en alerte. (…) je peux entendre les limites de ce que les humains sont capables de créer, je sens qu’un certain type de perfection peut être atteint avec humilité, à travers une accumulation d’imperfections. » (pp148-150) Et quand Oshima, qualifiant encore la musique de Schubert, en conclut qu’elle touche à « l’essence même du romantisme » (p.151), on peut appliquer la sentence au roman tout entier. Tout comme ces réflexions sur l’œuvre de l’écrivain japonais Sôseki : « Je me demandais ce que l’auteur avait voulu dire exactement. Mais c’est justement ce « je ne sais pas ce que l’auteur a voulu dire exactement » qui m’a laissé la plus forte impression. » (p.142) Et tout cela n’exclut jamais l’humour ou le surréalisme. Ainsi, notre serial killer s’en prend… à des chats. Et son allure est pour le moins singulière : « Un homme de haute taille avec un chapeau haut de forme en soie (…) une redingote rouge ajustée, sur un gilet noir (…) de grandes bottes de cuir noir. (…) pantalon (…) blanc comme la neige et incroyablement moulant. » (p.169) On dirait… Et en effet : « Les amateurs de whisky me reconnaissent au premier coup d’œil (…) Je m’appelle Johnnie Walken. » (p.170)
La diversité des tons et des contenus débouche sur le mélange des genres. Car nous voici dans un conte philosophique et moral, un conte initiatique et même un conte de fées. Mais tout autant dans un récit d’épouvante, une mise en question du bildungsroman à leçons ou un avatar du mythe d’Oedipe. Où le contenu glauque de la projection psychanalytique cède, dans la foulée de l’original grec, face à l’exercice du courage absolu et pur qui conduit un être « amoureux d’un fantôme, jaloux d’un mort » à vouloir aller au bout de la vérité : « Je ne veux pas élever un mur pour repousser les puissances extérieures. » (p.431) Une morale adaptée au monde réel et à la volonté de survie : « Moi, je recherche une force capable d’absorber les pressions de l’extérieur et qui me permette de les supporter. » (p.431) Pour dépasser le destin, s’en libérer ?
Tout cela relève d’une vision subtile, très orientale (le yin et le yang), qui font que tout, être ou phénomène, est toujours complexe ou polysémique . D’un côté, Murakami nous présente la violence et les ténèbres qui enveloppent le monde (de l’indifférence des fonctionnaires ou des brimades des condisciples jusqu’aux agressions par des délinquants, des psychopathes ou d’énigmatiques forces de la nature) ou qui se lovent à l’intérieur des êtres (désirs sexuels ou ripostes incontrôlées de notre Kafka ; frémissements bridés, voilés, comme lors d’un trajet en voiture à tombeau ouvert, chez Oshima). Mais, d’un autre côté, nous ressentons un réel confort, un bonheur inouï à nous balader en compagnie de personnages sincères et intègres , qui ne jugent pas mais acceptent, offrent. Paradoxal aussi (et expiatoire ?) le rapport entretenu par Kafka avec la nature.
(…) un violent orage éclate. La pluie s’abat (…) Je me déshabille entièrement, et sors tout nu sous l’averse. Je me savonne les cheveux, le corps et me lave sous cette douche naturelle. Je me sens merveilleusement bien. Je ferme les yeux et hurle à tue-tête des mots sans suite. Les grosses gouttes me frappent comme des cailloux. Ces pointes de douleur semblent faire partie d’un rituel d’initiation. Elles frappent mes joues, mes paupières, ma poitrine, mon ventre, mon pénis, mes testicules, mon dos, mes jambes, mes fesses. Je ne peux même pas garder les yeux ouverts. De cette douleur se dégage un sentiment d’intimité avec le monde, comme si enfin il me traitait justement. (p.186)
Un rapport fusionnel qui peut se faire plus délicat, quand il apprécie la lumière, un bain de soleil. Mais la nature, c’est la forêt aussi et son « obscure magie préhistorique » (p. 182) : « Les arbres aux hautes cimes m’encerclent, tel un mur épais. Je crois voir des choses sombres dissimulées entre les branches, sortes d’animaux en trompe-l’œil, et me sens à nouveau observé. » (p.185)
La matière du roman est si grouillante qu’on ne peut que passer sous silence mille et une trouvailles , mille débats, mille émotions.
Essayons encore.
On pourrait évoquer les irruptions d’un narrateur non identifié qui commente les faits et gestes de Kafka à la manière du Koros des tragédies grecques :
Tu as peur de ton imagination. Et plus encore de tes rêves. Tu crains cette responsabilité qui commence dans le rêve. Mais tu ne peux pas t’empêcher de dormir et, quand tu dors, les rêves surviennent immanquablement. (p.186)
On pourrait aussi s’attarder sur la dérive de l’espace et du temps :
Puis je retourne dans ma chambre, je mets Kafka sur le rivage sur la platine, abaisse l’aiguille. Et une fois de plus, que je le veuille ou non, je suis emporté là bas, en ce temps là. (p.379)
Plus profondément, on a cru percevoir ce récit comme une métaphore de la crise de l’adolescence face à l’identité familiale et sexuelle. Et la position exacte des Sakura et Saeki reste à réévaluer, comme celle d’un Oshima, voire d’un Nakata. Mais il y a la métaphore du labyrinthe aussi , qui court en filigrane à travers les 638 pages et renvoie à la mythologie, au parcours initiatique de Kafka, mais aussi à la forêt et à ses « entrailles », élément charnière de l’ouvrage.
Il nous a paru qu’à l’instar du Nocturne indien d’un Tabucchi, ce roman-ci en dissimule un second, inscrit en creux, dont nous ne possédons que des bribes et qu’il nous appartient (ou pas, au fond) de reconstituer. Un travail de relecture ou d’interprétation (de recréation ?) qui s’apparente à celui d’un archéologue refondant une cité, une civilisation à partir de vestiges isolés. On ne comprend pas tout, donc, le livre ressemble à la vraie vie et conserve sa part de mystère. Tant mieux ! Il y a du Perceval là-dedans.
Ce livre est comme un alcool très fort , on le boit puis on le laisse agir et, soudain, la perception change, on ne pense plus, on sent.
Enfin, il est frappant d’observer un univers décloisonné, où l’on ose affronter toutes les pensées, où toutes les références culturelles se bousculent. De Puccini et Beethoven à Duke Ellington ou Coltrane, Prince ou Radiohead, de Tchékov ou Tolstoï à Aristophane ou Aristote. Références occidentales ? Il est vrai que Murakami a peu de goût pour un certain classicisme japonais et qu’il a préféré aller vivre en Grèce ou en Italie, puis aux États-Unis ; qu’il s’est occupé un temps d’un club de jazz ou a traduit Carver et Fitzgerald.
Mais il se pourrait que Kafka sur le rivage soit une mise en abyme de la quête de l’auteur pour retrouver, sinon ses racines, leur essence, car ce formidable auteur, touché par les drames de sa patrie d’origine, est rentré au pays après le tremblement de terre de Kobé et les méfaits de la secte Aum. Et si la bibliothèque privée Komura, où Kafka semble chercher son destin, figurait l’âme vive et éternelle du Japon ?
Murakami, auteur-phare du XXIe siècle, citant Goethe, ne nous rappelle-t-il pas (p.143) que « la création tout entière est une métaphore » ?
Joëlle Maison et Philippe Remy