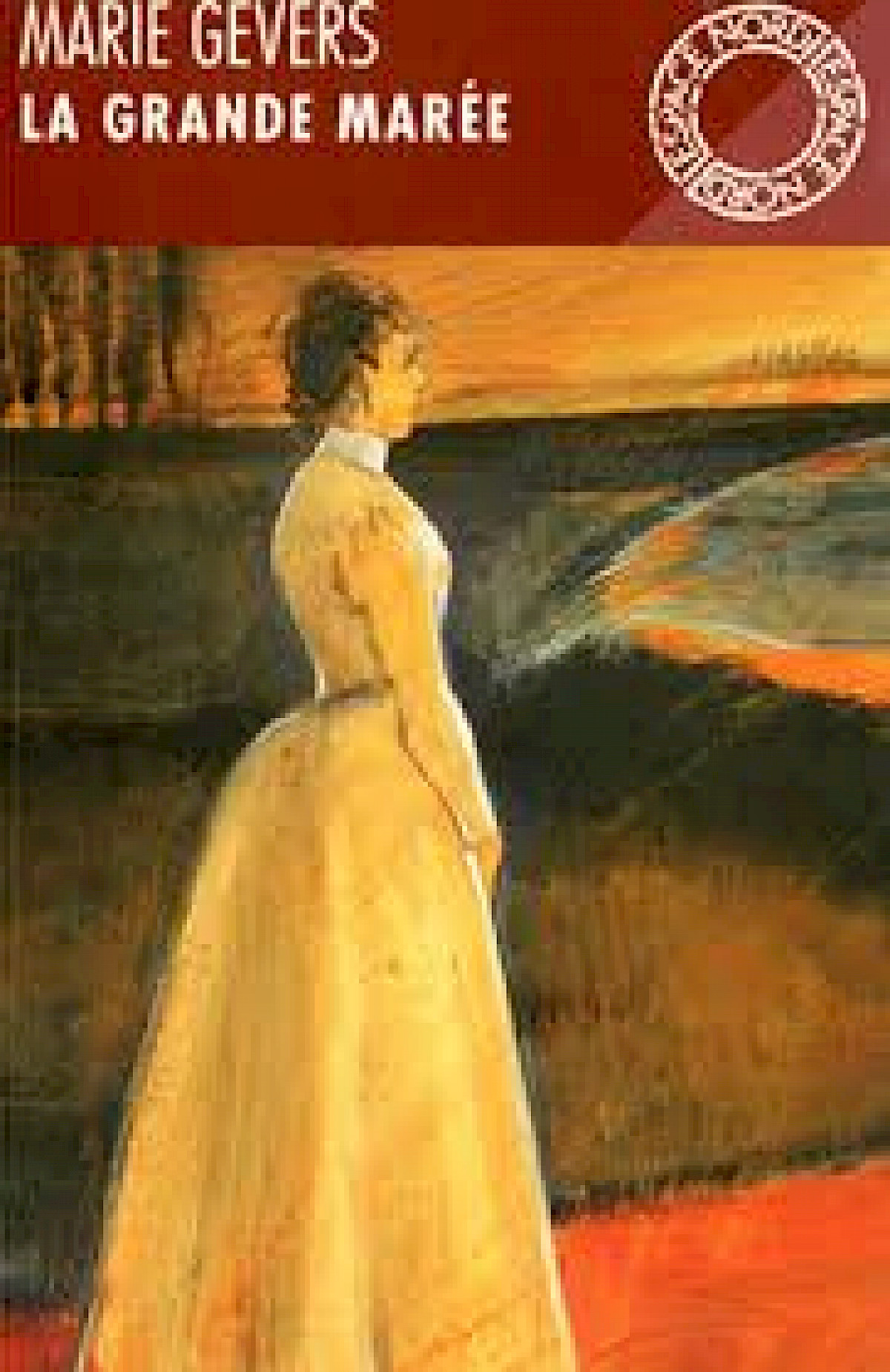
À la fois sauvage et contenu, classique et méconnu, La grande Marée (1943) est un voyage précis et poétique à travers les plaines de l’Escaut. Sous prétexte de marivaudage mêlé de récit initiatique, Marie Gevers pose un regard unique sur les intrications des humeurs humaines à celles du ciel et de la terre.
Dans une nouvelle de 1936, étendue en roman durant la guerre, Marie Gevers archive les désirs et les mœurs d’une famille qui fonctionne en cercle fermé. Les personnages qui la composent ne sont pas vraiment aimables : petits bourgeois cramponnés à leurs avoirs, jeunes femmes intéressées que ne lient aucune amitié, hommes décevants et maris indolents portés par les calculs de leurs épouses. Mais ces figures archétypales exhalent une vie pleine, soutenue par une langue descriptive chaude et mouvante, à l’opposé des pages sèches que voient souvent fleurir les histoires qui tendent à offrir une représentation photographique d’un milieu et d’une époque passées. Et si leurs caractères ne recèlent pas des trésors de complexité, le paysage se déploie pour eux. C’est au contact du vent, des saules et de la pluie que Gabrielle, Raymond et Simone trouent la surface lisse de leur masque social et exposent leur sincérité.
« Pour apprécier la beauté de mon pays, il faut donc pouvoir aimer les arbres, la plaine et l’eau. »
La grande Marée est un récit novateur à plusieurs égards. L’emploi d’un point de vue féminin semble le plus évident : bien que l’intrigue puisse paraître datée et les aspirations de Gabrielle très conservatrices, mettre en mots une expérience féminine vécue à travers les yeux d’une narratrice autodiégétique relève, pour l’époque, d’une certaine audace1 . Mais l’innovation la plus essentielle réside dans la manière qu’a l’autrice de parler de la zone géographique dans laquelle se meuvent les personnages – les plaines de l’Escaut. Marie Gevers écrit la nature sans jamais en tracer le nom. Plutôt qu’au terme profondément réducteur qui les recouvre, son récit laisse place aux multiples organismes et matériaux qui s’associent pour former ce que voient les yeux humains.
« Je regardai d’abord le ciel, le ciel d’aurore en pleine eau. Une lueur montait et s’établissait par bandes successives, en passant par l’or pâle, et en allant jusqu’à l’or rouge ; on voyait s’y dessiner des rangées de peupliers plus délicats qu’une dentelle. Du côté opposé, à l’ouest, la pleine lune se couchait, extrêmement rouge, dans toute la brume dégagée par les eaux. Le plus surprenant, c’était le zénith, le bleu du ciel au-dessus de nos têtes, si pur, lavé par tant d’averses, luisant et frais comme les petits poissons argentés dans les ruisseaux printanniers ; dégagé, désencombré par les coups de bélier de la tempête. »
Marie Gevers réserve toutes les nuances et les éclats de son discours aux humeurs de l’eau. Elle déploie une grammaire de l’Escaut, déplie l’anatomie de la plaine comme celle d’un grand corps – un grand corps de feuilles, de boues2 , de courants d’air et courants d’eau qui, chacun, mènent une existence singulière, aussi riche (voire plus) que celle menée par les humains avec lesquels ils cohabitent.
« Ici, reprit-il, voyez, la marée est tout à fait basse et elle laisse à découvert de grandes étendues semblables à des coulées de lave, auxquelles sont mêlées, confusément, des proies à demi englouties. Et ici… Il y a des renflements inexplicables, qui reluisent au soleil, des objets mystérieux… poissons morts ou ancres mouillées. Des plis comme des musculatures, des trous comme des blessures ! »
Dans la langue de Marie Gevers, l’eau frissonne et se plisse comme une peau, le crépuscule jette de la cendre sur les vases grises, le vent ouvre ses ailes et s’élance vers les berges avec plus de détermination que Gabrielle vers Raymond. Tous les éléments de la vaste cosmographie établie par l’autrice – à partir d’un lieu pourtant pas bien grand – se mêlent et s’activent les uns au contact des autres : le vent, le feu, les torrents sont des forces plus grandes que celle qui anime la société que décrit l’autrice, économiquement prospère mais aussi convenue qu’entravée.
« Sous le soleil vertical, les arbres ramassaient leur ombre sous eux, comme pour en couver la fraîcheur. L’eau, légèrement agitée sur les bords par le remuement des canards, semblait faite de plumes de paon vertes, bleues, pleine d’yeux et de moires. Je m’assis sur l’un des troncs penchés, j’étais, moi aussi, entourée de chaleur et de fraîcheur mêlées comme ces reflets de ciel et de feuillages dans l’eau. J’examinais attentivement toute cette beauté autour de moi. Maintenant, au lieu d’en subir vaguement le charme, je distinguais les objets : voici l’herbe, voici le feuillage des saules, si souples, si fins, et les feuilles d’aunes, rudes et plates, voilà dans la transparence de l’eau, une herbe aquatique dont j’ignore le nom… comme elle est légère et douce ! »
Et si les phénomènes naturels se déploient en miroir de la narration, il convient de ne pas trop longuement s’attarder sur cette idée. Oui, la digue submergée par la crue du fleuve fait face au rempart des raisonnements et des calculs qui cède sous les assauts des sentiments romantiques : « Et si l’amour, trop fort, rompt tout, je verrai peut-être un paysage de lendemain de déluge, c’est vrai, mais je verrai aussi miroiter les étendues au soleil et au clair de lune. » Mais s’agit-il seulement d’un reflet ? Le souci du non-humain dont fait montre Marie Gevers ( et qui se déploie pleinement dans un livre comme Plaisir des météores ) apparaît trop important, trop prégnant, pour que le rôle de la marée (et autres phénomènes) soit réduit à l’expression de réflexions détournées portant sur les affaires humaines. Toute la finesse du récit, garante d’une lecture toujours neuve en dépit du caractère quelque peu passé de la construction de l’intrigue, est ce regard précis posé sur le non-humain. Un regard qui transperce les frontières et laisse l’espace nécessaire à l’élaboration de ce dont notre société contemporaine manque toujours plus cruellement : des moyens de co existence – et puisque le réel n’est que le récit que l’on s’en fait, relire ceux de Marie Gevers pourrait être une jolie façon de transformer nos modes d’attention.