LANGUAGE IS A VIRUS
Avant d’avancer d’autres manières d’accéder et de rentrer dans les romans de WSB, quelques hypothèses sur notre première lecture, première approche des cut-up. Première saisie pour le moins restrictive et négative. Dire d’où vient cette lecture et préciser ce qu’elle loupe.
Hypothèse 1 : nous lisons en pilotage automatique. Dès que nous ouvrons un livre, un quotidien, un magazine, nous mettons en branle nos grilles de lecture, nos modes habituels d’appréhension, de captation. Nous vivons une époque où la plupart des livres littéraires que nous lirons seront des romans. Probablement des romans de genre. Dès lors, c’est automatique : dès que nous ouvrons un livre, nos sens sont en éveil selon un mode particulier d’appréhension . Nous cherchons à retrouver dans les pages qui défilent ces points de repère qui nous permettront de capter, voir, suivre, sentir. Sans ces points de repère, nous sommes comme bottés en touche. Éjectés du livre. Comme si celui-ci était soudainement écrit en langue étrangère. Dans une langue dont on ne maîtriserait ni la grammaire ni le vocabulaire.

Hypothèse 2 : se plonger dans un livre de B, c’est ouvrir un ouvrage écrit en langue étrangère. Et comment en serait-il autrement ? Si l’on croit que la langue écrite est un virus ; si l’on croit que, depuis des siècles, la langue écrite nous infecte et nous entrave, comment écrire encore si ce n’est en langue étrangère, en langue renversant nos codes et nos pilotes automatiques ? Il y aurait ici tout un travail à faire, toute une analyse visant à montrer comment les livres de B et les techniques de montages/démontages inventées par l’auteur renversent nos attentes usuelles de lecteurs. Les cut-up sont de grands puzzles où tout se mélange. De grands chaos. La grammaire y est brisée. Les mots s’y enchaînent de façon inattendue. Les « personnages » ne sont plus que des forces agissantes. Paraissent totalement dépourvus de psychologie et d’intention. La temporalité des événements est impossible à suivre. Il n’est pas possible de savoir où nous sommes. À quelle époque. Dans quelle ville. Sur quelle planète. Par conséquent : un livre de cut-ups — voire même n’importe quel livre de B — n’est pas un livre forcément à lire in extenso de la première à la dernière page, selon le déroulement de la pagination. Un livre de cut-up peut s’ouvrir n’importe où. Être lu au hasard. Quelques pages par-ci. Quelques pages par-là. Abandonné durant des années. Puis repris. Rouvert au hasard. En fonction des intérêts du moment. Un livre de cut-up n’est pas un appareil de captation. N’est pas une machine qui nous piège et nous tient en haleine comme un bon roman policier. Un livre de cut-up nous dit : n’oubliez pas d’aller voir ailleurs. Sortez des livres. Retrouvez votre libre arbitre. Usez des livres comme bon vous semblera. Les livres sont des pièges. Surtout n’oubliez pas d’en sortir. En tout cas, ne vivez plus captés, vivez votre vie. Ces quelques réflexions sur le livre de cut-up nous mènent à l’hypothèse 3.
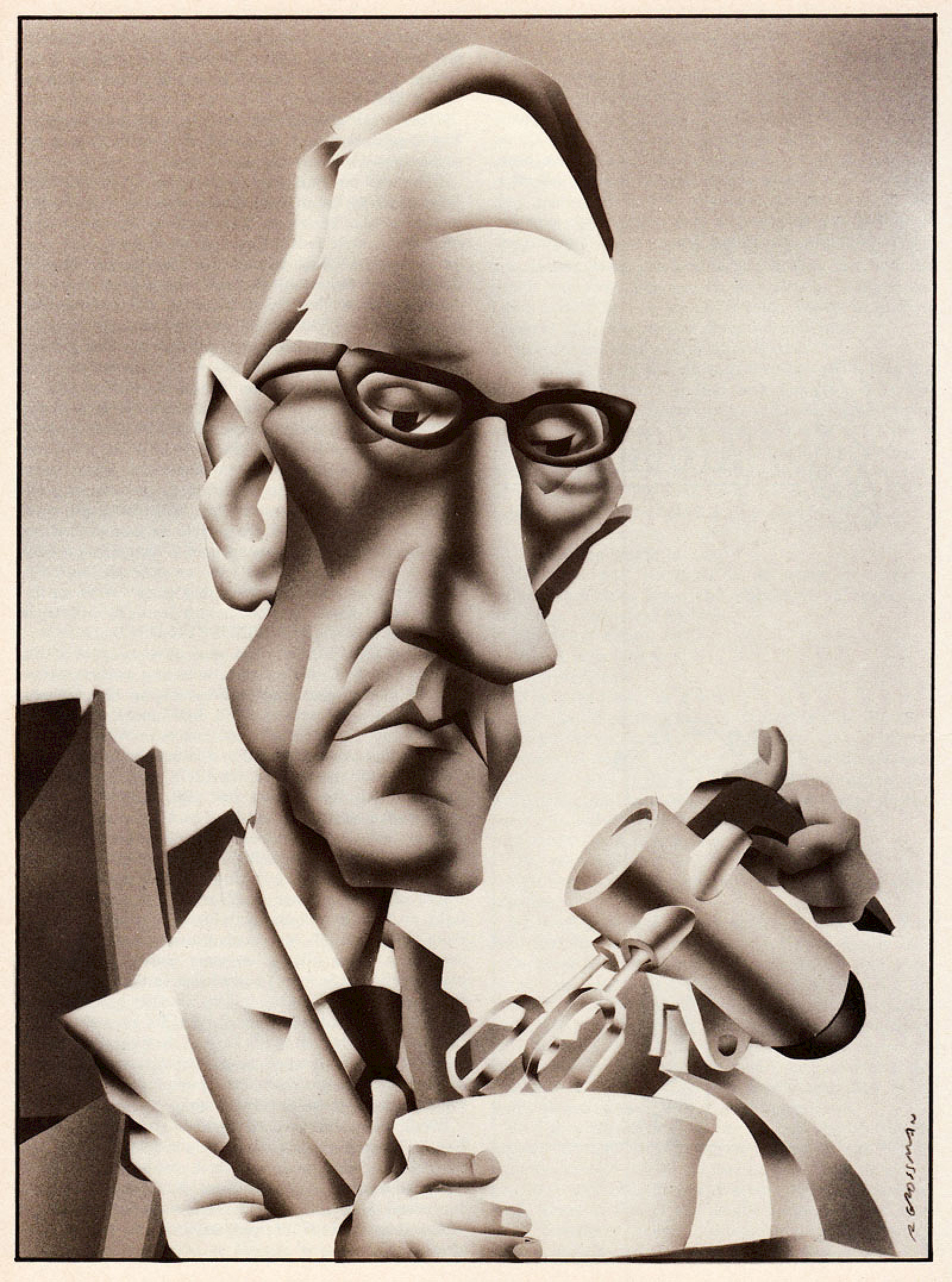
Hypothèse 3 : la manière restrictive de lire les cut-up, de les voir, en somme, comme des textes « troués », criblé de « manques », rate pourtant l’essentiel. Se focalise trop, je pense, sur l’« esthétique ». Néglige, en tout cas, la portée « éthique » et « politique » d’une telle écriture. Néglige, en tout cas, le fait qu’en souhaitant libérer les mots, faire en sorte qu’à nouveau un chant soit possible, B, comme une espèce de Don Quichotte, s’attaquait en règle aux diverses machines d’asservissement ayant cours à nos époques. Machines d’État, institutions religieuses, systèmes d’enseignement, hégémonie de la langue écrite, etc. Ses livres expérimentaux, comme ses autres ouvrages d’ailleurs, regorgent de « routines », de petites histoires mettant en scène un groupe d’individus sur lequel subitement souffle un vent de liberté. Par exemple, dans le Festin Nu , il y a un chapitre extrêmement drôle relatant l’évasion de l’asile d’une bande de fous. Il y a aussi, dans le Porte-Lame , cette folie finale où deux groupes se rejoignent dans le hall d’une gare et littéralement explosent de joie. Il y a aussi, dans Apocalypse , un livre écrit en collaboration avec le street artist Keith Haring, dans une pétarade de couleurs, l’envahissement de la ville par une bande de grapheurs. Pas un livre de Burroughs (sauf bien sûr ses essais, livre de rêves, livre sur les chats, l’un ou l’autre scénario, etc.) qui ne porte en lui, quelque part, ce vent joyeux de la révolte, cette anarchie violente et ravageuse, véritable énergie, bien souvent sexuelle et sexuée, débordant de partout dans le monde. Cela est joyeux. Excessif. Et, surtout, excessivement drôle. Ces cavales dans le monde sont, personnellement, ce que j’aime lire chez B. Puis, face à ces groupuscules d’exaltés, il y a l’appareil d’État, les institutions, leurs systèmes répressifs et policiers.
Oui mais.
On pourrait objecter ceci : si, pour lire B, il ne faut sans doute pas perdre de vue la portée « politique » et « éthique » de ses œuvres, fallait-il pour autant en passer par une telle pulvérisation de tous nos repères esthétiques ? Fallait-il décevoir à ce point nos attentes légitimes de lecteurs ? Le risque n’est-il pas grand de voir le livre, sitôt ouvert, sitôt fermé ? Effet « politique » nul ! Puissance libératoire pulvérisée ! Ce serait tout de même singulier pour les livres de quelqu’un qui cherchait à nous « libérer » de nos emprises psychiques, psychologiques et langagières, de manquer à ce point l’un de ses buts, non ?
Oui.
Bien vu.
