Rétromania Nostalgie,
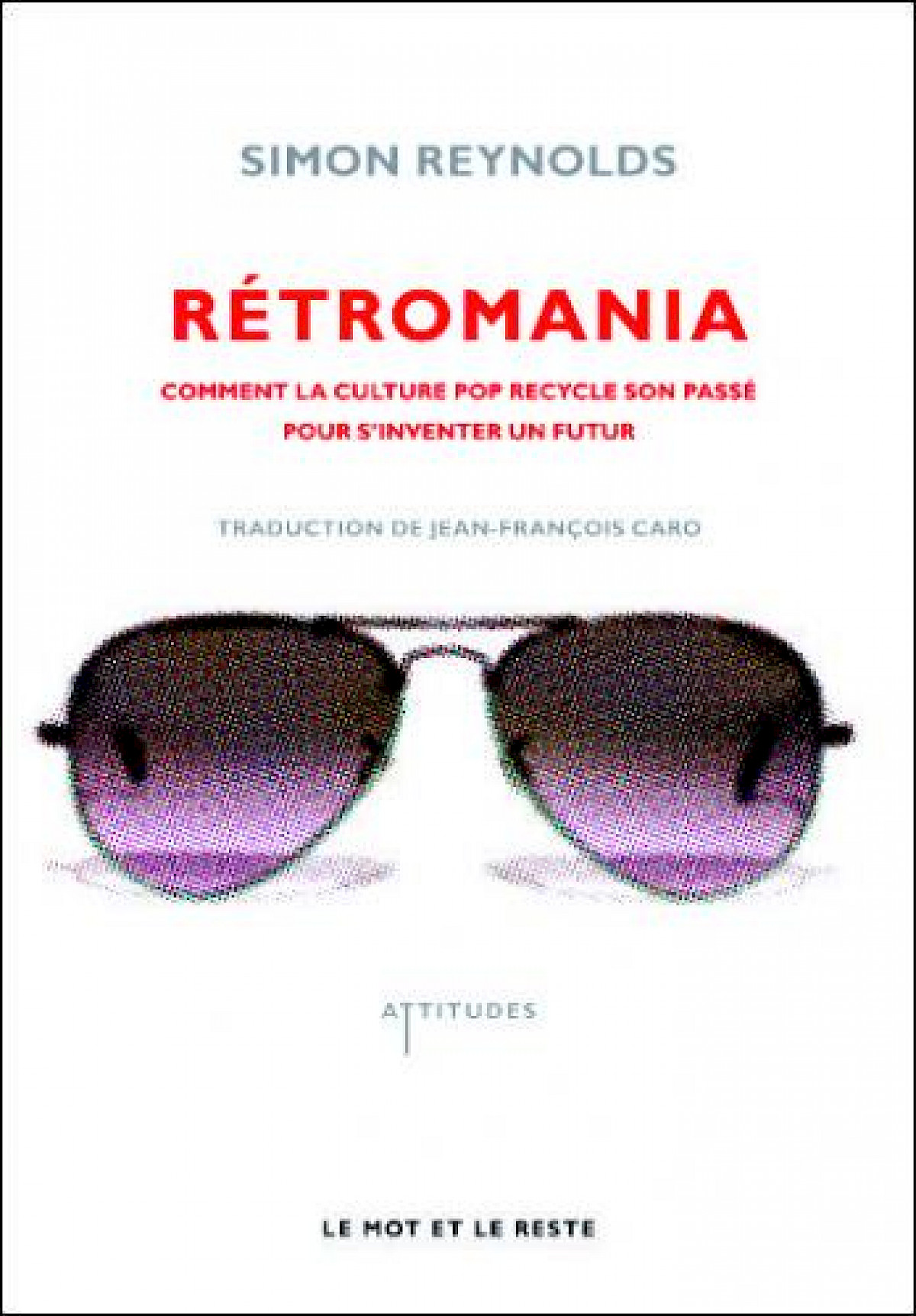
À l’heure où Paul McCartney multiplie les collaborations avec Kanye West, où Ariel Pink parodie les années 1980 pendant qu’Aphex Twin s’imite à la perfection, le livre de Simon Reynolds sert d’éclairage à un monde culturel, surtout musical, obsédé par son passé.
Interprété comme une malédiction du XX e siècle par le New York Times , comme une addiction par le Guardian ou comme un désir perpétuel par Slate , la Rétromania raisonnée par Simon Reynolds a fait parler d’elle à sa sortie en 2012. Son auteur n’en est alors pas à son coup d’essai. Six ans auparavant, ce rejeton du punk avait publié Rip it Up and Start Again : Postpunk 1978–1984 , pamphlet à la gloire d’un genre prolifique, rendu possible par les revendications de simplicité héritées du (défunt) punk. L’ancien chroniqueur du magazine The Wire identifiait ainsi le besoin insatiable de la musique populaire d’embrasser ses origines pour mieux envisager son avenir . Cette assertion prend une tout autre tournure quand l’auteur s’interroge sur les artistes contemporains.
Les chemins de la perdition
Sur près de cinq cents pages, Reynolds décrit plusieurs phénomènes qui rendent notre société dépendante de ses héros, de ses codes et des productions culturelles du passé. L’obsession pour l’exhumation nous entraînerait sur une piste sans issue, un loop éternel , comme un vinyle rayé qui a cessé de faire un tour complet.

Pour se justifier, l’essayiste et théoricien rappelle diverses tendances récentes (et de fait anglo-saxonnes) : la réédition d’albums, les reformations et les concerts anniversaires, le goût pour le vintage (le succès du festival Retrorama à Bruxelles ne se dément pas), la propension pour les covers (ou les remakes au cinéma) ou encore le retour des formats oubliés (vinyle ou cassette). Ne lésinant pas sur son arsenal scientifique (Derrida, Baudrillard, Walter Benjamin…) ni sur des témoignages directs (du collectionneur fou Julian Cope à Billy Childish, le messie du rétro-punk ), Simon Reynolds multiplie les anecdotes et les interviews pour édifier ses théories. Le lecteur qui ne serait pas un fanatique peut d’ailleurs vite ressentir une indigestion face aux noms, aux labels et aux différents styles qui s’enchaînent. Plus la théorie de Reynolds est illustrée, plus son dessein devient obscur.
Sans aborder les aspects purement musicologique des époques évoquées, leurs différences ou leurs ressemblances, l’auteur s’appuie sur une connaissance encyclopédique, indispensable pour suivre son cheminement intellectuel . Le résultat ne se fait pas attendre : les trois parties prévues par l’auteur ( aujourd’hui , hier et demain ) se confondent à travers des concepts récurrents (la collection maladive d’objets rocks, les revivals ou la phase décisive des sixties ).
Du revival pour tous

Malgré cette approche parfois un peu confuse, la structure du pavé monomaniaque permet tout de même de distinguer trois phases. Dans un premier temps, notre obsession pour le passé se traduirait plus facilement depuis l’avènement de cette médiathèque dématérialisée qu’est Internet . YouTube et le format MP3 forment un archivage unique. Ensuite, cet accès illimité permet d’accélérer le temps d’apparition des revivals , l’histoire ayant prouvé leur comportement cyclique. Et enfin, ces facteurs créent des possibilités infinies de réinterprétation, nous offrant un paysage sonore très diversifié mais déjà éprouvé . Reynolds écarte donc toute possibilité de voir une grenade à déflagration comme le punk venir repeindre le décor. En effet, dans le chapitre qui lui est consacré, il perçoit une volonté de cracher sur la complexité et d’embrasser à nouveau des racines rock’n’roll simples et efficaces. Du passé faisons table rase : le punk libère le champ des possibles et le rock absorbe bientôt des influences ethniques sous-estimées (l’ afrobeat , le ska …) et d’autres formes ectoplasmiques populaires ( funk , jazz …).
Si ce long débat prêtait à une certaine exhaustivité dans les pages de son précédant essai, Simon Reynolds induit ici l’idée que tout revival se crée sur la lassitude de son époque . C’est pourquoi, par exemple, le premier revival garage (à l’apogée des Cramps) surgit au moment même où le post-punk s’essouffle, au début des années 1980. Le deuxième retour du style s’amorce au début des années 2000 (White Stripes, The Hives…) en réaction à la musique de MTV. Selon Reynolds donc, tous ces souvenirs déterrés se mélangent désormais, des souterrains musicaux aux édifices populaires . Ainsi la nostalgie, déjà délectable dans la tarte américaine de Don McLean, n’aurait plus le goût du futur ?
Et après ?
Quand les Inrocks interrogent Simon Reynolds sur son essai pessimiste en 2012, celui-ci déclare que « quand un disque est très bon, je ne me pose pas la question de l’innovation. […] Mais j’aimerais que ça s’applique à tout un genre, à une tendance. Dans les années 1990, j’étais à fond dans la culture rave et jungle . J’avais une foi presque religieuse, patriotique, dans ces mouvements. C’était mon identité. »

En deux mots, il résume ce qui semble primordial à l’éclosion d’un genre : un mouvement social . Il lui semble donc difficile de faire plus novateur que les sixties tant les changements ont été radicaux, d’un point de vue sociétal et donc culturel. Le blues est né de l’esclavage. Le rock’n roll donnait voix à une génération de baby-boomers lassés des valeurs conservatrices de leurs aînés. Le rap prendra vie dans des ghettos où l’escalade de la violence paraissait sans fin.
Suivant ce regard sur l’histoire, le mouvement rave apparaît selon lui comme le dernier coup d’éclat en date1 . Ainsi, même si l’ autotune et les infrabasses sont résolument des procédés nouveaux, ils n’illustrent pas vraiment d’innovations . Et quand bien même les prouesses informatiques permettent-elles un archivage universel, elles donnent d’abord lieu à des mashups ou à des assemblages de musique complexes, à l’instar de Flying Lotus2 . Le jeu du sampling ou de l’anthologie3 authentifient la nostalgie sans jamais la dépasser. Quant à un album multi-styles comme A Sufi and a Killer (2010) de Gonjasufi, l’auteur préfère la notion d’ hyperstase , autrement dit une succession de pistes de différentes époques au sein même d’une production contemporaine.
https://www.youtube.com/watch?v=2BpPQv2yFnM
Si pour l’auteur la culture rétro occidentale symbolise une époque en déclin, les pays émergents pourraient devenir les précurseurs. Les révoltes sociales se multiplient et elles ont besoin de leur bande sonore. Et chez nous ? Il existe bien des formes de contestation : les hackers sous le couvert des Anonymous , les anarchistes communautaires de Sivens ou peut-être même les adeptes de la théorie du complot ? La réponse de Simon Reynolds reste pourtant sans appel : « Lorsque je parcours les villes et les banlieues d’Amérique ou d’Angleterre […], la dissonance cognitive que je perçois est une absence de dissonance cognitive. »
Pas de tension, pas de création ?