Tom Lanoye
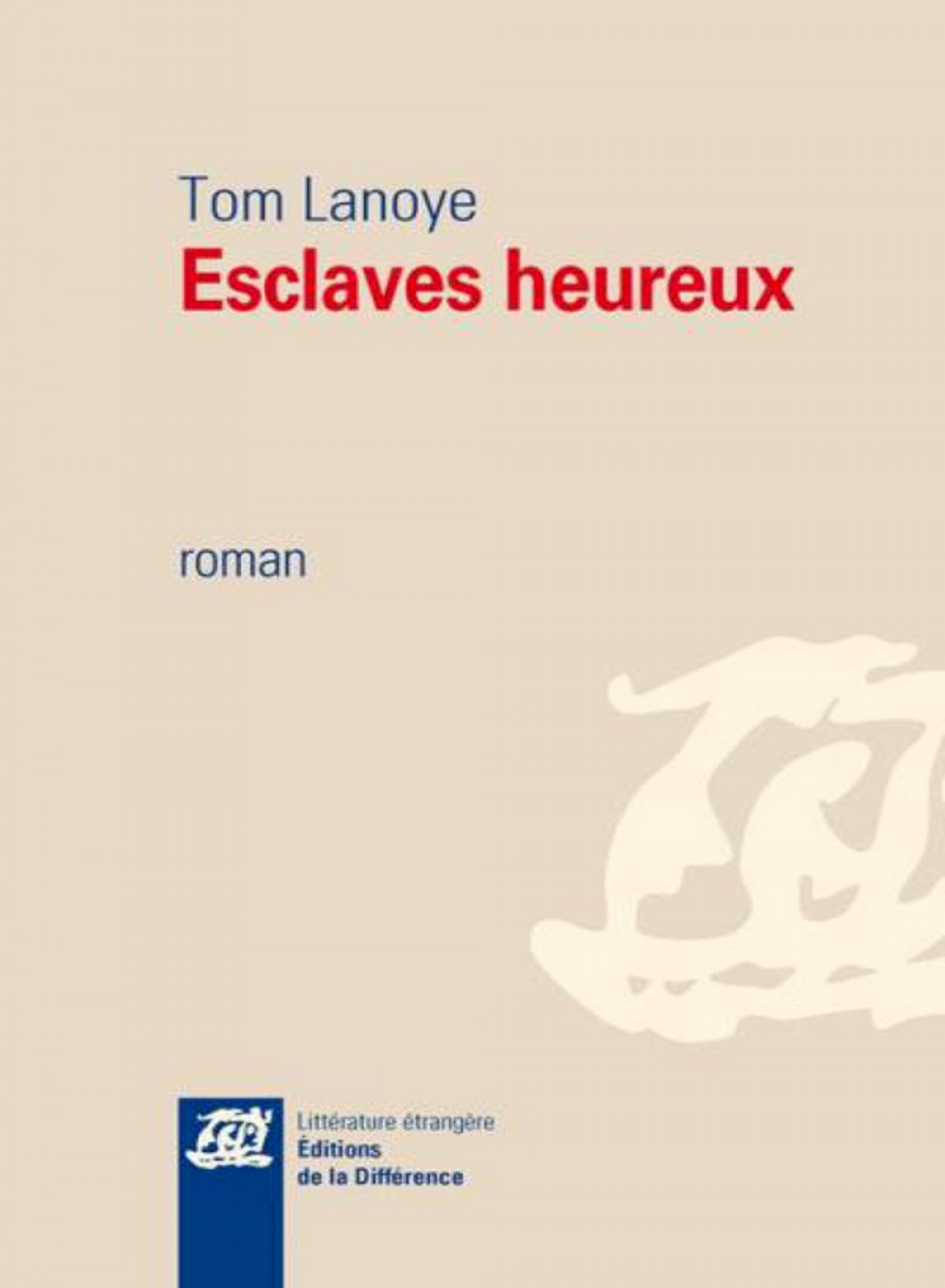
Gelukkige slaven die we zijn . C’est le dernier cri romancé de Tom Lanoye, le populairder des écrivains du nord du pays. Si la version néerlandaise est sortie en 2013, la traduction française, elle, vient de paraître, signée une fois de plus Alain Van Crugten, traducteur attitré de Tom Lanoye… et de Hugo Claus accessoirement.
Hugo Claus, justement, qu’on aime à présenter comme le père spirituel du poète-essayiste-dramaturge-romancier-politicard flamand que nous envient les Hollandais. Ce n’est pas la seule comparaison dont doit souffrir ce dernier, qualifié encore récemment, à l’occasion d’Esclaves heureux , d’« égal littéraire d’un Tarantino » (sic). Esclaves heureux : le titre sonne à la fois comme une promesse et une fatalité. Promesse de bonheur dans la servilité. Inévitable élan vers l’asservissement, avec le sourire imbécile joyeux en prime. C’est sans doute pour cela qu’il y a autant de morts béats et de jeux de pouvoir dans le dernier roman de Tom Lanoye. Et autant de Tony Hanssen aussi…
Deux pour le prix d’un. Deux Tony Hanssen qui suivent des trajectoires parallèles, deux homonymes parfaits appelés à se rencontrer à mille lieues de leur Belgique natale, et amenés à sceller leurs forces fatiguées dans une association qui leur répugne à tous deux. Duo de personnages antinomiques en diable, qui draine royalement le montage alterné de la narration.
D’abord, « NOUS RETROUVONS TONY HANSSEN dans la touffeur caniculaire d’un été aux effluves malsains. » Ce sont les premiers mots du prologue, traduits toujours aussi délicatement par Alain Van Crugten. Le premier Tony Hanssen avec lequel le lecteur fait connaissance végète à Buenos Aires, dans la torpeur moite d’une prostitution non assumée. Bardé de dettes envers le dirigeant le plus puissant de la pègre chinoise, l’antihéros belge s’est vu proposer/ordonner d’accompagner l’épouse de M. Bo Xiang dans un périple touristico-mafieux, officiellement pour servir de guide à la vieille dame richissime, officieusement pour lui servir de gode, et subrepticement pour lever des fonds de terroir.
Ce n’était pas le premier voyage où elle l’entraînait. Elle l’avait déjà pris en remorque jusqu’à Monaco et même jusqu’à Dubaï. Ces fois-là il avait encore pu éviter ses avances. Maintenant non. Il savait ce qui l’attendait. Buenos Aires serait son Waterloo.
[…]
Ensuite, complètement bourrés, ils s’en vont dans leurs milongas obscures, avec leurs vins bon marché, leur musique suante de piano à bretelles et leurs pas de danse spasmodiques, jusqu’au petit matin. Ridicule. Que sont des danseurs de tango sinon deux flamands roses entremêlés dans une crise d’épilepsie ? Tony sentait monter une profonde répugnance, qui confinait au dégoût. Il l’avait déjà senti enfler en lui la semaine précédente quand il avait ouvert le premier guide de voyage. « La ville du ris de veau et du Malbec ! ». « Mysticisme et romantisme éternisés dans une musique intemporelle ! » Chaque article disait à peu près la même chose. La danse populaire idéalisée et le barbecue sublimé. À propos des dictateurs et de leurs coups d’État, motus. On s’extasiait d’autant plus sur leurs épouses.
Le voyage tourne court et l’aventurier raté est rapatrié à Guangzhou, temple de richesse chinoise, dans l’hôtel le plus fastueux de la ville, qui appartient évidemment à M. Bo Xiang. Il y a comme un méchant sort qui s’acharne sur ce Tony-ci.
Ensuite, « à huit mille kilomètres de là, un parfait homonyme de Tony Hanssen est lui aussi en train de suer, mais sans remuer », poursuit le prologue. Ce Tony -là tient effectivement en joue un rhinocéros dans un parc animalier sud-africain. L’animal qu’il s’apprête à abattre est sa porte de sortie, son eldorado, ses cornes d’abondance. Il faudra bien ce miracle pour le sortir de l’enfer où l’a plongé la faillite de sa banque. Faillite précipitée par sa faute, sent-il venir, le monde des traders ne faisant pas de cadeau quand il s’agit de gros sous et de clés USB détenant des informations délicates sur de grosses grosses magouilles pour de grosses grosses fripouilles. Le génie algorithmique déchu, devenu un vulgaire braconnier, espère pouvoir mettre un terme à sa cavale grâce à la vente de ces cornes à M. Bo Xiang et surtout d’un coup de talon remonter vers son firmament, persuadé qu’il est de son destin de vainqueur. C’est compter sans la ténacité de l’inspecteur Vusi Khumalo et son appât du gain.

Pour la plupart des personnages de cette histoire, l’argent est le moteur principal des actions. C’est à cause de lui que le premier Tony, alias « le couillon », se fait autant arnaquer, rouler, rouer. Sa vie, depuis qu’il a quitté le cocon familial, froid et bourgeois, est une succession de coups durs et de coups bas, de coups droits aussi parfois. Sans cesse plumé, l’animal volète piteusement d’un endroit à l’autre du globe en cherchant un vain nid, là où ne règne qu’avanie.
En miroir de ce loser magnifique, le winner pathétique, alias « le connard », court après une gloire impossible, tellement aveuglé par l’addiction qu’il ne voit pas qu’il n’a pas les moyens de ses ambitions. Le voilà qui sans cesse s’auto-congratule, dans un ballet minable dont il ne perçoit pas la fin. Engoncé dans sa petite satisfaction, auto-persuadé de sa petite femme et de sa petite fille. Si peu de recul.
C’est surtout le premier Tony qui intéresse. Sa paresse vaudevillesque amuse, sa poisse innocente apitoie. Sa sagesse interroge. L’autre finalement ne dépasse pas vraiment le cliché. Mais leurs trajectoires à tous les deux dessinent un reflet dans lequel la société est conviée à se mirer, parfois avec justesse, souvent avec rudesse, pas toujours avec finesse.
La charge contre l’ultralibéralisme frappe de plein fouet, retourne l’estomac et ravale les petites vies merdiques, qui ne sont pas toujours celles qu’on croit. Par moments pataude, mais le plus souvent humoristique, tapant là où il faut, avec des entrechats de langage savoureux.
Mamounette ! Aucune langue au monde n’a été autant envahie par la moisissure du diminutif que la variante flamande du néerlandais. À tout bout de champ, chacun ajoute sans vergogne les petits suffixes -ke et -je à toutes sortes de mots. Derrière son guichet, un postier vous vendra des envolpkes, un employé de banque vous demandera si vous avez votre kaartje, la « petite carte », ou si vous connaissez par cœur het nummertje, le « petit numéro » de votre compte. Humiliation réciproque sous couvert de politesse. Et toujours, toujours cette puérilité obtuse, même si ces gens jacassent à toute vitesse.
La langue de l’amer en vient presque à manquer. On demande à lire le roman original. On s’amuse pourtant bien vite de la traduction finaude. Puis, on sourit de toute façon, à la bonne formule, à la bonne fortune, qui finit par presque se présenter au premier Tony, le couillon avec qui l’on avait commencé le récit et avec lequel on le termine, sur une énième pirouette rieuse de l’auteur. Une esclaffe heureuse.