Un Ulysse pour rien
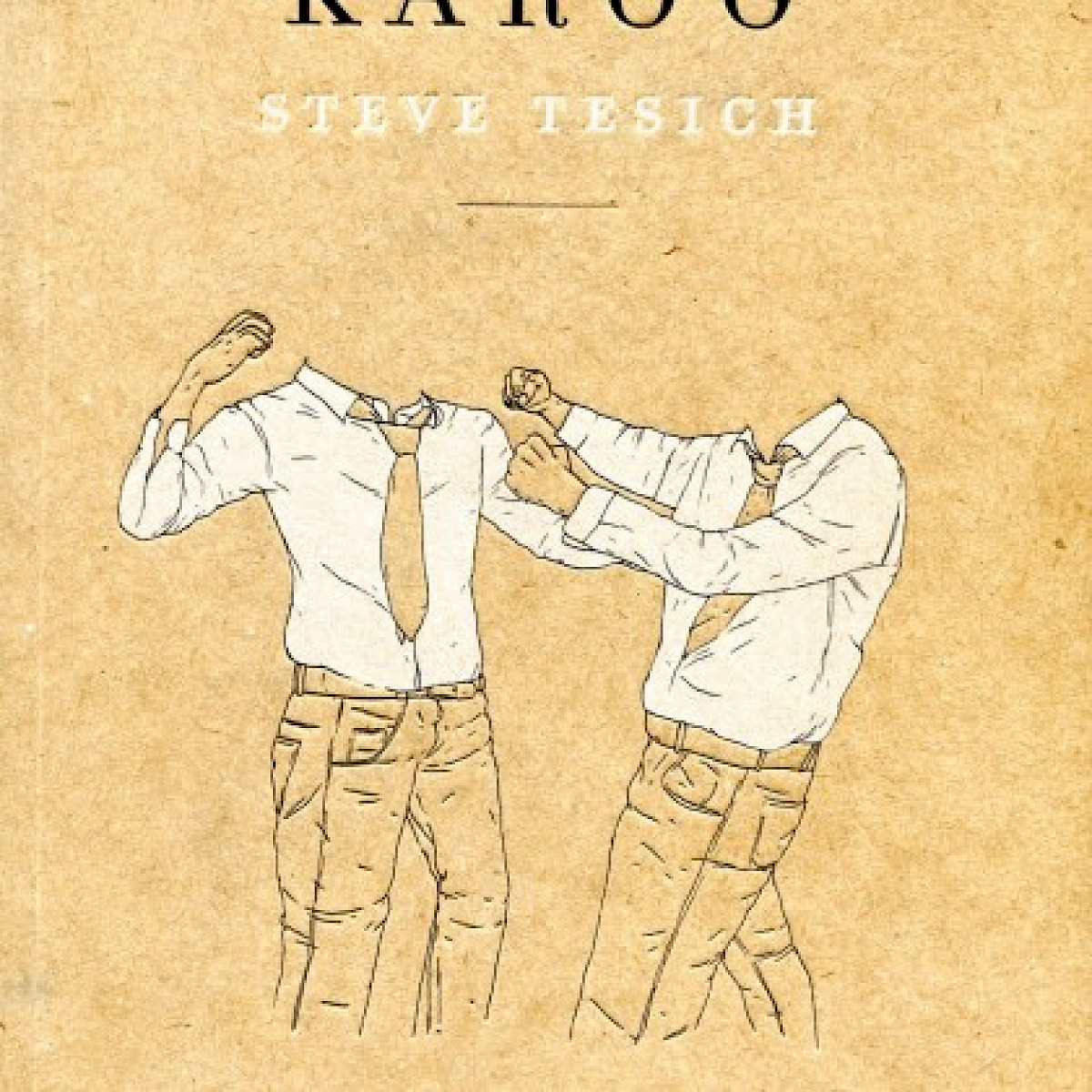
Notes autour de
Notes autour de
Karoode Steve Tesich.
Nous parlons comme dans un talk-show. Il y a un rythme séculaire, tout comme il y a un rythme dans nos rires. Tout est très mielleux et polyphonique, un massage acoustique pour l’esprit. Il n’y a pas de contenu à proprement parler, mais le ton est si agréable qu’il devient le contenu.
1
Pourquoi est-ce que, quand on a commencé de lire, les conversations nous répugnent ? Comme si, à côté du livre aimé, rien ne pouvait résister. Ni dialogue en tête-à-tête ni grande assemblée : seule cette parole muette, recueillie entre les pages d’un bouquin, parvient à nous nourrir, à nous captiver. C’est vrai qu’on prête l’oreille aux échanges des passagers du tram ; aux disputes de nos voisins de table ; aux indications du maître-nageur à la piscine, etc. C’est toujours à quelqu’un d’autre qu’on parle. Précisément comme dans une œuvre littéraire. On observe ; on écoute ; on ne participe pas directement. Attentif, nous nous tenons un peu à l’écart, comme protégé par l’épaisseur d’un volume de silence. Est-ce une maladie ? Au fond, c’est de la lâcheté. Et ce mouvement de fuite de la réalité ne semble jamais vouloir s’arrêter. Au contraire, il s’accélère, se fait chaque jour plus exigeant, absolu, vorace à mesure que nous découvrons les classiques. Qu’ils nous dévorent. Un sentiment de vide nous gagne chaque fois que nous détournons le regard du précieux miel littéraire ; le néant nous fracasse dès que nous devons participer à ce qui se trame concrètement autour de nous : en famille, au travail… et même en amour. Il ne semble plus y avoir un seul endroit reposant sinon dans quelques romans d’envergure planétaire, dans un de ces morceaux de poésie choisi qui nous projette dans les étoiles. Nous sommes devenus des rêveurs. Tout nous blase. Nous sommes las, indifférents au décor, comme séparés.
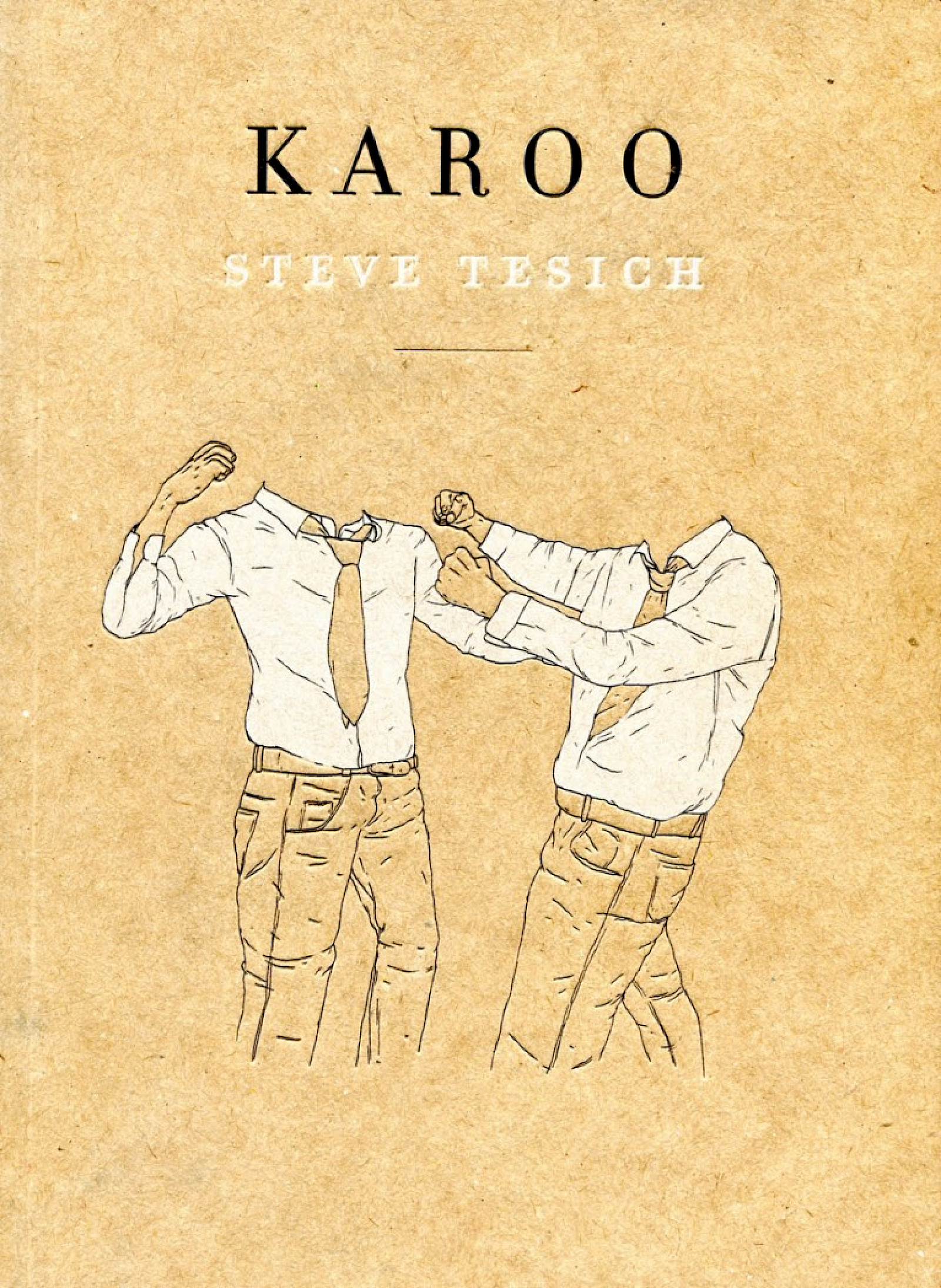
Saul Karoo aime la vie. Tout lui réussit, il est devenu célèbre comme retoucheur de scénario : un des plus fameux sur le marché du film hollywoodien. Il s’obstine à vivre à New York… Non loin de Dianah, son ex-femme de laquelle il n’a toujours pas divorcé pour le plaisir d’encore mimer des scènes de séparations au restaurant, et d’évoquer leurs fils adoptif, Billy, qu’il ne voit jamais mais qu’il prétend aimer plus que tout. Karoo habite seul, dans un appartement luxueux, en célibataire frôlant l’obésité, à taux d’alcoolémie surélevé. Un gros type de taille moyenne : une bête d’égoïsme, une légende de cynisme ! Sauf que quelque chose cloche : il n’arrive plus à être ivre comme avant. La lucidité le poursuit partout, il a beau s’enfiler des litres de gin, de bourbon, de vin ou de vodka, il en est à jouer le mec bourré pour ne pas effrayer les copains de soirées. Quelque chose ne va pas. Mais quoi ? C’est la chute du mur de Berlin et les Américains apprennent à prononcer les noms des dictateurs roumains et des autres membres de leur équipe de loosers. C’est l’histoire vécue en direct sur le petit écran. Le roman s’ouvre sur un Guide phonétique, comme un petit manuel pour convives bien-pensants. La bonne prononciation est le must d’une soirée distinguée. Si on ne connaît rien au fond de l’affaire qui se passe là-bas, du moins pourra-t-on feindre un accent de vérité. L’histoire est en train de changer à la vitesse de l’éclair. Il faut apprendre à cligner de l’œil pour ne pas perdre le fil de l’actualité. Les mots, les analyses, les discours semblent incapables de rendre les nouvelles tendances, alors on fait de l’aérobic et du karaoké en attendant la guerre du Golfe. Saul Karoo court après les nouvelles du monde bien qu’il avoue ne plus rien toucher à ce qui arrive. C’est l’homme aléatoire vivant dans un monde aléatoire. Un être ballotté par les courants qui a depuis longtemps perdu les amarres. On l’aura compris, c’est une sorte de fable sur la déchirure entre actions et paroles, entre temps et espace, entre toi et moi. (Quelque chose de tout à fait désespérant, comme un génocide culturel.) Les moments les plus puissants du bouquin résident dans des descriptions de rues :
72
e
Rue et Broadway. Les exemplaires du
Sunday Times
de demain sont empilés devant le kiosque au coin de la rue. Un flot régulier de personnes les achètent et s’éloignent avec le journal sous le bras. Les trottoirs sont pleins de monde. Des gens qui rentrent chez eux. Qui n’ont pas de chez eux. Toutes sortes de gens.
2
Saul Karoo n’est pas un SDF. À sa façon, cependant, il n’a pas de foyer. Déraciné, il erre. Comme une balle perdue de l’époque. Quelqu’un qui ne peut plus se rattacher à rien, hanté par une absence de fantômes :
Je n’étais plus, me rendis-je compte, un être humain, et cela faisait probablement longtemps que je n’en étais plus un. J’étais devenu, au lieu de ça, un nouvel isotope d’humanité qui n’avait pas encore été isolé ou identifié. J’étais un électron libre, dont la masse, la charge et la direction pouvaient être modifiées à tout moment par des champs aléatoires sur lesquels je n’avais aucun contrôle. J’étais l’une des balles perdues de notre époque.
3
La note de présentation précise que Stojan Tesic, alias Steve Tesich, est né en 1942 dans l’actuelle Serbie. Il est écrit que « son premier roman, Summer Crossing , paraît en 1982 et rencontre un succès international. En 1996, alors que son regard sur les États-Unis a changé du tout au tout – passé de l’utopiste rêveur qu’il était en arrivant à un critique amer et déçu –, Steve Tesich s’éteint après avoir achevé son chef-d’œuvre posthume, Karoo. »
Celui qui se scandalise est toujours banal : j’ajoute qu’il est également toujours mal informé. On comprend maintenant qu’il n’y avait pas la moindre raison de s’étonner devant l’espèce de monstre qui occupe aujourd’hui le rôle de président américain. Les situations et les individus dépeints dans ce livre nous plongent au cœur du mensonge érigé en système. C’est le faux généralisé. Le spectacle permanent est bien la religion unificatrice du XXI e siècle, l’ère des « Je » interchangeables. ( Les pensées qui m’agitent ne sont pas nécessairement les miennes. Elles pourraient être les pensées de n’importe qui. Je pourrais être n’importe qui. N’importe quelle personne . 4 ) Bien sûr, Saul Karoo est aux avant-postes de cette transformation complète de la réalité. Ou plutôt, de cette crise complète de la réalité. Il réécrit des scénarios ratés, c’est-à-dire invendables, pour en faire de parfaits produits de consommation. Il coupe, colle, monte, remonte et le tour est joué. Lui-même n’est pas un auteur et ne se croit aucun talent d’imagination. Il admire l’art comme un miracle. Il ne se pense pas capable de créer quelque chose de valable. Raison pour laquelle il bricole en toute objectivité les films des autres en somnambule efficace, quitte à trahir complètement l’idée originale. Mais ce qu’il y avait à la base dans la tête d’un authentique scénariste, qu’est-ce que ça représente ? Ce qui compte, c’est ce que désire le producteur, celui qui détient les droits, celui qui espère en avoir pour son argent ! Alors il n’y a plus de limite. Défaire c’est aussi faire. La mascarade triomphe jusque dans la vie privée des personnes qui œuvrent à inventer les nouvelles règles du jeu. Tout est fiction. Plus rien que des apparences, pas des êtres humains mais des images ambulantes. On croirait lire une mise en scène des réflexions d’Adorno sur la vie mutilée : Le film a réalisé si intégralement la transformation des sujets en fonctions sociales que les victimes, ne se souvenant même plus d’aucun conflit, jouissent de leur propre déshumanisation comme quelque chose d’humain, comme d’un bonheur qui réchauffe. La cohérence totale de l’industrie culturelle – qui ne laisse rien de côté – ne fait qu’un avec l’aveuglement social total. 5 Et pour que cela marche, il faut prendre soin des hommes comme Saul Karoo. Pas le moindre obstacle ne doit se présenter devant eux : la société de services et ses innombrables petites mains anonymes est là pour répondre à leurs plus infimes angoisses. Il y aura toujours un Brad au bout du fil pour régler vos problèmes de transports avant votre départ, comme il y aura toujours une Maria pour faire le ménage derrière vous…
Cette version de lui était tout aussi valide que son contraire ou que toute autre version entre les deux. La beauté des banalités, comme Saul était en train de le découvrir, c’était qu’elles vous permettaient d’être quelqu’un un moment. L’horreur de la vérité, c’est qu’elle ne vous le permettait pas.
6
Il peut aussi arriver que le cinéma et la réalité se rencontrent autrement. En la personne de Leila Millar, par exemple. Et là, c’est un film différent qu’il faut écrire ; c’est une antique histoire d’amour à vivre avant qu’elle ne devienne récit post-moderne, puis ne sombre aussitôt dans le néant. On ne sait plus alors s’il s’agit d’une tragédie, d’une comédie ou d’une farce. Impossible de dire si tout est trop cool ou si nous avons définitivement coulé, et depuis quand ?