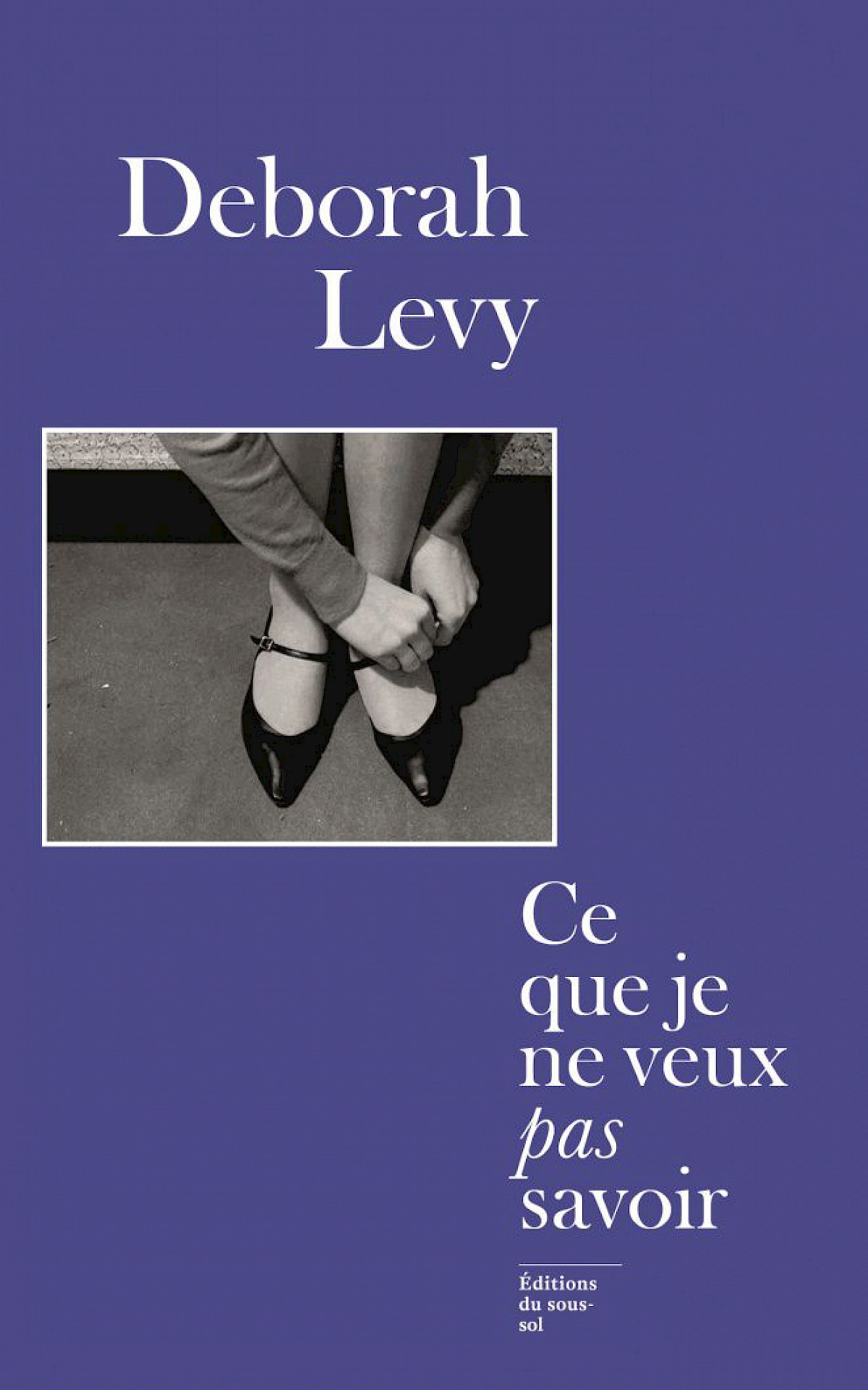
C’est l’histoire d’une femme qui fond en larmes sur des escalators sans comprendre pourquoi. On se posera la question tout au long du livre dans lequel on prend ses pensées comme des confidences, de son enfance en plein apartheid à l’âge mûr solitaire.
Ces escalators m’ont fait penser au premier épisode de Cœur sur la table , un podcast de Victoire Tuaillon. Cette idée de cocher toutes les cases de ce qu’on attend socialement de nous, pour s’élever vers le palier supérieur sans que ne sache trop si on le souhaite vraiment ni pourquoi on le souhaiterait. Les larmes nous montent aux yeux comme un corps qui décide de se révolter seul contre l’absurde de la situation. La femme qui nous parle fuit sur un coup de tête, laissant là sa vie entre parenthèses comme on a peut-être parfois pensé le faire. Elle se réfugie à l’ombre d’un arbre insulaire, où lui remontent à l’esprit puis à la main, ses souvenirs. Peut-être est-ce là le véritable parallèle à faire avec les escalators ? Ces souvenirs qui remontent comme un reflux gastrique ? Elle nous parle d’abord de son père, membre de l’ANC ‒ le parti de Nelson Mandela opposé à l’apartheid ‒ emprisonné pour ses opinions politiques et ensuite l’exil de sa famille en Angleterre. On comprend bien là qu’il ne s’agit pas du seul exil de sa vie et que, peut-être, comme dans les nôtres, il y en a plusieurs.
Deborah Levy alterne entre un regard adulte et un regard d’enfant sur le monde qui l’entoure. On ne sait pas réellement dissocier les deux, tant l’enfant parait adulte et l’adulte, un peu enfant dans ses peurs et sa façon de fuir, comme on se cache sous les draps en imaginant des loups féroces dans les armoires. Une constante cependant : son regard ne tronque presque pas le témoignage qu’elle fait des gens et des choses, elle ne les efface pas par son jugement, elle nous les rapporte intactes et leur laisse la place d’exister, de s’animer seuls dans notre tête. Peut-être que son arme dans ce monde très vite vécu comme un lieu violent et injuste était de l’observer, de le comprendre et d’apprendre à en rire ?
J’ai voulu la comparer à d’autres auteures que j’avais lues comme si une auteure femme n’avait pas droit à sa singularité elle aussi, ne pouvait exister que dans la collectivité de sa condition. Elle parle depuis celle-ci, sans s’y limiter : forcément ‒ et c’est inévitable ‒, elle s’invite par sa plume comme une femme avec cette expérience particulière que l’on fait toutes différemment. Ça ne la limite pourtant pas puisqu’elle aborde des sujets universels : le monde, les gens, la vie, la politique intrusive qui régit tout, jusque dans nos assiettes.
Elle n’a aucune volonté d’adopter une posture quelconque, de performer l’écrivaine ou la « féministe », de politiser sa plume ‒ peut-on parler de politique sans faire une œuvre politique ? Peut-on être une auteure sans que notre livre par sa simple existence ne soit politique ?
Cette plume sincère, dont la candeur ferait presque oublier le dessin qu'elle fait de la gravité du monde, la simplicité et la puissance des images qu'elle nous offre sans effets de verbe ou détours poétiques, fait toute la force de Ce que je ne veux pas savoir . L’efficacité anglo-saxonne : dépouiller les phrases des circonvolutions littéraires, dire beaucoup en peu de mots, en quelques images. Tout cela témoigne de la maîtrise de Deborah Levy, de sa capacité à nous transporter, à nous faire monter dans sa cabine de TGV pour une lecture ininterrompue jusqu’au point final.
On ne saura jamais pourquoi la femme pleurait sur les escalators, mais est-ce là le plus important ?