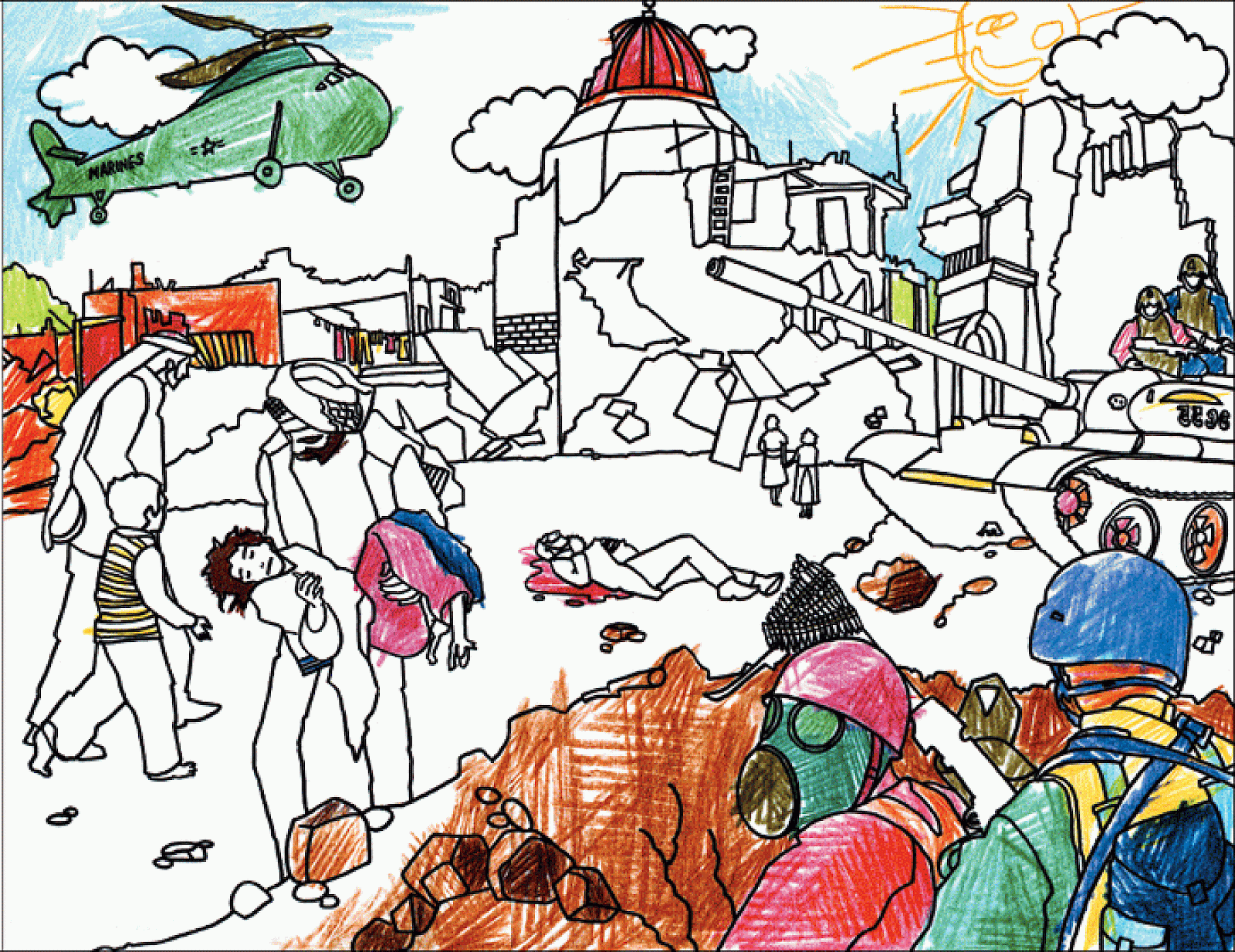L’usage du faux (2)
Nicolas Marchal poursuit pour Karoo sa série d’articles intitulée
« l’usage du faux », réflexions sur la fiction et ses frontières, ses infinis, ses jeux de miroirs.
Après s’être frotté au Réel
, voici le deuxième épisode : où l’on se demande si écrire, c’est mentir ?
« Et depuis quand sais-tu que tu es un artiste ?
— Depuis pas mal de temps. Je suis allé à un concert, il y a deux ans. C’était magnifique ! Ce type jouait et il en avait les cheveux qui lui tombaient sur le clavier. C’est là que j’ai compris. Attends, murmura-t-il mystérieusement avec un soupir, mets la main sur mes tempes ! Tu ne sens rien ?
— Quoi ? » Mes doigts ne palpaient que ses cheveux frisés et épais comme le pelage d’un caniche.
« Tu ne sens pas comme j’ai les tempes bombées ? » Et il ajouta avec nonchalance : « C’est le signe d’un talent musical hors du commun. C’est bien connu. »
Karel Capek,
la Vie et l’œuvre
du compositeur Foltýn
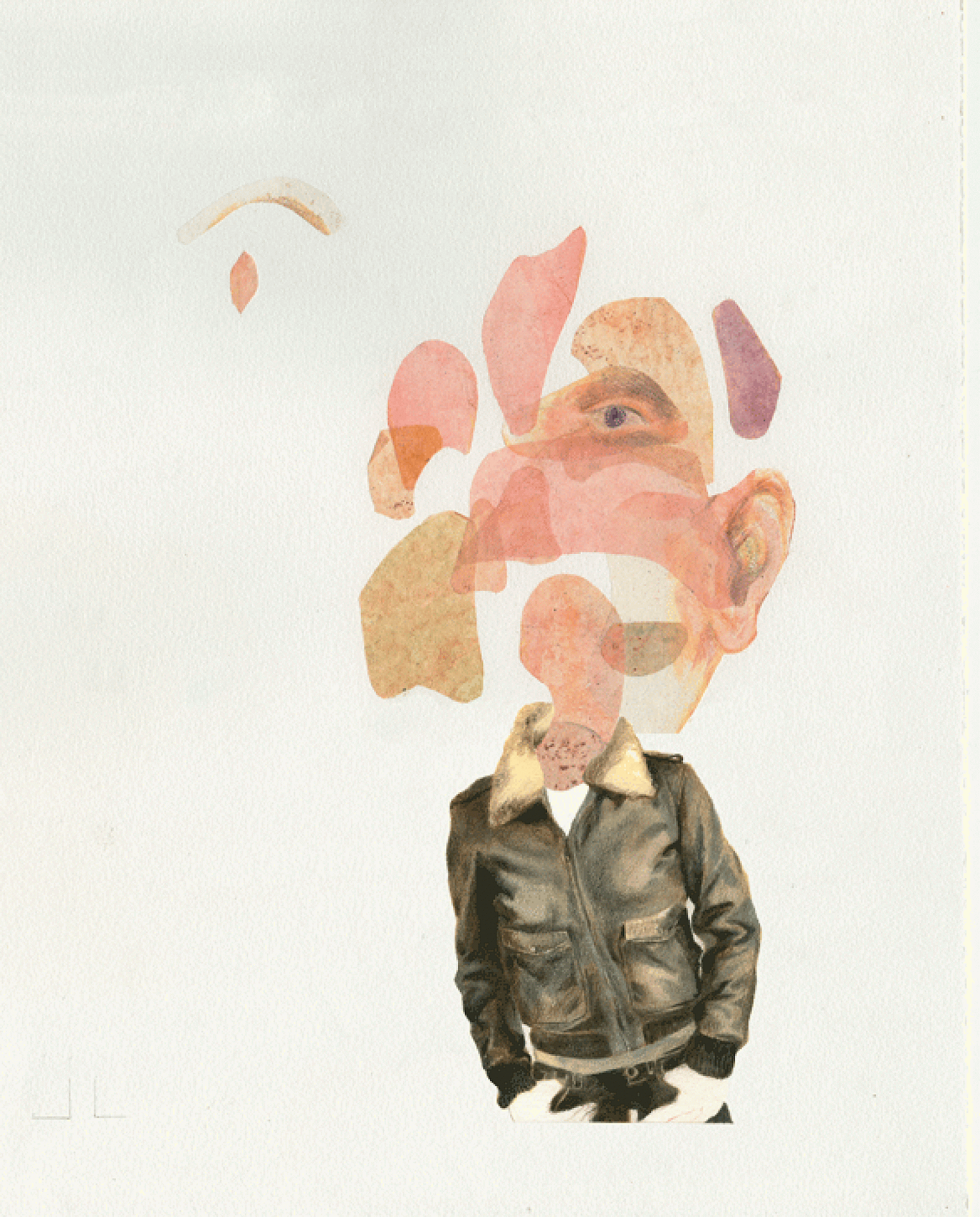
On ment tous les jours. Celui qui affirme le contraire est sans conteste le plus fieffé menteur de tous, et rien ne m’inquiète tant chez mes contemporains que le masque de leur probité. « Il faut mentir ou mourir », disait Céline. Mais nous ne sommes pas tous égaux dans ce domaine. Certains mentent sans brio, d’autres avec génie. Et puis, les occasions qui se présentent à nous offrent des possibilités très diverses. Untel est recherché par les carabiniers italiens, cavale à travers la montagne, trouve refuge dans un petit village.
À son arrivée, il se présente comme le nouveau curé, et est accueilli à bras ouverts par les bigotes abandonnées. Que de mesquins petits mensonges, fagotés à la hâte, ne devra-t-il pas subir ensuite dans le confessionnal pour sa pénitence, ce divin menteur, froqué pour le compte. Un autre tel parvient à faire croire à toute une famille qu’il est le fils disparu depuis des années – il faut voir le documentaire
The Imposter
de Bart Layton pour suivre de l’intérieur le minutieux travail du mensonge. L’histoire est pleine d’habiles clochards parvenant à se faire passer pour papes et d’authentiques princes en déroute que personne ne veut reconnaître. Ou le contraire. Ulysse trompe tout le monde, sauf sa vieille servante, et son chien. Dans la petite ville de Namur – je vous parle d’une ville qui jure ses grands dieux être le lieu où l’on inventa la frite –, il existe une rabelaisienne confrérie de « buveurs très illustres » et de « vérolés très précieux » qui organise des concours de menteries.
Les menteurs s’installent tour à tour sur un siège taillé dans la pierre, sur la place du Théâtre, et débitent les meilleurs mensonges qu’ils peuvent. À quelques centaines de mètres de là se tient l’assemblée du Parlement wallon.
Puisque le mensonge se fait avec la langue, on est en droit d’attendre des écrivains qu’ils portent le mensonge à son plus haut degré de perfection. C’est même leur devoir. Bien entendu, la qualité du mensonge dépend du talent du menteur (des moyens dont il dispose) et de la naïveté de celui qui l’écoute (et donc de la paresse du menteur qui, quand il s’adresse à un ingénu, ne prend pas la peine de peaufiner ses mensonges). C’est pourquoi certains romans regorgent de personnages (de dialogues, de situations, de phrases pour tout dire) qui sonnent si évidemment faux ; c’est pourquoi certaines interviews d’auteurs sont farcies de déclarations fabriquées pour l’occasion avec de si grosses ficelles, et qui « font » écrivain autant que la baguette sous le bras fait le Parisien : peu de moyens, peu de courage. Mais intéressons-nous aux écrivains qui mentent bien, qui sont naturellement doués pour cela et qui ne rechignent pas à la tâche.

Il y a autant de manières de bien mentir qu’il y a de bons écrivains – et donc de raisons d’espérer que la vie vaut la peine d’être vécue. Bon nombre de livres nous offrent l’occasion de jouir du mensonge bien troussé. Il y a de magnifiques histoires de mensonges, comme celle, issue des fabliaux du Moyen Âge, des Trois Aveugles de Compiègne , où des mendiants aveugles se font berner par un plaisantin (ah, la belle époque où une blague pouvait tenir lieu d’argument) qui affirme leur avoir donné une belle pièce : chacun pense que c’est l’un des deux autres qui l’a dans sa sébile, et ils vont à l’auberge, et mènent grand train, car ils sont riches. Les personnages qui mentent nous ressemblent, ils sont donc vrais, et quand ils mentent bien, ils nous passionnent. Mais il faut bien reconnaître qu’une part importante du mensonge est alors détruite : l’expérience. Les histoires mettant en scène des menteurs nous scandalisent ou nous font rire, mais nous sommes alors bien loin du mensonge : nous y assistons comme au spectacle. Il est des écrivains qui vont plus loin : ils ont tourné leur livre vers nous.

Ainsi, on peut signaler quelques narrateurs qui font partie de cette vaste et vigoureuse famille que David Lodge appelle, dans son Art de la fiction , celle du « narrateur peu fiable ». Dans son essai, Lodge ne cherche pas à épuiser le sujet, pas plus qu’il ne prétend identifier une technique formelle comme une autre, qu’il conviendrait de repérer, comprendre, et utiliser quand on en aurait besoin. Lodge est stupéfié par les potentialités de la fiction, et il s’efforce de rendre compte de ses bonheurs de lecture le plus simplement possible. En partant du jeu raffiné, presque pervers, que jouent avec le lecteur les narrateurs des Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro et de Feu pâle de Vladimir Nabokov, il tire des conclusions plus générales sur ces livres qui nous tendent des pièges délicieux. Il en va ainsi des narrateurs fous, des narrateurs amnésiques, des narrateurs impartiaux, des narrateurs menteurs. Des narrateurs humains, enfin.
L’intérêt du roman ou de la nouvelle se déplace de l’histoire à la manière dont elle nous est racontée, des caractéristiques des personnages à tout ce que nous pouvons déceler chez ce personnage diaboliquement incontournable qu’est le narrateur à travers la façon dont il parle des autres, mais aussi à travers le choix de ses mots, ses brusques colères, ses oublis et ses évitements, ses erreurs et ses excuses. Le moindre détail est révélateur, et s’adresse à nos émotions et notre intelligence, parce qu’à aucun moment – et ce désespoir est une des sources obscures de notre plaisir – nous ne serons sauvés par l’intervention d’un narrateur extérieur, omniscient, qui viendrait par-dessus le narrateur peu fiable pour confirmer ou infirmer ses dires. Ce sont des livres qui nous lâchent la main, et nous laissent seuls dans la furie de la grande ville.
Les éditions Sillage viennent, il y a peu, de republier le chef-d’œuvre inachevé de Karel Capek, la Vie et l’œuvre du compositeur Foltýn . Il convient d’ailleurs ici de rendre hommage au superbe travail de cet éditeur qui extirpe chaque année de la vase une brassée pleine de pépites – il y aurait d’ailleurs beaucoup à médire sur la gestion de certains catalogues, quand on voit les romans géniaux qui ne sont plus disponibles et les proses mort-nées qui sont publiées sans honte, on se dit que c’est plus certains éditeurs que les livres qui finissent épuisés. Passons, et encore merci à Sillage. Capek donne donc la parole à tous les amis, proches, rivaux, de cet étrange personnage qu’est Bedrich Foltýn. Ces narrateurs multiples dressent le portrait mosaïque, joyeusement incohérent, d’un homme qui voulait passer pour un grand artiste, et le lecteur ne peut assurer jusqu’à quel point il est lui-même mystifié.
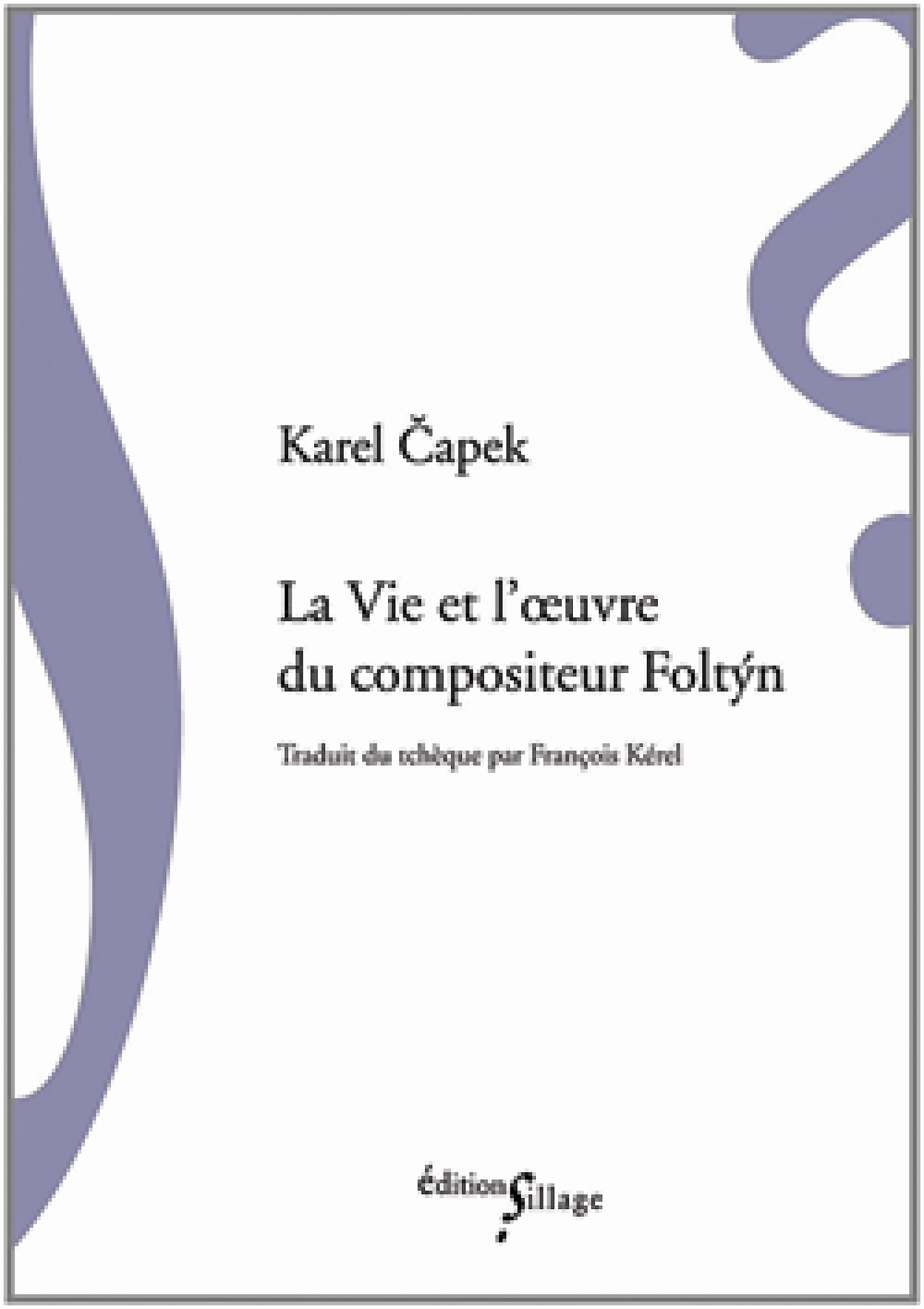
« Car le diable aussi se mêle d’art et y fait des contrefaçons. Il est aisé de le reconnaître, car il est par nature ambitieux et vaniteux. Il tire son orgueil de la matière, de l’originalité ou du tour de force ; […] tout ce qui dans l’art est facilité, clinquant, complaisance, ce sont là les vieilles paillettes volées de sa vanité simiesque. Partout où travaille l’artiste et partout où l’homme tente de se surpasser, rôde l’esprit malin ; il cherche l’occasion de se manifester, de te tenter, de te posséder. Étant lui-même incapable de créer, il cherche à s’emparer de toi. Afin de gâcher ton œuvre, c’est toi qu’il gâche et ronge par le dedans en profitant de ta suffisance et de ta fatuité. »
Foltýn est un escroc, mais peut-on faire confiance à ceux qui parlent de lui, qui bien souvent ont été fascinés par sa personnalité ou qui le haïssent à mort ? Le lecteur, pris dans les rets du texte, ne peut rien jeter : il doit tout prendre.
Cette famille du « narrateur peu fiable » est pleine de cousins stupéfiants. Les romans de Paul Emond, par exemple, nous font trembler sur nos bases et ressentir la littérature, parce qu’ils se déploient à travers des narrateurs qui nous tiennent à la gorge. Celui de la Danse du fumiste est un peu trop amoureux du langage pour ne pas être suspect quant aux faits qu’il prétend relater ; celui de Plein la vue nous affirme fièrement être un menteur professionnel ; celle de Tête à tête a manifestement une santé mentale bien fragile. Et nous vivons ces livres parce qu’ils ne parlent pas de l’éloquence, du mensonge ou de la folie : ils en produisent. Ils en sont.
Quand Luigi Malerba, dans la Planète bleue , aborde son deuxième chapitre en contredisant le premier, il nous fourre dans un somptueux traquenard. C’est que le narrateur du premier chapitre nous dit qu’il va lire les carnets d’un type qui a occupé son appartement, et que le texte de ces carnets constitueront le chapitre suivant, alors que le narrateur de ce deuxième chapitre (l’auteur des carnets) affirme quant à lui que l’appartement lui appartient. Le doute s’installe. Deux narrateurs se prétendent chacun le plus valable. Et cette concurrence va devenir de plus en plus échevelée au fil du texte, tant et si bien qu’à la fin du livre, après trois postfaces jouissives et contradictoires de l’auteur, le traducteur, qui tenait à expliquer les difficultés du texte, doit presque signer avec son sang la promesse de ne pas être un ultime avatar de narrateur. Bien entendu, il y a les Fleurs bleues de Queneau. Le diable danse avec moi de Patricia Melo. L’insurpassable Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme de Lawrence Sterne. On pourrait multiplier les exemples de ces romans qui assument pleinement, et jusqu’au bout de leurs virgules, le fait d’être de la fiction, mais tout ceci a déjà été écrit bien mieux par d’autres que moi, aussi je préfère m’arrêter ici, conscient qu’à force de trop embrasser j’étreins mal, et conscient aussi que je vous ai suffisamment excités, que vous êtes chauffés à blanc, impatients que cet article se termine pour vous ruer chez votre libraire, lui arracher des mains un des romans précités, et entrer dedans comme on se laisse dévorer tout cru, tout vif, et souriant d’extase.