Marie NDiaye,
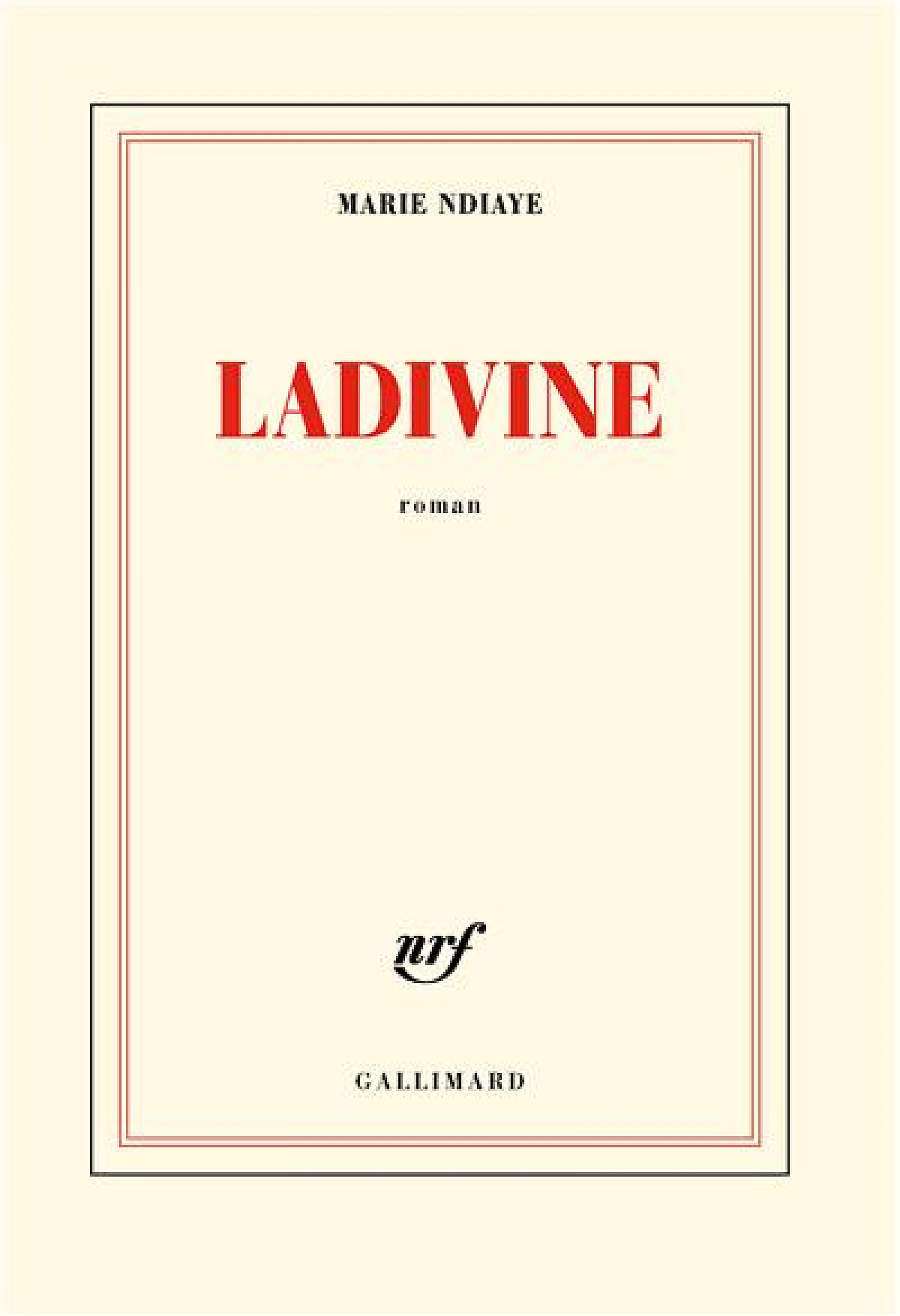
Lauréate du prix Goncourt 2009 pour Trois Femmes puissantes , Marie NDiaye revient avec Ladivine , un nouveau roman lumineux d’étrangeté. Avec une intensité magnétique, l’auteure raconte l’histoire douloureuse de femmes qui, de mère en fille, n’arrivent pas à échapper à une malédiction héréditaire.
Il aura fallu attendre quatre années pour enfin découvrir Ladivine , le quatorzième roman de Marie NDiaye. À quarante-cinq ans, l’écrivaine apporte une nouvelle contribution à une œuvre déjà riche et largement reconnue par la critique et le public, sans rompre avec ses thèmes de prédilection. Il y est question de destin familial, de solitude, de tâtonnement, de détachement affectif, mais aussi de meurtres et de prostitution, de sentiments violents, de déchirements intérieurs qui donnent le tournis, font basculer dans l’horreur.
Ladivine est le récit d’une lignée féminine qui se déploie sur trois générations. Femme de ménage à Bordeaux, Ladivine Sylla partage son temps entre son travail, sa fille unique Malinka et le fantasme qu’un jour l’homme qui l’a abandonnée reviendra. De son côté, Malinka nourrit depuis toujours un sentiment de honte envers sa mère, qu’elle surnomme « la servante » et qu’elle ignore en public. Du jour au lendemain, elle décide de s’en aller pour entamer une nouvelle vie. Elle se marie, change de ville, change de nom. Elle s’appelle désormais Clarisse Rivière et rend visite à sa mère tous les mois, mais en secret, sans le dire à personne, s’efforçant de maintenir son passé dans l’ombre. Mener une double vie est pesant, et la culpabilité la dévore, l’empoisonne constamment.
Mais, pensait-elle la gorge nouée, si votre mère mérite amplement votre amour et que vous ne le lui donnez pas, que vous le gardez soigneusement par-devers vous, que penser d’une personne pareille ? Si votre mère vous fait honte et que vous la tenez en dehors de tout ce qui vous concerne, qui êtes-vous donc ?
Plus tard, Malinka/Clarisse connaît à son tour l’expérience de la maternité, et l’on retrouve sa fille, également prénommée Ladivine, professeure de français à Berlin, elle-même mariée et mère de deux enfants, mais tiraillée par le doute, incapable de se sentir tout à fait à l’aise dans sa vie sentimentale et familiale. Elle reste en retrait, n’arrive pas à s’impliquer affectivement auprès de ses proches.
Elle avait honte d’elle-même, se disant que l’homme et les enfants ne faisaient qu’exiger d’elle ce qu’ils étaient en droit d’attendre, qu’elle ne leur donnait que ce qu’il était légitime qu’elle leur donnât et que, la vie de famille étant ainsi, elle se devait de s’y plier sans peur ni vains regrets […]
Avec Ladivine , Marie NDiaye érige une nouvelle fois l’impuissance, l’inaptitude à mener sereinement son existence, en sujet romanesque et nous confronte à la reproduction de ce sentiment au fil du temps, à son passage entre générations. Surtout, ce qu’on admirera dans ce texte, c’est la présence diffuse d’un merveilleux cauchemardesque, la description de vies ordinaires et pourtant subtilement troublées, côtoyant de près des sphères inquiétantes, presque fantastiques. Un « réalisme magique » dont l’auteure est coutumière, mais qui est ici particulièrement efficace car distillé à petites touches.
Clarisse Rivière se sentait flotter au gré du flux et du reflux d’une onde chaude, épaisse dont la masse contrariait tout mouvement qu’elle eût pu tenter. Au reste elle ne désirait pas bouger car elle aurait mal, horriblement mal, elle le savait, si elle essayait de se déplacer. Elle ne pouvait se rappeler si elle était assise ou débout, allongée ou accroupie, dehors ou chez elle, mais peu lui importait. Il lui fallait faire confiance à l’obtuse mais sûre persévérance du flot dense qui l’entraînait […]
Lors d’une interview accordée à France Culture en février dernier, Marie NDiaye avouait son admiration pour Mulholland Drive de David Lynch : C’est le film qui m’a fait le plus d’effet, c’est le film qui m’a le plus profondément bouleversée de tous ceux que j’ai pu voir, des centaines de films que j’ai pu voir. À bien y regarder, Ladivine reprend à son compte le principe narratif qui a fait le succès du film de Lynch : une rupture se produit en plein milieu du récit, brusquement et pour une raison comparable, et tout ce qui vient ensuite constitue une sorte de variation sur un même thème. Mais on ne peut résumer le rapport entre ces deux œuvres à cette seule idée directrice. Elles partagent également une même ambiance, un même sentiment d’étrangeté. Quoique moins spectaculaire et délirant, le roman de Marie NDiaye baigne en permanence dans une atmosphère lourde et engluée, pleine de chambres d’hôtel poisseuses, de zones industrielles, de pizzerias bon marché, de rues délabrées et de vitrines sales. La chaleur, l’humidité, la lassitude et la fatigue enveloppent tout, jusqu’à l’écœurement, jusqu’au dégoût.
Ils mangèrent, debout, un morceau de pizza face à l’arrêt de bus puis entreprirent de sillonner le quartier, se fiant pour diriger leurs pas aux indications à la fois enthousiastes et vagues du seul guide de la ville qu’ils avaient trouvé à Berlin et qui s’avéra ne rien décrire ni sembler connaître de ce qu’ils voyaient mais ne dépeindre que ce qui n’existait manifestement pas ou plus, évoquant tout à la fois une atmosphère de prospérité décadente et d’exotique désinvolture de la pauvreté, quand une indigence contemporaine toute de plastique et de tôle surmontée d’antennes paraboliques, et une certaine apathie presque entièrement dénuée d’alacrité, de sourires, d’espoir, étaient bien plutôt ce qu’ils découvraient, eux, et qui semblait à chaque coin de rue atteindre un peu davantage le moral de Marko, non pas vraiment, se disait-elle, parce qu’il se serait formé naïvement d’illusoires images d’une ville en réalité froide, sans mystère, râpée jusqu’à l’os, mais parce que, négligeable intrus dans ce milieu âpre et fermé, il se demandait peut-être ce qu’il était venu faire là […]
La phrase est longue, tortueuse, contournée, comme composée intuitivement, à la Faulkner, avec toujours un léger décalage par rapport au sentiment qu’elle exprime, toujours un côté surprenant, presque étourdissant. Rien n’est tout à fait conforme chez Marie NDiaye, rien n’est tout à fait familier. Ce qui relève du domaine de l’ordinaire est bizarrement déréglé, sans effort, sans outrance d’aucune sorte, comme si un pas de côté, rien qu’un, suffisait à révéler les choses sous un angle différent. Contrarié dans ses attentes, le lecteur ne peut échapper à l’infime détournement du socle commun des sensations. Il avance à tâtons, sans être bien certain de ce qu’il lit, de ce qu’il s’apprête à lire.
Car le monde qui est donné à voir par Marie NDiaye est un monde ambigu, qui repose sur des situations dont le sens n’est jamais facile à interpréter, un monde où tout est prêt à basculer, mais qui se maintient dans une tension perpétuelle. Il y a ces chiens, par exemple, dont la présence latente est tellement curieuse qu’il nous arrive parfois de penser à de la littérature canine, ces chiens qui se déplacent aux côtés des personnages comme des apparitions, et qui renvoient tout à la fois à la dangerosité d’une menace et à la veille rassurante d’une sentinelle.
Cependant, pas une fois depuis le début elle n’avait éprouvé de peur ni de malaise, bien qu’elle eût compris très tôt que le chien la suivait pas à pas et qu’elle ignorât tout de ses intentions.
Elle s’abandonnait, peut-être excessivement pensait-elle parfois, à ce sentiment de confiance qu’il lui inspirait.
Mais elle était fatiguée de se méfier, d’anticiper le pire, de craindre l’avenir pour ses enfants, de craindre pour ses enfants la vie elle-même.
Tout est comme ça, dans Ladivine : tout est douteux, tout est dangereusement suspect. Le sentiment d’angoisse et de malaise dont le lecteur ne peut se départir monte en puissance au fil des pages, précisément parce qu’on ignore d’où il vient, précisément parce qu’il émane de tout. Il se nourrit des silences, du confinement, de l’obscurité et des ombres, de l’attente insoutenable de quelque chose. Il reste vague, sans objet, mais pourtant l’implosion n’est jamais loin. Comme de l’eau sur le feu dont la surface se ride peu à peu, juste avant de bouillir.
Cet article est précédemment paru dans la revue Indications n o 397.