« Risque et désir vont de pair »

Si vous avez lu l’article que Mathilde Alet a consacré, la semaine dernière, au nouveau recueil de nouvelles d’Aliénor Debrocq, À voie basse , vous avez certainement envie d’en savoir plus sur cette jeune auteure belge : Karoo exauce vos vœux !
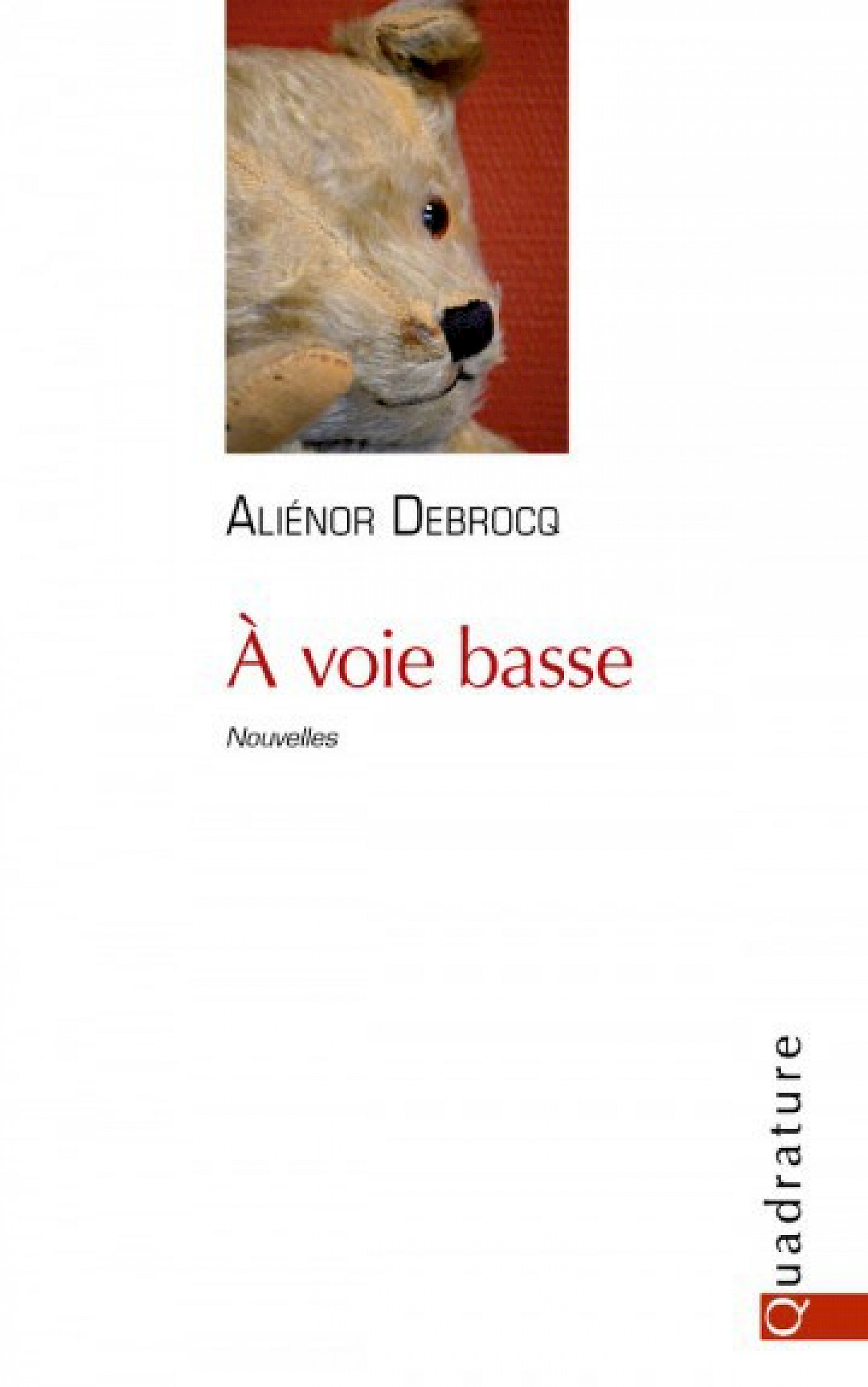
Toute la première partie de ma grossesse, j’écrivais un roman qui n’avait rien à voir avec ce que je vivais, parce que c’était l’accomplissement d’un projet mis en chantier bien avant de tomber enceinte. L’été, j’étais en résidence d’écriture en Camargue et, tous les jours, je me rendais compte que pendant mes temps d’écriture, je ne songeais pas du tout à mon corps, alors en complète mutation. C’était comme une scission radicale entre corps et esprit. Je travaillais à une grande table en bois, assise sur une chaise en paille assez inconfortable, et chaque fois que je me levais pour aller faire pipi, regarder par la fenêtre ou boire un verre d’eau, je me reconnectais à mon corps et je me laissais aller à penser à cette grossesse naissante avec euphorie, crainte, etc. Mais c’est vrai que j’avais emporté avec moi ce livre de Nancy Huston qui traînait dans la bibliothèque depuis des années, dédicacé, Journal de la création. Synchronicité ? Elle y tient elle-même un journal de sa seconde grossesse, dans les années 1990, bien plus intellectuel que le mien soit dit en passant ! Plus tard cet automne-là, j’ai lu Bad Girl , qu’elle venait de publier et dans lequel elle raconte l’histoire de ses parents, comment sa mère a très mal vécu l’arrivée de ses trois enfants et a finalement choisi de les abandonner quand elle avait six ans.
La maternité, dans À voie basse , est souvent présentée comme un tournant radical : on laisse derrière soi des amitiés, des illusions, une autre peau ?
À six mois de grossesse, j’ai entamé l’écriture de ce journal, À voie basse. C’est aussi le moment où j’ai commencé à ne plus pouvoir échapper au thème de la maternité. Je ne l’ai pas voulu, ça m’est tombé dessus, c’était un conditionnement impossible à endiguer, comme le racontent certaines des nouvelles qui composent ce livre. Je n’ai jamais été particulièrement convaincue qu’avoir des enfants fait partie des choses nécessaires dans la vie d’une femme pour se réaliser. J’ai au contraire longtemps privilégié mes études, mes perspectives professionnelles, et aussi l’écriture. Et puis arrive la trentaine. Et le monde change autour de vous, très près de vous, sans que vous l’ayez mesuré. Je n’avais rien anticipé à ce propos quand je suis tombée enceinte, mais c’est vrai que je baignais déjà dans cette thématique (même si je n’aime pas ce mot) depuis un moment. Et puis un soir où je végétais dans le hall de Cavell avec trente autres couples, j’ai commencé à imaginer une histoire, celle d’un type qui hanterait tout seul les séances d’informations prénatales. C’est de là qu’est né le désir de ce livre, et sa nécessité. Pour survivre au mainstream dans lequel j’avais peur de me noyer. La layette et le rose bonbon, très peu pour moi. Plutôt le rose névrose, comme le clame le titre d’une nouvelle. C’était une façon de digérer et de recracher tout ce que j’entendais autour de moi, mais aussi de sauver quelque chose des mille et une conversations que j’ai eues avec mes amies, de témoigner de ce bouleversement radical que nous expérimentions toutes au même moment, à peu de choses près. Et finalement, ce livre est pour moi tout autant centré sur l’amitié, la solidarité et la complicité entre femmes que sur la maternité. Plusieurs nouvelles en parlent énormément.
C’est un livre qui possède aussi un ancrage réel très précis, facile à dater, à relier à un certain contexte, mais ça ne me dérange pas, parce que la maternité c’est ça aussi, faire l’expérience radicale de sa propre temporalité, de sa propre mortalité. À partir du moment où l’enfant paraît, on se met à compter les mois et les années en fonction de lui et plus de soi. Annie Ernaux aussi parle de ça.
Le thème de la maternité n’empêche pas, d’ailleurs, que l’on retrouve un regard acerbe posé sur la société et ses travers : elle ne parvient jamais à t’enchanter cette société ?
Le recueil a été écrit en deux temps, fin 2014 et puis fin 2015 début 2016. Avant la maternité et puis un an après, avec de rares reprises entre les deux, bébé oblige. Et si j’ai écrit de façon si noire sur la société, c’est parce qu’on était en plein dans le contexte des attentats de Charlie Hebdo, de ceux de Paris et du lockdown de Bruxelles, que j’évoque à deux reprises je crois. Or ce que j’ai découvert pendant ma grossesse, c’est l’immense besoin de sécurité, de nidification, qui est certainement hormonal et qui s’explique facilement quand on attend un bébé. Et soudain, tout autour de moi, très près, se passait tout le contraire de ça. Je ne suis pas quelqu’un de très optimiste en ce qui concerne la nature humaine et sa mise en œuvre collective. Je veux croire à la possibilité de se changer soi pour éventuellement œuvrer à changer le monde, comme le raconte un personnage du livre, mais je redoute très sérieusement ce qui se profile à l’horizon. (Je crois aussi très fort aux gestes individuels, à ce qu’on peut apporter à son propre niveau, comme ce couple d’amis qui ont entrepris de parrainer un enfant du juge ou cet autre ami qui a lancé lui-même son réseau de distribution d’alimentation saine.)
Faire un enfant dans ce contexte, pour moi qui ai toujours considéré qu’il n’y a pas de raison intellectuelle valable à la survie de notre espèce, c’était tout simplement intenable moralement. J’ai choisi d’en parler sur un ton noir mais ironique, pour sauver quelque chose de cette difficulté-là, pour lui donner un sens par la fiction. Mais il y a aussi des moments presque fleur bleue, comme l’histoire d’amour de cette nana qui héberge un réfugié. Tout n’est pas noir et tout ne parle pas du fait de devenir mère. Il y a aussi des hommes qui prennent la parole, et des femmes qui ont choisi de ne pas avoir d’enfant. La maternité était un prisme, mais pas le cœur de chaque texte.
Tes personnages semblent souvent écartelés entre leur animalité et leur culture ?
On agit tout le temps comme si on s’était éloigné radicalement de notre animalité alors qu’en fait on est toujours conditionné par les réflexes du cerveau reptilien, et pas seulement lors d’un accouchement. Détecter des mouvements suspects, repérer un danger ou une proie, tout ça nous vient de loin et s’explique par un environnement naturel qui n’est plus forcément le nôtre aujourd’hui, dans un contexte urbain, quoique. S’occuper d’un bébé, le nourrir, le protéger, c’est aussi se reconnecter à son animalité, alors que cette part de nous est le plus souvent ignorée ou dévalorisée. Et encore une fois, tomber enceinte, c’est faire l’expérience radicale d’une métamorphose complète, principalement liée aux changements hormonaux. Mais ce n’est pas tout à fait conforme aux usages et à la bienséance de parler de ça. Tout ce qui touche au sang des règles, au corps des femmes et à leur utérus, leur hystérie, leur étrangeté profonde, demeure suspect pour beaucoup d’hommes et pour les femmes elles-mêmes. Et très longtemps, on n’a pas écrit sur ça. Pourtant ça nous concerne toutes, et les hommes aussi, d’une autre façon. Personnellement, j’ai appris à détecter les signes et les variations que j’expérimente de semaine en semaine, de cycle en cycle. Et je sais désormais que ça influe sur toute ma vie, donc aussi sur mon écriture, mon énergie créative. En cela j’ai relié en quelque sorte la bulle de l’écriture à celle de la féminité. C’est une seule et même intériorité à explorer. Marie Darrieussecq dit qu’il est bien plus excitant d’être une femme auteure aujourd’hui qu’un homme, car il reste tellement plus de choses à dire, à explorer.