Histoire et préhistoire

Une nouvelle ère s’est ouverte, la série télé pourrait s’imposer comme l’art (narratif) majeur du XXIe siècle, comme le cinéma fut celui du XXe, le roman celui du XIXe, le théâtre celui du XVIIe…
L’homme ayant besoin de repères pour appréhender le monde qui l’entoure, il convient d’en baliser l’épopée .
La télévision, à titre expérimental, est apparue dans les années 1930 , avant d’intégrer timidement les foyers après la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, le premier JT français, en direct et voix off, atterrit dans trois mille récepteurs en 1949.

Aux States, la mode des feuilletons radiophoniques débouche sur une adaptation télé dès 1946. En France, il faudra attendre 1950 et Agence Nostradamus . Qui s’en souvient ? Dans l’imaginaire collectif francophone, les plus vieux feuilletons semblent être Thierry la Fronde (1963) et Belphégor (1965). Pourtant, Thierry, malgré ses allures de Robin des Bois solognot, tentait surtout de reproduire le succès d’ Ivanhoe , une série british sortie en 1958.
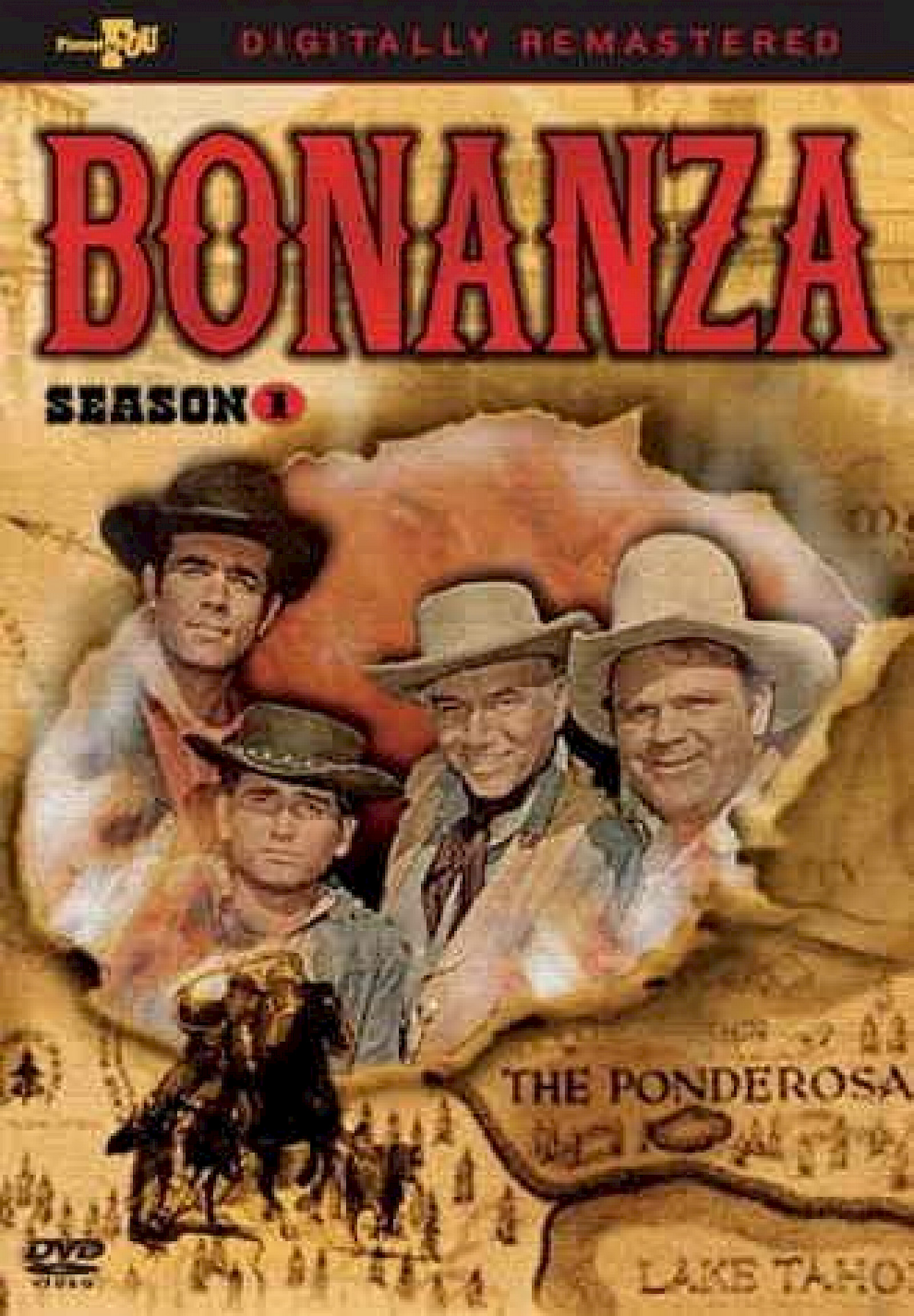
La création US, qui submergera la planète dès les années 1960, va investir tous les genres. La sitcom /comédie de situation ( Ma Sorcière bien-aimée ), le western ( Bonanza ), le policier ( les Incorruptibles , Mannix ), le thriller ( Mission impossible ), la science-fiction ( Star Trek , Au-delà du réel )… Mais sait-on assez que la censure gaullienne a orienté notre perception ? Comme le rappelle Martin Winkler, dans Séries télé (Librio), la production américaine offrait des séries qui contestaient l’ordre établi, évoquaient la peine de mort, l’avortement, le divorce. Nous en fûmes ici réduits à la portion la plus lisse.
Durant des décennies, les fictions télé ont été considérées comme des produits bas de gamme, écrasés par les moyens, l’esthétique ou l’éthique du cinéma. En France, on parlait de feuilletons , suivant le vocable désignant ces romans échevelés du XIXe siècle ou du début du XXe, qu’ on écrivait au kilo pour fidéliser les lecteurs de journaux . Ils étaient donc les enfants naturels des Ponson du Terrail ( Rocambole ), Eugène Sue ( les Mystères de Paris ), Paul Féval ( Lagardère ) et autres Allain/Souvestre ( Fantômas ), cette manne qui allait aussi engendrer la littérature de gare. Aux États-Unis, on parlait de soap (operas) , parce que leur création avait répondu à la volonté

bigbrotherienne d’asseoir durablement le public pour lui faciliter la bonne ingestion des publicités (notamment pour le savon, soap en anglais). Une forme d’assuétude concoctée savamment via une histoire qui ne finit pratiquement jamais , des dizaines, centaines, milliers d’épisodes réduits au statut de fragments ultra-répétitifs, les ingrédients qui font le succès de la presse à sensation : rivalités familiales, vengeances, secrets, ce faux paradoxe d’une caste dorée exposée dans son luxe et ses succès mais ses déboires aussi (les grands de ce monde nous font rêver mais ils ont autant de problèmes que nous, ce qui rassure). Peyton Place , l’archétype des sixties, les Feux de l’amour depuis des décennies. Quant à la série , elle se différenciait par sa programmation. Elle n’était pas quotidienne mais plutôt hebdomadaire. Par son contenu. Un titre regroupait des épisodes assez longs (souvent cinquante minutes), indépendants, avec des personnages récurrents ( Mission impossible , les Mystères de l’Ouest ), rarement mais parfois un fil assez lâche surplombant les mini-films ( le Fugitif , les Envahisseurs ).
Les meilleures créations des fifties et des sixties conjuguaient, avec des moyens réduits, naïveté et inventivité. Comme les BD des années 1940-1960. Quant aux seventies… Elles sentaient le sapin. Une ère de fraîcheur s’est sans doute achevée avec une fausse suite aux aventures du Saint, The Persuaders/Amicalement vôtre (1971). Une épopée un peu formatée parfois, kitsch souvent, frivole, mais dopée par un duo d’acteurs ayant intégré l’imaginaire collectif, Roger Moore-Tony Curtis1 .

Coup de tonnerre, donc, quand Rich Man, Poor Man , en 1976, popularise de nouvelles idées, proches du cinéma contestataire américain du temps, et un nouveau concept, la série-feuilleton . Une suite de petits films, comme dans une série, mais dont l’intrigue se prolonge à travers ceux-ci, comme dans un feuilleton. La mini-série 3 , avec son nombre fini d’épisodes, sera appelée serial en Grande-Bretagne, télésuite au Québec. Des termes qui vont se répandre. Le sillon va engendrer Racines , Holocauste , Shogun , Masada , Tendre est la nuit , Les oiseaux se cachent pour mourir , le Nord et le Sud , etc. Un phénomène marquant, de la fin des seventies aux eighties. Des considérations pédagogiques émergent. Revisiter la traite des Noirs ou la guerre de Sécession, la Shoah, découvrir le Japon, l’Australie.

Deux ans après Rich Man, Poor Man apparaît un certain Dallas .
Qui, au-delà de l’addiction mondiale, impose de nouvelles mœurs de consommation et… une revalorisation du spectateur. C’est que la programmation d’un épisode (de feuilleton !) par semaine implique un degré de compétence non admis5 : la capacité mémorielle . On quitte l’assuétude quotidienne, on croit inventer le concept du cliffhanger pour optimiser le suspense, l’appétit, le souvenir, un booster qui n’est jamais qu’une resucée des chutes de bas de planches des BD hebdomadaires. L’ombre monstrueuse qui s’approche de l’héroïne et… « À la semaine prochaine ! »
Une révolution ! Mais Dallas n’a guère plu aux intellectuels, aux cinéphiles, aux gourmets. Malgré toutes ses avancées. Comme la prise de pouvoir du mauvais face au gentil. Trop vulgaire. Les abysses nauséeux du toc et du copié/collé vertigineux. Avec les épigones Falcon Crest , Dynasty , Flamingo Road … Jamais peut-être le fossé entre les écrans, petit et grand, n’aura semblé plus grand, plus profond.
Il faudra attendre 1990 (aux States, 1991 en France), et l’ovni Twin Peaks pour tout renverser. Définitivement.

1990. L’an 0 de l’histoire des séries télé.
Parce que Twin Peaks s’est vu accoler des moyens jamais vus. Des ambitions jamais vues. Un grand du cinéma (David Lynch) aux commandes, un très bon romancier (Mark Frost) à l’écriture, un excellent compositeur (Angelo Badalamenti) pour imprimer un filigrane musical magique, un casting relevé et décoiffant (entre allumés hallucinants et vamps hallucinées), un récit alambiqué à souhait, tous les codes pulvérisés et détournés , etc.

David Lynch a pris la série télé au sérieux7 , et des millions de spectateurs ont applaudi, fantasmé, une brèche est restée béante, de nouveaux appétits ont émergé. Et, soudain, les créatifs ont afflué8 (scénaristes puis acteurs, metteurs en scène) vers les chaînes indépendantes (HBO, Showtime), parce que la censure les épargnait, qu’ils obtenaient plus de liberté ou de temps, les moyens de leurs ambitions. La voie royale. Bientôt, Oz , Six Feet Under , les Soprano , The Wire allaient imposer un premier âge d’or , d’une qualité exceptionnelle, qui a engendré de nouvelles vagues sans s’essouffler depuis. The Shield , Mad Men , Breaking Bad , Rome , Tudors , Deadwood …

L’an 0. C’est refouler les magnifiques créations britanniques le Prisonnier ou The Avengers/Chapeau melon et bottes de cuir dans la préhistoire du genre. Mais on a besoin d’étiquettes, de tiroirs.
L’an 0. C’est marginaliser une extraordinaire série des années 1950, Alfred Hitchcock présente , une anthologie11 qui a aligné les perles, plusieurs réalisées par l’un des plus grands du septième art, avec des castings d’enfer, des récits souvent imparables. Préhistoire.
L’an 0. C’est oublier un impact limité. Dans l’espace, parce que la complexité et l’originalité exacerbée ont restreint l’intérêt à une communauté exigeante . Dans le temps, parce que les contorsions centrifuges du scénario, dès la deuxième (et ultime) saison, ont dilapidé la tension accolée à la première question, mythique : « Qui a tué Laura Palmer ? »

L’an 0. C’est négliger à quel point l’engouement extraordinaire pour le petit écran devra aux X-Files , Friends , Urgences , Lost … À quel point les premières séries de l’âge d’or devront davantage aux pionnières NYPD Blue , L.A. Law ou Hill Street Blues .
Quoi qu’il en soit, la série télé semble aujourd’hui un art majeur. Mais doit-on parler du dixième art ou du huitième ? Car si d’aucuns ont attribué le numéro 8 à la télévision, on observera qu’il s’agit d’un media généraliste. À ce compte-là, le journal ou la revue, la radio…