Le Printemps du livre

Le mardi 27 novembre, j’ai assisté à une première très réussie, Le Printemps du livre, mis en place par quatre maisons d’édition, dans un partenariat assez inédit.
Le défi des mousquetaires ?
Placer les auteurs, les éditeurs, les directeurs de collection face aux gens de la presse, des blogs et plateformes, de la librairie, des instances pour présenter leurs prochaines publications (de février à avril 2019 ici, ce qui nous mène au… printemps). Il est vrai que, dans le flux asphyxiant des sorties (un livre doit être choisi au milieu de centaines de ses semblables venus du monde entier et la rotation est vertigineuse), un reporter culturel ou un responsable de librairie (Club était représenté) peuvent être amenés à davantage de curiosité, de soutien vis-à-vis d’acteurs incarnés, écoutés, visualisés ou contactés .

Dès 10 h 30, accueil cordial par Charlotte Heymans, l’attachée de presse des Impressions Nouvelles, et sa collègue Isabelle Fagot (ONLIT, etc.). Il y a du monde et du beau monde à la Maison européenne des auteurs et des autrices, à deux pas de la place Stéphanie et de l’avenue Louise. On ne citera personne vu les égos de tout un chacun et je ne pourrais qu’oublier des noms ou amenuiser des importances.
Vers 11 heures, on entre dans le cœur du sujet. Deux heures de découverte/présentation, du haut niveau, avec des plateaux équilibrés : 4 x 3 personnes, 4 x 30 minutes. Un peu long ? Oui, mais comment y échapper ? Réduire le temps imparti à chaque maison ? Possible, soit, mais, intrinsèquement, trente minutes pour un éditeur et sa philosophie, ses projets, ses sorties, ses collections, la plongée dans telle ou telle œuvre, la découverte de l’un(e) ou l’autre de ses auteurs-autrices, ce n’est pas énorme, non.
Dès 13 heures, collation de qualité et discussions variées. Retrouvailles et trouvailles. Je peux ENFIN discuter avec trois admirations virtuelles : Véronique Bergen, Marcel Sel 1 ou Tanguy Habrand 2 . Et recevoir mon package /joli sac de Noël (qui unit publications et maquettes).
Une réflexion, en surplomb
Comment croire en vous si vous ne croyez pas et n’investissez pas vous-même en vous ? Nos éditeurs sont parfois/souvent bien pusillanimes en Belgique francophone, considérant achevé leur travail une fois le livre imprimé, le laissant dériver au gré des ondes.
Il faut donc OSER ! TOUS ! À nos diverses positions.
Et ceux-celles-là s’y sont attelés. Leur initiative est originale et dynamique. Il y avait même un air de Paris mais dans le meilleur sens du terme. Qui plus est, ils-elles veulent récidiver, transformer le happening en un must annuel.
BRAVO !
Retour sur les intervenants et les livres évoqués
Olivier Weyrich (Weyrich) se trouvait en compagnie de Ziska Larouge et de Jean-François Füeg.
Jean-François Fuëg, Notre été 82 , récit, 125 pages.

Au premier abord, avec sa barbe et sa moustache ouvragées, son costume scabinal , une certaine affirmation corporelle, un bagout, cet homme, responsable de nos bibliothèques et centres culturels, interpelle. Quant au pitch, découvert dans le livret éditorial, il renvoie à des souvenirs de jeunesse. Je ne prise guère l’autofiction, où ne brillent que de très rares auteurs-autrices, mais mon attention est vite requise, l’orateur est vivant, émouvant, d’une sincérité rare et peu politiquement correcte. Du coup, j’entame son ouvrage dès le lendemain de la rencontre. Ce qui en dit long, au passage, sur le sens/intérêt du happening .
In fine , le livre ressemble à sa présentation. La langue est simple mais vivante, l’évocation sans fard :
« Né dans une famille qui avait déclaré la guerre à toute forme de sentimentalisme, j’étais sans cesse submergé par une émotivité maladroite que je peinais à contrôler. Il n’y avait là aucune ostentation, je ne pleurais pas et ne manifestais jamais d’émotion. En revanche, j’étais frénétiquement en recherche de relations chaudes, je voulais avoir des amis proches et, romantiquement, j’imaginais une complicité qui demeurerait toute la vie. »
J’ai entamé dans la bonne humeur et la nostalgie, renforcée par les citations musicales d’époque (NDLA : j’ai pareillement plané avec Wish You Were Here des Pink Floyd, vécu la scission Genesis/Peter Gabriel comme un événement copernicien, etc.). Les pages défilent. Puis, d’un coup, je pause, la restitution a tendance à émasculer la narration, je m’interroge sur l’enjeu d’une telle autobiographie…
quand soudain…
… s’insinue le point d’acmé de l’opus !
De quoi s’agit-il ? D’un dérapage de notre auteur-narrateur. Qui va le mener à trahir un ami, à en mener d’autres dans une dérive sordide, à échapper à ce qu’il croira alors une tentative de meurtre-vendetta. Là, Füeg émeut et crée du sens, un sens qui revigore l’ensemble du récit et lui apporte une tension bienvenue.
Il est rare qu’un homme, qui plus est un homme rompu aux responsabilités, à la direction, ait le courage de baisser le bouclier et d’oser le voyage à rebours en toute lucidité, dans la remise en question de ses propres jugements, la hauteur éthique d’avouer ses blessures, ses pertes (l’appartenance à une bande, un clan ; les fusions adolescentes), ses erreurs et leurs conséquences, de stigmatiser ses limites tout en les resituant dans un contexte (famille, premières amours…).
Il y a de la démarche psychanalytique dans cette manière de coucher sur papier les racines d’un devenir. Et une belle leçon philosophique !
Ziska Larouge, Hôtel Paerels , roman, 205 pages.

Encore un livre à l’écriture simple et vivante. Quoique. Il y a ici un registre littéraire plus affirmé, le naturel confondant s’imbrique dans un véritable travail sur la fluidité des phrases, leur rythme, leur percussion :
« Comme Paris ne me retient plus, j’ai annulé ma réservation à l’auberge internationale des jeunes pour tester mon invisibilité dans le Thalys qui me ramène à Bruxelles. Et ça marche ! Il est vrai que j’ai remédié à mon problème pileux en me rasant dans les toilettes après avoir acheté des rasoirs jetables à la gare et que, quand je suis « éteint », j’ai un physique plutôt banal. Mon prof de théâtre me l’a assez répété : « Luce, vous êtes sur off ! Activez le bouton on ! Il faut de la lumière dans l’attitude quand on est ordinaire ! » Là, c’est sûr, je suis éteint. »
Luce (nom du narrateur). Lux en latin = lumière. Lumière/éteint. On / off . Indiciel, isnt’it ?
Le pitch ? Les aventures d’un jeune apprenti-comédien qui rate un casting à Paris mais y croise la femme de sa vie, perd ses coordonnées, se retrouve à Ostende au fil de dérives picaresques, y rencontre un couple de jeunes filles qui l’emmènent dans leurs bagages, jusqu’à lui dénicher un boulot dans un hôtel art déco, se voit rejoint ensuite par le petit frère qu’il élève depuis la mort tragique de leurs parents puis par une grand-mère atteinte d’Alzheimer, tous deux en cavale (évadés de l’école ou d’un home). Et tout ce petit monde de recomposer une famille, un microcosme, de tendre vers de nouveaux équilibres quand déboule une intrigue policière sur fond de mafia roumaine, de magot dérobé, de migrants asphyxiés, d’enlèvements, etc.
Un sacré embrouillamini ? Oui ! Qui sent un peu l’improvisation, la création au jour le jour des feuilletonistes du XIX e siècle ou des auteurs de BD des années 1930-1940, qui fait plutôt Beatles période rouge ( brute de décoffrage ) que bleue (sophistiquée). Oui. D’autant qu’il y a des rebondissements en cascade, dans tous les sens, des relations amoureuses aux circonstances de la mort des parents, en passant par l’intrigue criminelle. Et je suis pris à rebrousse-poil, assurément, moi qui ne jure que par les architectures savamment orchestrées. Mais. C’est une belle leçon ! Un retour au cri primal de la narration et de l’écriture. Le conteur qui invente au coin du feu. Il y a chez Ziska Larouge (NDLA : ce pseudonyme ne renvoie pas à une passion pour la gauche mais pour la couleur !) une incroyable verve, une spontanéité, une naïveté (au sens le plus noble du terme) qui emballent. À défaut de travailler en amont, elle travaille en aval, vivant et malaxant ce qu’elle écrit, raconte avec un formidable enthousiasme… et du talent !
Bref, bref, bref… On ne s’ennuie jamais, on lit rapidement mais avec un plaisir accoudé au mouvement des mots, des phrases, ému par un humanisme contagieux (qui rappelle Pennac).
Tanguy Habrand 5 (directeur d’Espace Nord, qui appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles tout en étant édité par Les Impressions Nouvelles) accueillait quant à lui Joseph Ndwaniye et Véronique Bergen. Et présentait le nouveau look conféré à la collection patrimoniale. Une réussite ! J’ai pu examiner le Ndwaniye sous toutes ses coutures : c’est un bel objet, ramassé (12 sur 18,5 cm), raffiné (la couverture est très élégante), au prix fort démocratique (8,50 € pour les 232 pages de Ndwaniye) ; le texte est en sus accompagné-rehaussé par une postface et une interview de l’auteur (dues à Ronny Demaeseneer).
Je n’ai pas reçu, hélas, le livre ou la maquette du Kaspar Hauser (sous-titré joliment « ou la phrase préférée du vent » ), paru à Paris en 2006 (Denoël), mais l’autrice nous informe que sa réédition sera bien davantage qu’une simple reprise, un remake singulièrement revu et corrigé, régénéré. À défaut d’évoquer le livre, rappelons ici que Véronique Bergen , qui vient d’entrer à l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, possède un talent d’écriture très remarquable, elle transcende tout ce qu’elle touche, c’est une alchimiste du mot et de la phrase. Mais je ne la connais qu’au croisement de ses recensions ( le Carnet et les Instants , propulsé par Nausicaa Dewez, aligne de nombreuses plumes – ou touches de clavier – épatantes !) et il faudra bien que j’aille y voir de plus près côté long cours. Un jour…
Revenons à Joseph Ndwaniye et à la Promesse faite à ma sœur .

Ma première sensation est négative. Le style est sobre, on lit agréablement mais il n’y a pas les envolées attendues a priori d’un ouvrage repris dans une collection qui… collecte l’or littéraire du temps et de tous les temps. Oh, il y a des réussites partielles ici ou là mais de petites naïvetés aussi.
Une deuxième sensation prend vite le relais, renverse la perception globale. La narration est fluide, on lit sans effort tout en se trouvant projeté dans une enfance africaine :
« Du haut de mes cinq ans, je n’avais pas peur de la nuit. Rien ne pouvait m’arriver. La compagnie des vaches, pourtant sans défense, me sécurisait. J’étais loin d’imaginer qu’une hyène pouvait s’attaque au troupeau et, pourquoi pas ?, au berger. J’en pris conscience une nuit d’été. L’histoire pourrait s’intituler « Terreur dans la nuit » . »
De revivre, dans le premier chapitre (qui est plutôt une première partie : près de quarante pages), la jeunesse du héros-narrateur rwandais, de son statut privilégié de fils d’inspecteur scolaire ami des Blancs à celui de paysan parmi les paysans, au service de la grand-mère paternelle, par tradition, émeut, informe, élargit. Soudain, la sobriété n’est plus un défaut mais une qualité. Et on applaudit qu’une collection littéraire ne bascule pas dans le nombrilisme formel mais affirme toute l’importance du contenu, du narratif (ce qui est plus courant chez nos amis anglo-saxons).
Le deuxième chapitre (qui ouvre la deuxième partie du livre… ou un deuxième roman, quasi) nous plonge en 2003, alors que le héros, après dix-sept années passées en Belgique, intégré, marié et père, décide de revenir enfin au Rwanda.
La suite ? Le héros va aller à la rencontre des siens, de ce qu’il reste des siens après le génocide de sinistre mémoire. Revisitant la mort atroce de sa sœur Antoinette mais la disparition de son frère jumeau Thomas aussi. Retrouvant sa mère et même son père décédé (qui lui parle à travers des songes ou… ?). Le roman suit son cours, à la fois tranquille et dense, mêlant la redécouverte d’un pays modernisé, transformé, la quête identitaire (l’adéquation avec des racines estompées, la remise en question des raisons de son absence prolongée) et une sorte d’enquête quant au sort, aux secrets du frère jumeau… Une même famille peut-elle avoir accouché d’une victime et d’un bourreau ?
Sur un ton doux-amer, parcouru de notations sensuelles, un bon livre, aux allures de voyage dans le temps et l’espace mais surtout d’entreprise de mise en adéquation de soi au monde.

ONLIT , qui a offert, selon moi, le meilleur roman francophone de 2017 avec le Rosa de Marcel Sel (finaliste du Rossel), va tenter de remettre le couvert avec ledit Marcel, que son éditeur Pierre de Mûelenaere invite à évoquer sa prochaine sortie, Élise , qui est encore en cours d’écriture… et annoncée pour avril. À les entendre, on devrait retrouver ce cocktail très équilibré, riche, détonant, qui a fait la réussite du premier opus, soit un récit littéraire de qualité et une matière humaine émouvante se faufilant à l’intérieur de pages d’histoire méconnues soigneusement reconstituées (ici, la guerre de 40-45, l’arrivée des troupes russes dans le corridor prussien inséré dans le territoire polonais).
L’autre sortie des éditions ONLIT (précédemment connues pour leur rôle de précurseur dans le marché éditorial numérique) est un faux roman de Jacques Richard, la Femme qui chante , un portrait de… femme constitué d’une suite de moments, titrés ( la Petite , Solange …) et sous-titrés ( les Arbres , Te voir dehors …), autant d’échos à la confection disparate de nos vies, qui ne sont jamais des histoires, des romans mais toujours des approximations, des ensembles de pièces cousues, recousues, auxquelles on tente de conférer du sens, du liant.
La structure même du texte est profondément signifiante. Quant à la langue, elle est d’un (très) beau registre, qui tend vers la densité poétique :
« Le jour n’est pas là, la nuit n’y est plus. Il n’y a aucune raison que ce soit le commencement de quoi que ce soit. De qui que ce soit. Pas plus maintenant que dans une heure ou dans deux. Ou même pas du tout. Ce seraient les limbes, sans lieu ni temps, s’il n’y avait la sensation du froid et de ce quelque chose qu’on ne sait pas encore nommer. »
Un texte âpre et ciselé, qui ose balayer les convenances et interroger sur notre humanité. Qui brouille nos perceptions aussi, invite à relire, à réinterpréter.
À offrir aux femmes de nos vies !
(si elles ne sont pas trop puritaines !)
Benoît Peeters 7 (directeur des Impressions Nouvelles) et Dick Tomasovic (co-directeur de la collection avec Tanguy Habrand) présentent un nouveau concept, la Fabrique des héros , qui associera un auteur talentueux à un des personnages qui hantent son imaginaire.
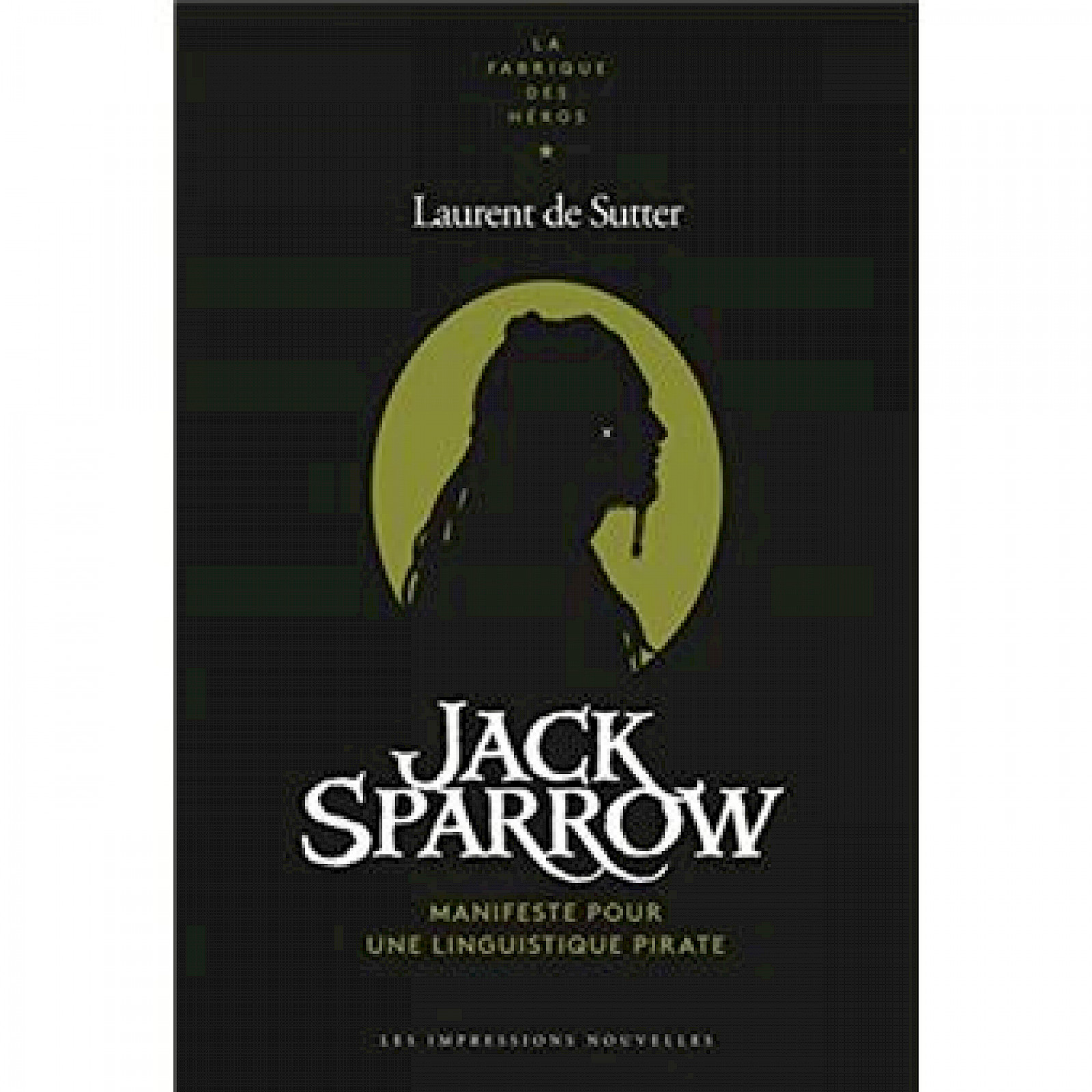
Le premier volume est un Jack Sparrow … sous-titré Manifeste pour une linguistique pirate de Laurent de Sutter (théoricien, essayiste, directeur de collection lui-même, notamment aux prestigieuses P.U.F.). Encore un très bel objet (fond noir classieux, aspect graphique), réduit (13 sur 19 cm), à un prix démocratique (12 € pour 126 pages). Quant au contenu…
L’entrée dans l’ouvrage est magistrale. Tudieu ! Le chapitre… 0 s’érige en pastiche du roman d’aventures flibustières, tout à la fois savamment écrit à la mode de jadis tout en happant la vivacité cinématographique ou le contrepoint du modernisme littéraire :
« (…) la jeune femme s’était évanouie – dans tous les sens du terme. »
Ou :
« « (…) Vous (NDLA : Jack Sparrow) êtes, sans nul doute, le pire pirate dont j’aie entendu parler. » Ce à quoi, arborant le sourire satisfait de celui qui vient de recevoir un compliment, le capitaine rétorqua : « Mais vous avez entendu parler de moi… » »
La suite ? Écrite et enlevée, elle oscille entre le roman et l’essai, des embryons de narration et des réflexions/micro-essais sur la séduction, la langue, etc. La langue comme mode d’affranchissement par rapport au pouvoir, voire de réalisation ontologique : le héros, ici, se définissant davantage par ses dons de causeur, ses paroles et ses phrases que par ses actes.
C’est très ludique et brillant tout à la fois (Johnny Depp croise Baudrillard !). Mais, à dire le vrai, les recours nécessaires au détail des épisodes du film (NDLA : Pirate des Caraïbes n’est guère ma tasse de thé, mes souvenirs sont délavés) ont fini par écorner mon plaisir de lecture.
Longue vie au Printemps du livre et bon succès aux projets présentés !