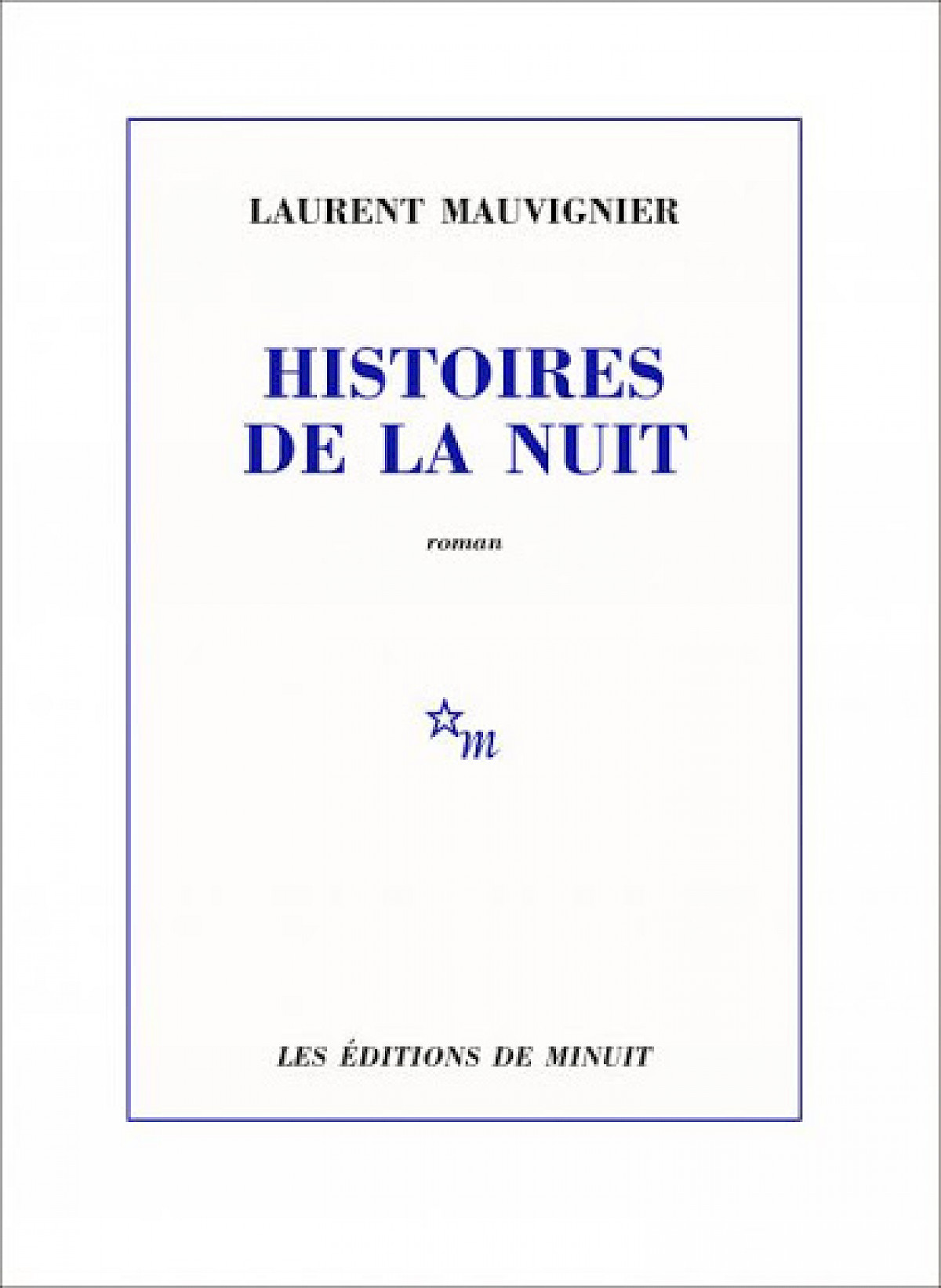
C’est dans un genre inédit sous sa plume, celui du roman à suspense, que Laurent Mauvignier, toutefois fidèle à ses prédilections habituelles, nous entraîne brillamment avec son douzième roman, Histoires de la nuit , grâce à une narration ciselée et un triple feuillage sémantique dès les lettres bleues de la couverture blanche.
L’intrigue des Histoires de la nuit prend racine à la Bassée dans un hameau français : ce « poing fermé au milieu des champs » se circonscrit à trois maisons reculées, dont deux occupées, l’une par une artiste-peintre de 69 ans, Christine, l’autre par un couple de quarantenaires – Patrice, qui travaille à la ferme, et Marion, dans une imprimerie de la ville – et leur fille, Ida. Les 640 pages de ce roman à suspense courent sur deux journées dont la soirée de la seconde est connue : il s’agira, pour Patrice, Ida, Christine et deux collègues de Marion, d’attendre le retour du travail de cette dernière pour lui faire la surprise de fêter ses 40 ans avec elle. Arpentant les préparatifs de cette fête par le prisme de diverses pensées (celles de Patrice, de Christine et d’Ida), le récit révèle la teneur fictionnelle de l’acte de préparer : préparer un événement, c’est d’abord se le raconter. Cette ardeur des trois personnages finit par contaminer le.a lecteur.rice qui, à son tour impatient.e, attend la satisfaction de voir s’exaucer cet événement annoncé. Et pourtant… trois frères (Denis, Christophe et Bègue) débarquent au hameau et, insidieusement, prennent en otage Christine et Ida, puis Patrice, Marion, ses deux collègues, suivant le balai des arrivées. C’est alors que la teneur de l’événement change, évoluant en un « mélange de fête et de terreur suspendues », et tous les préparatifs annoncés font place à ceux de cette prise d’otages. Cette construction originale évite l’écueil d’un morne manichéisme et constitue une fresque complète, qui reporte vaillamment la découverte de la vérité.
Escargotienne, la narration fait de ces préparatifs son cœur, puis s’en éloigne doucement pour former un tricot de pensées, fluide et ample, dont la maille, souple et spiralée, laisse transparaître ce qui est occulté. En effet, les préparatifs de l’anniversaire enveloppent Patrice et Christine de l’angoisse de vouloir bien faire, ce qui perce le papier bulle habillant leurs émotions et frustrations. En allant chercher le cadeau de Marion en ville, Patrice, qui a l’habitude de se sentir « surnuméraire » et dont « la vie est entièrement polarisée par sa femme », ôte la muselière de ses pulsions, que le silence de la campagne et la douceur des bêtes parvient à maintenir en place, et libère sa colère et sa honte. Christine, quant à elle, avant de se pencher sur l’élaboration du gâteau de Marion, se rend au commissariat pour mettre des mots sur sa peur – celle qui la ronge depuis la découverte répétée de lettres de menaces dans sa boîte aux lettres – qu’elle parvenait, jusque-là, à taire. Cette percée d’émotions, au-delà du déni et du refoulement, fait de plus temporairement éclater le vernis social des personnages et, par là-même, le révèle, dans toute sa monstruosité. Purgés en surface, Patrice et Christine, avec qui nous semblons avoir partagé quelque chose, renouent ensuite avec leur indéfectible écorce pour se consacrer pleinement à la fête à venir. En est-il de même pour Marion, celle dont Mauvignier déclare avoir eu l’impression de devoir écrire le livre pour savoir qui elle était 1 ? À première vue, c’est débarrassée entièrement de sa colère (adressée aux concernés lors d’une réunion de travail) que Marion arrive, tenace, à sa fête mais, contrairement à Patrice et à Christine, nous ne savons rien de son passé. Dès que la bruyante fête attendue se mue en silencieuse prise d’otage, la narration se pose en sismographe du sol intérieur des personnages : quand le séisme de l’action et de la confession va-t-il surgir ? En tous cas, une première craquelure laisse entendre de futures révélations. Le vernis social de Marion, interdite en cette situation inopinée, se fissure, lui aussi : ses collègues parlent d’elle en sa présence :
« comme si elles parlaient de quelqu’un qui n’était pas là, comme si (…) elle n’avait pas d’autre vie que celle dans laquelle toutes les deux la tenaient enfermée sous la cloche de leur quotidien, leur appartenant comme l’objet qu’elles avaient décidé d’aimer, d’admirer indépendamment de son bon vouloir, comme une poupée qu’elles auraient décidé de vêtir et de dévêtir à leur convenance sans se soucier de son désir à elle (…) »

Quelles réalités déceler alors sous le magnétique titre des Histoires de la nuit ? Premièrement, il orne le recueil d’histoires que Marion parcourt, tous les soirs, au chevet de sa fille, désamorçant le pouvoir horrifique que certaines pourraient exercer sur elle. Le placer sur la couverture, c’est insister sur la précieuse sortie de secours qu’est la fiction : lorsque Ida ressent réellement de la peur, le soir de la prise d’otages, elle évacue un instant la situation dans la fiction. Deuxièmement, la nuit, effective et symbolique, d’abord « silencieuse » puis « trop silencieuse », se fait partition de l’angoisse des personnages et, dès lors, les histoires, auxquelles est rattaché ce complément du nom, sont ce flux de pensées, créatrices du bruit qui nous dispense, nous aussi, d’affronter pleinement le silence. Se raconter des histoires, mettre du bruit sur son silence, c’est ce que Mauvignier s’applique à faire aussi, affirmant2 que plus il va vers la fiction – lui qui ordinairement fait du réel sa magistrale toile de fond (le drame du Heysel3 , le guerre d’Algérie4 , un fait-divers de vol en 20095 , le tsunami au Japon en 20116 , etc.) – plus il regarde ses propres cauchemars. D’ailleurs, même lors de la relecture de ses écrits, le silence se murmure et s’apprivoise puisqu’il règle sa voix à une fréquence très basse et s’équipe de boules quies. Troisièmement, tandis qu’elle se pare de l’adjectif « mentale », la nuit du titre revêt encore un autre sens et ces histoires désignent alors les pensées parasites qui, nuit et jour, assaillent le cadet déséquilibré, Bègue, lui donnant l’impression, par exemple, que les tableaux de Christine le dévisagent et le jugent. Quoi qu’il en soit, le séisme pressenti survient lors de la percée de ce riche tissu de pensées, occulteur de silences : un des agresseurs prend la parole et sa question crible plusieurs fois la narration de sa présence, traduisant parfaitement l’angoissé ressassement consécutif à son énonciation, l’abasourdissement des agressés. Sans rompre totalement la maille des pensées car non introduits par des guillemets, ces mots, cette fois bien sonores, viennent s’ajouter, subrepticement, à ce long tissu, comme indice de dénaturation de l’événement joyeux attendu.
Un tel magma de pensées ne peut toutefois se tisser sans rythme – célérité et lenteur le font savamment onduler – et sans tension narrative, qui incruste des coutures au récit. Ces deux burins sont venus « sculpter la durée » d’une histoire qui comportait quatre cents pages de plus, selon les dires de Mauvignier, et cette taille est rendue visible à certains endroits dans un éclat métatextuel des plus savoureux (« (…) – car tout ça ne vaut pas le temps qu’on passe à le raconter, hein, tu ne trouves pas ? – (…) »). Si ces découpes réduisent la durée de l’histoire, cette dernière n’est pas pour autant ancrée dans une temporalité dérisoire. En effet, l’épaisseur de la narration, qui ricoche sur le spectre temporel, est instiguée par l’épaisseur émotionnelle de l’être humain qui décloisonne toujours ce qu’il est en train de vivre. Les Histoires de la nuit ne peuvent entièrement être qualifiées de huis clos, tant les bonds salutaires de la pensée dans un futur dénué de la pression présente offre un véritable refuge aux personnages (Ida s’imagine raconter ce qu’elle est en train de vivre à ses amis, le lendemain, dans le bus) : s’imaginer relater c’est prendre de la distance, s’extirper de l’emprise présente d’un événement. Néanmoins, le huis clos s’impose aussi en partie puisque l’« espace mental » des personnages fait office de cadre narratif à l’histoire : il est le lieu qui va permettre ou non l’action, s’il daigne à se laisser envahir par le présent ou s’il continue à galoper dans le passé ou le futur. C’est ainsi qu’il arrive que les personnages procrastinent à prendre en compte une pensée éclair – que le.a lecteur.rice, dans une position inconfortable de témoin passif incapable de venir briser ces reports et pétri.e de l’émotion qui devrait assiéger ces personnages, sait pourtant capitale –, la laissent en suspens puis la recouvrent d’autres pensées qui semblent grotesquement inutiles et inadéquates. Détonante, l’émergence de l’indicatif futur, à la page 314, vient adroitement rappeler que « bientôt tout va s’animer ». Ce qui est délectable, c’est que tous les narrateurs pourraient prononcer cette phrase : les pensées polyphoniques disparates convergent vers cette unique certitude.
Bien que les Histoires de la nuit attirent Mauvignier vers un genre auquel il ne s’était jamais adonné, ce roman se situe dans l’exacte lignée des précédents, tant on y retrouve ses merveilleuses préoccupations : la recherche non pas du réalisme mais de « (…) quelque chose de juste, de crédible, doté d’une densité réelle », permise par une minutieuse observation des êtres – agresseurs et agressés, ici, humiliés, toujours – et de leur essence profonde. Si ces Histoires de la nuit devaient normalement se déployer au cinéma7 (projet avorté, au demeurant avoué, dans la démarche authentique de l’écrivain, lorsque l’écriteau annonciateur du hameau, l’Écart des Trois Filles Seules, fait songer au « générique d’un film qui n’a pas été tourné »), c’est dans un autre art, celui de la peinture, que Mauvignier parvient à faire subtilement émerger son projet littéraire au creux de ce thriller, en l’inscrivant dans les revendications artistiques de Christine qui désire avant tout « ne pas parler mais peindre » pour éviter toute considération illusoire, creuse ou lassante. C’est animé par ce même objectif que Mauvignier ausculte les sauvages pensées de ses personnages plutôt que de les faire tristement parler, offrant là une « densité réelle » palpable. Cette dernière n’induit pas une pesante exhaustivité (Patrice n’hésitant pas à bâillonner d’une anacoluthe consciente son flot de pensées) mais une gradation délicate : la narration fait entrapercevoir la précipitation puis les atermoiements autocorrectifs de l’esprit pour coller des mots sur le réel (Christine juge par exemple trop facile d’apposer le « mot passe-partout » « carnassier » au sourire de Christophe, lui préférant finalement la qualification de « violemment amusé »). Par ailleurs, l’artiste Christine dit vouloir « (…) rabote[r] la langue pour ouvrir sa vision, s’ouvrir elle-même à sa vision, pour forcer son regard à s’approfondir, comme on cherche à voir dans la nuit, à se faire à l’obscurité », ce qui suggère la volonté de Mauvignier de s’imprégner du monde et des êtres, par l’écoute, l’observation et la promenade (activités antérieures à l’écriture, pouvant être considérées comme oisives mais en réalité essentielles, selon lui – le fait d’être assis sur une chaise et d’écrire n’étant qu’une « conséquence de tout le reste »8 ). Ici, il aiguise sa faculté de donner une forme à sa géniale clairvoyance en la confrontant à l’opacité apparente d’un roman à suspense, dans lequel l’on pourrait anticiper la prévalence d’une succession d’actions sur l’analyse psychologique. Si Christine partage avec Mauvignier cette poursuite de dense authenticité, issue d’une fine étude en amont, initiatrice d’une peinture ou d’un roman prometteurs, elle n’a pas l’occasion d’appliquer ces principes durant le récit, ce qui n’est pas le cas de l’adorable Ida qui repère les leurres de son entourage (« Oui, elle sait que les événements, les parents comme les autres les subissent et que leur toute-puissance est un leurre auquel elle ne fait que semblant de croire, par habitude, peut-être aussi par paresse ») et agit d’une façon authentique, dénuée de tout vernis social (« comme si elle aussi vivait avec une bête sauvage au milieu de la poitrine » ; « Elle aime ces moments où il se jette sur elle, elle crie et rit en même temps, elle recule en courant, lâchant dans la cour son petit cri strident comme un vol d’hirondelles au-dessus de la cour du hameau »). L’insouciance que l’on a coutume de voir décrite chez les enfants répond absente des Histoires de la nuit qui, par le rôle déterminant assigné à Ida, pointent son agile perspicacité et la saine gestion de ses émotions, nettement enviables à l’enfouissement émotionnel dans lequel s’enferment les adultes, munis d’œillères les coupant d’eux-mêmes et des autres.
En enquêteur du réel, Mauvignier prouve encore une fois que, peu importe l’apparence d’un lieu, d’une personne, son origine et son statut social, quelque chose est à observer et à révéler. Sous le glacis du monde, « pour peu qu’on y prête attention », se cache des trésors universels.