Cueillir la nuit : deux écrivaines au MuFIm
Entretien avec Isabelle Gillet & Colette Nys-Mazure

La nuit du 13 au 14 septembre 2022, les deux écrivaines Colette Nys-Mazure et Isabelle Gillet ont passé la nuit au MuFIm – Musée de Folklore et des Imaginaires de Tournai. Nous les avons interrogées sur cette expérience d’enfermement nocturne qui, en 2024, a donné lieu au récit Le Tour des abandons (éditions invenit). L’entretien a été réalisé en mai 2024 dans le cadre d’une enquête pour les MELL1.
« Nous cueillons la nuit sans méthode. […]
L’esprit de cueillette nous va bien. »
Colette Nys-Mazure, Isabelle Gillet
Chiara Zampieri : D’où est née l’idée de passer une nuit dans les salles du MuFIm de Tournai ? La collection « Ma nuit au musée », en cours de publication aux éditions Stock depuis 2018, y a-t-elle joué un rôle ?
Colette Nys-Mazure : Une nuit au musée… C’est un vieux rêve. J’ai commencé à fréquenter les musées très tôt, puisque j’avais dans ma famille des personnes qui aimaient bien m’y emmener. En tant qu’enfant, tu as un tas de rêves lorsque tu traverses un musée, puisque le musée est un monde dont on ne voit d’habitude que la face visible, alors qu’il a tellement de faces cachées. C’est un vieux rêve entretenu aussi par des films et des documentaires : que se passe-t-il la nuit dans un musée ? Ce rêve murissait en moi déjà depuis des années et c’est certain que la collection de chez Stock m’a fait penser que ce rêve devait être possible. Lorsque j’ai rencontré la responsable du musée d’Art sacré de Paray-le-Monial je lui ai donc parlé de cette idée ; elle me dit que je pouvais passer une nuit dans son musée. Peu après, j’ai rencontré la directrice du Musée L de Louvain-la-Neuve, Anne Querinjean, à qui j’ai également exposé ce projet. Anne Querinjean était enthousiaste : elle m’a montré le musée et ensuite elle a organisé une visite privée avec Dominique Tourte des éditions invenit, qui était déjà partant pour éditer le livre issu de ce projet. Malheureusement, nous n’avons pas eu l’autorisation du comité du musée. Je n’ai cependant pas abandonné. J’en ai parlé à Jacky Legge, conservateur du MuFIm à Tournai, qui a accepté avec enthousiasme. Pour moi, finalement c’était mieux Tournai que Paray-le-Monial puisque j’aimais mieux un musée de l’art populaire qu’un musée d’art sacré. Quand j’ai eu l’autorisation de passer une nuit au MuFIm, Isabelle [Gillet, ndlr] était chez-moi et en voyant son regard je me suis demandé pourquoi nous ne ferions pas cette expérience en duo. C’est venu spontanément, il n’y avait rien de prémédité. Nous sommes ainsi passées du rêve d’un projet impossible à un projet qui d’abord devient possible et, d’un coup, réalisable. Jacky Legge nous a donné carte blanche et Dominique Tourte était d’accord dès le début. Et puis c’est parti. À deux. Nous nous sommes rendues au MuFIm sans a priori mais en étant sûres l’une de l’autre, puisqu’il y a entre nous une vieille complicité. Nous nous connaissons depuis une vingtaine d’années, nous avons fait un tas de choses ensemble : nous animons des ateliers d’écriture, nous écrivons des poèmes, et avons même travaillé à des publications communes. Je connaissais bien le professionnalisme et les connaissances d’Isabelle et tout d’un coup, l’idée d’être à deux s’est imposée, elle m’est apparue comme évidente en raison de cette complicité. C’était tellement rigolo.
Isabelle Gillet : Comme pour Colette, l’idée de passer une nuit dans un musée ne m’est pas venue d’un seul coup. Elle s’est insinuée au cours des vingt dernières années et sans doute la collection Stock a joué son ferment. Pour ma part, je fréquente les musées depuis plus de vingt ans, mais autrement, puisque mon métier consiste à intervenir dans les musées et à collaborer avec eux. L’idée de passer une nuit dans un musée n’était donc pas motivée par un attrait particulier pour les coulisses. En travaillant en familiarité avec les musées, il m’arrive assez souvent de me rendre dans ces lieux lorsqu’ils sont en montage d’exposition ou pendant leur jour de fermeture. Il m’est déjà arrivé, par exemple, de voir Versailles sans visiteurs. Il en va de même pour les réserves. Il y a quatorze ans, avec mes étudiants de master, nous avons réalisé le projet « Objectif en coulisses » pour lequel quatorze musées de la région Haut-de-France nous ont ouvert leurs réserves pour une campagne photographique. Même pour l’exposition Jean-Philippe Toussaint au Musée des Beaux-arts d’Arras, il s’agissait d’une campagne photographique menée avec lui au sein des réserves du musée. J’ai donc une certaine familiarité professionnelle avec les musées et, par conséquent, je suis habituée à voir ces lieux dans des conditions plutôt exceptionnelles. À ces occasions, je suis cependant toujours dans un contexte professionnel et, souvent, avec des étudiants. Ce projet au MuFIm, c’est autre chose : il est vraiment né d’un désir, d’une spontanéité. Nous avons eu droit à douze heures d’affilée dans le musée sans interruptions ou obligations venant de l’extérieur. Il n’y a pas eu autre chose qui se passait, juste ce temps qui nous a été donné.
Colette Nys-Mazure : Effectivement, il était moins question de coulisses que de ce qu’on peut voir quand on a le temps de voir. L’invisible qui se manifeste. Avant de passer cette nuit au MuFIm, jamais je n’avais pris une telle conscience de la continuité à l’œuvre dans ce musée. Nous avons eu ce temps à disposition qui est un temps imprévisible, un temps de la sérendipité comme on dirait aujourd’hui, un temps pour découvrir des choses qu’on ne pensait pas exister. On sentait bien qu’il y avait là quelque chose de magique, un trésor à explorer.
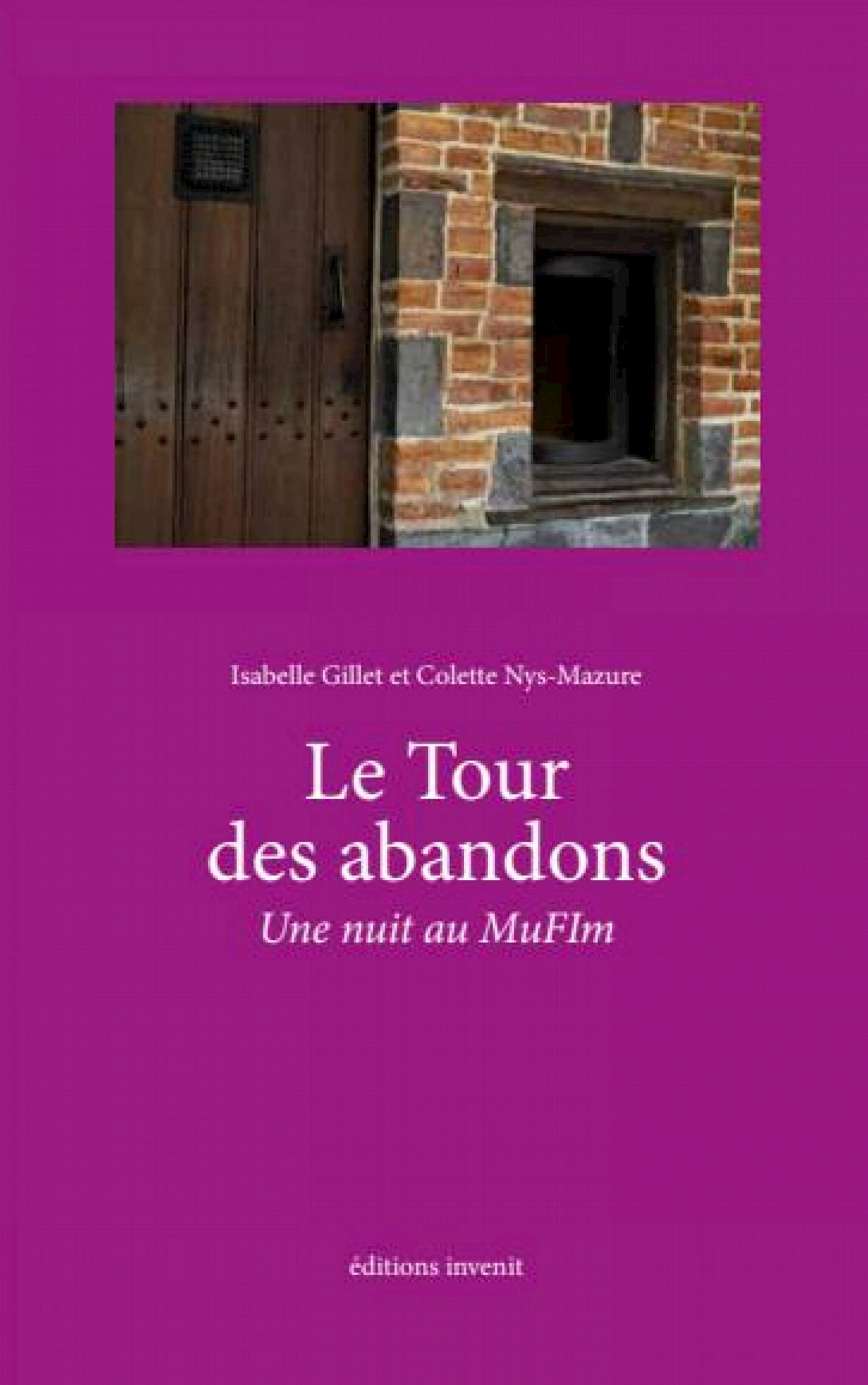
Chiara Zampieri : Vous avez vécu cette expérience d’enfermement et d’écriture en duo. Selon vous, qu’est-ce que cela a apporté à l’expérience d’être à deux ?
Colette Nys-Mazure : L’agrément entre nous c’est que nous nous comprenons à mi-mots. Il n’y a pas beaucoup de personnes avec qui on peux parler si spontanément. Il y a beaucoup de gens qui, dans le discours, ont besoin d’un lien rationnel et qui dans la conversation décousue sont perdus. Avec Isabelle, il y a une complicité immédiate, nous sommes à l’aise l’une avec l’autre et il n’y a pas besoin de tout dire ou de tout expliquer.
Isabelle Gillet : Je me souviens de la première fois que j’ai rencontré Colette et puis notre amitié s’est tissée dans la vie, dans le lien. Il y a une très belle énergie de création entre nous. Lorsque je parle ou discute, il m’arrive d’avoir parfois un maillon qui saute dans le raisonnement. Tout va tellement vite. Avec Colette, ce n’est jamais un problème, elle attrape le maillon qui a sauté.
Chiara Zampieri : En lisant votre récit, il est clair que le MuFIm est un musée qui vous tient particulièrement à cœur et que vous visitez régulièrement. Dans quelle mesure ce rapport au musée a affecté votre expérience nocturne ainsi que votre mise en récit de l’espace muséal ? Dans quelle mesure l’expérience aurait-elle été différente dans un musée que vous connaissez moins et auquel vous êtes moins attachées ?
Colette Nys-Mazure : Je suis arrivée dans cette ville (Tournai) quand j’avais sept ans et ma famille, mes deux familles, sont originaires du coin. Je ne sais pas combien de dizaine de fois je suis venue visiter ce musée : je suis venue enfant, je suis venue quand j’étais dans les mouvements de jeunesse, je suis venue avec mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, les étrangers qui viennent chez-nous… Je ne sais vraiment pas combien de fois je l’ai vu, ce musée. Et pourtant, chaque fois c’est différent. J’ai toujours le sentiment que rien n’est jamais achevé, que le musée n’est jamais exhaustif et que chaque visite est une nouvelle aventure. Ensuite, il faut dire que dans ce musée, tu es littéralement prise dans les bras d’une ville, le MuFIm est très central. Pour s’en rendre compte, il suffit de regarder la vue de la fenêtre de la salle du rez-de-chaussée : il y a la cathédrale et le beffroi. Quand nous sommes arrivées au musée pour y passer la nuit, on était en septembre, le soir tombe vers 21h00, et à travers la fenêtre nous pouvions voir la cathédrale et le beffroi illuminés, nous entendions les cloches qui sonnaient et le bruit de la Grand Place qui est juste à côté. On ne peut pas expliquer comme c’est chaleureux ici. C’est un musée qui est comme une maison.
Isabelle Gillet : Je pense que la même expérience dans un autre musée aurait été complètement différente. D’abord, il y a la structure du musée. Même s’il peut avoir l’air petit, ce musée a en réalité une prise d’espace significative et une structure plutôt complexe. Il serait réducteur de dire qu’il s’agit simplement de deux maisons reliées par un pont. Il n’est pas évident de l’embrasser dans sa totalité, de se le représenter par sa structure. Ensuite, il faut également penser à la nature de la collection de ce musée, puisqu’il s’agit d’un musée des artisanats et des commerces. Le MuFIm est ce qu’on pourrait appeler un « musée modeste ». Il y a un choix volontaire de notre part que ce ne soit pas un musée de Beaux-Arts ou d’art contemporain.

Chiara Zampieri : Pourquoi ce choix de ne pas aller dans un musée de Beaux-Arts ou d’art contemporain ?
Colette Nys-Mazure : D’abord, il faut préciser qu’au MuFIm il y a beaucoup d’éléments contemporains. Le musée tient à entretenir un dialogue continu avec les artistes d’aujourd’hui. En ce qui concerne le choix de ce qu’Isabelle appelle un « musée modeste » – j’aime bien cette notion qu’elle reprend à Orhan Pamuk – j’aimerais ajouter que personnellement je choisis souvent d’aller visiter, dans différentes villes, les musées d’art populaire. Il me semble que pour comprendre l’épaisseur d’une ville, c’est dans ce type de musées qu’il faut entrer.
Isabelle Gillet : Orhan Pamuk apporte aussi une réponse à cette question. Avec Serge Chaumier, nous avions édité en 2020 une petite anthologie intitulée Le Goût des musées2 et le texte cité de Pamuk constitue un véritable manifeste pour les musées qu’on regarde moins et qui parlent autrement, les musées de la vie quotidienne, de l’extraordinaire du quotidien. Les musées qui nous parlent de grands-parents, d’objets qu’on reconnait dans nos maisons, ou dont nous nous souvenons. Dans ces musées, il y a une proximité, une familiarité qu’on ne retrouve pas ailleurs et qui fait aussi partie du choix que nous avons fait. Nous avons aussi choisi un musée qui fait bouger les frontières et dans lequel j’avais déjà travaillé avec mes étudiants. Pendant le Covid, nous avions réalisé le site web « Un musée à soi ». C’est une exposition en ligne, un parcours, une lecture féministe de la collection du MuFIm. Et puis, le MuFIm est un musée belge, un musée tournaisien, un musée du cœur. Il y a tout cela dans notre choix. Même si d’une manière ou d’une autre la collection « Ma nuit au musée » de Stock nous a forcément inspirées, nous avons également choisi de nous en démarquer, je crois. La collection « Ma nuit au musée » collabore avec des musées qui sont des blockbusters, comme le Musée Picasso ou le Centre Pompidou. Le MuFIm, pour sa part, est un « musée modeste », avec des moyens plus réduits. Nous nous sommes démarquées de la collection Stock par le choix du musée, certes, mais aussi par le fait d’être deux et qui plus est, deux femmes de deux générations différentes, de deux nationalités différentes. Nous avons également choisi une édition indépendante. Enfin, dans la collection « Ma nuit au musée », les auteurs parlent tous du silence et de la notion d’enfermement, ce qui les amène à des chemins très autobiographiques. Pour nous, ce n’était absolument pas le cas. Nous étions harcelées par le blanc du néon.
Colette Nys-Mazure : Oui. Les néons s’allumaient avec le mouvement. Ce qui fait qu’il a été très difficile de trouver un endroit où fermer l’œil. Et puis le bruit du néon… Ce fait d’être toujours sous la surveillance du néon nous a rappelé ces salles de torture où la lumière ne s’éteint jamais. Nous avons découvert ce côté de toujours sous surveillance constante avec étonnement, puis nous l’avons apprivoisé. Il y a eu beaucoup d’éléments insolites, comme celui-ci, qui finalement ont été amusants aussi. Pour nous c’était vraiment un plaisir sans ombres, tandis que beaucoup d’auteurs qui écrivent dans la collection Stock commencent par vous dire qu’ils n’aiment pas les musées, qu’ils n’avaient pas envie d’y passer une nuit ! Nous, pour notre part, nous nous sommes vraiment engouffrées dans le plaisir, qui n’a pas manqué d’être au rendez-vous.
Chiara Zampieri : Avant ce projet, aviez-vous déjà eu l’occasion de collaborer avec le MuFIm en qualité d’écrivaines ?
Isabelle Gillet : Nous avions déjà collaboré avec le musée dans le cadre du projet Quand l’art joue à cache-cache au MuFIm3, un livre sur la présence de 192 œuvres d’art contemporain cachées dans le musée. Avec Colette nous avons participé à ce projet et donc nous savions que la présence de l’art contemporain au MuFIm était un sujet déjà bien traité. Cela explique pourquoi, dans Le Tour des abandons, cet aspect-là n’est pas très présent.
Chiara Zampieri : Quelles étaient vos attentes, vos espoirs et vos craintes en acceptant de passer une nuit au MuFIm pour ensuite en faire matière à écriture ?
Colette Nys-Mazure : Nous nous sommes dit qu’on allait y aller vierges et sans projets. N’est-ce pas Isabelle ?
Isabelle Gillet : Tout à fait. Je n’étais pas en attente, car une attente suppose une intention ou un projet. C’est un peu idiot mais j’ai pris cette soirée comme une soirée pyjama entre amies. C’est quelque chose qui va au-delà de l’attente, c’est plutôt… quelque chose de profond, qui enracine. Je pense que c’était vraiment une qualité de présence. Le fait d’être ici et maintenant.
Chiara Zampieri : Concrètement, comment cette initiative a-t-elle été mise en place ? Comment s’est passée la collaboration avec le musée ? Y avait-il un cahier des charges ou des consignes précises qui vous ont été données ?
Colette Nys-Mazure : Nous avons été très bien accueillies par Jacky Legge. Il nous attendait au musée lorsque nous sommes arrivées. Il nous a dit qu’il avait prévenu l’entourage pour que les gens ne s’inquiètent pas en voyant de la lumière dans le musée et finissent par appeler la police. Il nous a informé qu’il avait débranché les alarmes. Il nous a fait totalement confiance.
Isabelle Gillet : Nous n’avions pas de consignes précises. Nous avons même emmené nos affaires pour dormir. Il n’y avait rien qui avait été préparé pour nous. J’ai vu que dans « Ma nuit au musée », les auteurs ont toujours un lit de camp qui est mis à leur disposition et sur lequel ils sont pris en photos. Pour nous, c’était vraiment la bonne franquette, ils ne se sont pas posés la question de notre corps, nous sommes venues chacune avec notre propre matériel.
Chiara Zampieri : Vers la fin du livre, vous dressez une liste de toutes les choses que vous n’avez pas faites pendant votre nuit. Pourquoi ce choix ?
Colette Nys-Mazure : C’était une idée d’Isabelle. C’était un écho de Perec, notre amour commun. Un des ateliers d’écriture que nous avons conduits ensemble et l’exposition au musée des Beaux-Arts de Lille, « Prière de toucher », y sont peut-être aussi pour quelque chose. Finalement, tout ce que nous faisons ensemble a toujours des arrière-pays, des arrière-fonds communs.
Isabelle Gillet : C’est le côté un peu mutin, peut-être. C’est quelque chose qui nous est venu à la fin, pendant la phase de réécriture.

Chiara Zampieri : En lisant le livre, on ne peut pas s’empêcher de se demander : mais qu’est-ce qu’elles ont vraiment fait toute la nuit ? Avec cette liste, nous avons la réponse… mais à l’inverse !
Isabelle Gillet : Nous avons mangé, papoté, regardé, j’ai dansé…
Colette Nys-Mazure : Oui, moi j’ai même dormi une petite demi-heure et c’est la seule chose que j’ai faite qui pourrait être répréhensible, puisque je suis allée dormir dans le petit lit qui se trouve au premier étage !
Isabelle Gillet : Finalement, je crois que c’est cela aussi la familiarité que nous évoquions tout à l’heure. Nous sommes arrivées au musée et nous nous sommes d’abord installées dans les fauteuils de cinéma du rez-de-chaussée, puis nous avons marché, nous nous sommes assises sur les marches des escaliers et lorsqu’il était 05h00 Colette, malgré quelques réticences, s’est allongée sur le matelas du premier étage. Je crois que tout ceci a pu se produire précisément parce qu’au MuFIm nous nous sentions vraiment à la maison.
Colette Nys-Mazure : J’ai même mis ma couverture pour ne pas violer les draps du lit… !
Chiara Zampieri : Assez tôt dans votre récit et en passant par une référence à Julien Gracq, vous comparez votre posture d’écrivaines à celle de « cueilleurs sans préméditation ». Pourquoi cette association et comment s’est-t-elle imposée à vous ? Que représente « le cueilleur » pour vous ?
Isabelle Gillet : Julien Gracq distingue l’écrivain-chasseur du cueilleur. Le chasseur, qui sait qu’il veut la proie et qui a l’intention de la chasser, a une structure, un plan et une méthode en tête. Puis, il y a l’écrivain-cueilleur. L’esprit de cueillette, dans lequel nous nous sommes reconnues, est celui de quelqu’un qui s’amuse à butiner, glaner. C’est ce que nous avons fait. Pendant la nuit, nous n’avons pas utilisé d’enregistreur. J’avais un petit cahier et Colette aussi. Je notais tout avec un seul crayon, donc je n’ai pas fait de distinction entre ce que moi je disais et ce que Colette disait. J’ai noté ce que nous disions, mais aussi ce que je pensais. Tout. En linéaire. C’était un flux, une matière qui n’était nullement organisée ou structurée. Nous n’avions vraiment aucun plan d’écriture en tête pendant la nuit.
Colette Nys-Mazure : Oui, nous sommes passées de l’informe à la forme. C’est aussi ma manière de travailler, toujours dans l’abondance. Je n’aime pas avoir un plan. Chacun a sa méthode et avec Isabelle il s’avère que nous avons la même façon de faire : celle du cueilleur.
Chiara Zampieri : Comment s’est déroulée la phase d’écriture du livre ? A-t-il été difficile d’écrire en binôme ? Avez-vous rencontré des défis particuliers ?
Isabelle Gillet : Après la prise de note en direct, il y a eu une phase de réécriture et de structuration. Une fois qu’une structure a été posée, nous avons dégraissé et affiné le texte. J’ai adoré ce travail sur le long cours, avec Colette nous nous voyions toute une journée, régulièrement, toutes les trois semaines, nous nous relisions, toujours à deux, et toujours dans une grande liberté. Lorsque chacune relisait de son côté, nous annotions et ensuite nous commentions ensemble. Nous ne sommes jamais intervenues seules sur le manuscrit, nous nous parlions.
Colette Nys-Mazure : Puis il s’agit d’un livre dans lequel figurent beaucoup de citations, donc nous travaillions aussi avec beaucoup d’autres livres pour avoir des précisions ou pour vérifier des informations. Nous ne voulions pas que ce soit un livre informatif, dans le sens d’un livre historique, mais il existe de grands spécialistes de Tournai et nous ne voulions pas dire de bêtises sur la ville ou sur son histoire. Nous avons toujours essayé de nous renseigner.
Isabelle Gillet : Et le livre a été relu par plusieurs personnes, toutes très investies : Jacky Legge, Jeanne Delmotte, Dominique Tourte, mais aussi Françoise Lison-Leroy et Michèle Gazier qui ne connaissait pas le musée et qui avait donc un regard extérieur. Durant la phase d’écriture nous nous sommes aussi beaucoup documentées, nous avons posé des questions, rencontré des archivistes, nous avons lu des livres sur Tournai, surtout moi, puisque Colette a une grande connaissance de la ville, de ses chansons, du vécu, des coutumes, des usages, des mœurs… mais aussi du picard, qui finalement est ce qui nous a amené vers le tour des abandons.
Chiara Zampieri : Parmi les centaines d’objets présents dans le musée, vous avez-choisi Le Tour des abandons pour le titre de votre ouvrage. Quelles sont les raisons qui vous ont amenées à faire ce choix ? Quelles ont été vos réactions face à ce mécanisme destiné à recevoir des enfants abandonnés ?
Colette Nys-Mazure : Le tour des abandons est un peu l’objet sacré du musée. Il incarne un côté pathétique, un peu people, mais en même temps il a quelque chose de tellement actuel. Encore aujourd’hui, il y a des enfants qui sont retrouvés dans des poubelles, c’est encore mieux le tour des abandons. De mon côté, je l’ai choisi parce que j’étais plus rivée à un passé tournaisien et à l’idée d’évoquer une pièce centrale du musée.
Isabelle Gillet : De mon côté, je crois que j’en suis venue à le choisir par le truchement du picard : une chanson en picard, « Les Tournaisiens sont là », se déclenche au passage dans l’une des salles du rez-de-chaussée, par exemple. Dans notre livre, nous avons hybridé notre langue d’expressions picardes. Nous allions vers une langue bâtarde. Les enfants bâtards abandonnés n’ont pas reçu leur langue de la mère. Le tour des abandons est donc devenu le pivot du livre, son centre. Il structure le livre. L’idée était que toutes les deux, Colette et moi, en tant que mères, prenions ce musée dans nos bras.
Colette Nys-Mazure : Ce qui est intéressant est aussi que les enfants laissés dans le tour ne sont pas des enfants perdus, mais des enfants confiés. Ce sont des enfants qui ont été confiés à d’autres mains : soit parce que les parents n’avaient pas les moyens de les élever, soit parce qu’il s’agissait d’enfants illégitimes. C’est quelque chose de très polysémique… C’est pour cette raison qu’ il y a deux images du tour dans notre livre : une avec un bébé – et c’est ainsi que je l’ai connu enfant – et l’autre vide – ce qui est beaucoup plus suggestif car dedans on peut y mettre ce qu’on veut.
Isabelle Gillet : Je préfère que le tour soit vide, comme sur la photographie de couverture du livre. C’est un « lieu » magnifique… je sais bien ce qu’il représente, mais c’est aussi un lieu d’accueil, de sauvetage. Le lieu où le destin va tourner. Il y a quelque chose dans ce tour qui renvoie à une ouverture. Finalement, cela rejoint le côté imaginaire qui se trouve dans le nom du musée. Est-ce que, en dehors d’ici, tu connais un autre musée qui a mis le mot imaginaire dans son nom ? C’est extraordinaire.
Colette Nys-Mazure : Le nouveau nom du musée4 – MuFIm – a été très difficile à accepter. Les gens sont très attachés à l’idée de ce musée en tant que musée de la vie tournaisienne, musée du folklore. Lorsque Jacky Legge a proposé de changer le nom en MuFIm, il y a eu beaucoup de réticences et beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés à admettre le changement et l’évolution de l’institution.

Chiara Zampieri : Pourrait-on affirmer que le choix du titre Le Tour des abandons participe à une tentative de valorisation du patrimoine du MuFIm ?
Isabelle Gillet : Ce titre nous a été proposé par l’éditeur, Dominique Tourte. La proposition a été faite avec les amis du musée et cela montre bien qu’ils ont eu le désir de participer. Il faut savoir qu’ils ont financé le livre. Il était important pour les amis du musée que le tour des abandons soit sur la couverture.
Colette Nys-Mazure : Le titre aurait pu être simplement « Une nuit au MuFIm », qui est passé en second. Dominique Tourte a vraiment eu une bonne intuition.
Isabelle Gillet : Oui. Au départ, nous avions cinq ou six propositions de titres à débattre. Dominique Tourte cependant tenait particulièrement à ce qu’il y ait une référence explicite au MuFIm. Nous avons tout de suite été à l’unanimité pour Le Tour des abandons. Une nuit au MuFIm, un titre qui avait quelque chose de mystérieux, de poétique, et qui était moins descriptif. Le débat a toujours coulé de source, nous avons pu arriver très vite à nous mettre d’accord sans heurts. Le point de vue de l’éditeur et de tous ceux qui ont participé à la production de ce livre, qui est un point de vue extérieur, a été important pour la réalisation de ce projet.
Colette Nys-Mazure : La ville aussi a participé, puisqu’ils ont payé le vernissage. Il faut dire que Jacky Legge avait beaucoup d’entrées partout, mais j’ai été étonnée du fait que finalement qu’il n’y ait pas eu la nécessité d’une intervention financière de la part de Dominique Tourte pour la production de ce volume. Tout a été offert.
Isabelle Gillet : Effectivement, il y a eu tout un soutien autour de ce projet qui fait que le processus de composition et de publication a été très rapide. Une fois que nous avons terminé le manuscrit nous l’avons confié à l’éditeur qui a effectué son travail de relecture. Une graphiste, Océane Tiberghien, qui était en apprentissage aux éditions invenit a ensuite eu l’idée d’ajouter en tête de page une ligne avec la lune qui transite et avance tout au long du livre, et qui est censée suggérer le passage du temps. J’ai trouvé l’idée géniale.
Chiara Zampieri : Votre livre témoigne aussi d’une grande attention pour les femmes et pour leur condition. Qu’est-ce qui vous a amené à lire le musée à travers ce prisme ?
Isabelle Gillet : On peut faire une lecture sociologique, politique, même féministe de ce musée. Aujourd’hui, au MuFIm, il y a une grande attention qui est portée aux femmes à la fois dans les objets traditionnels et dans les œuvres d’art contemporain exposées. Le musée témoigne très bien du fait que la situation des femmes, au xixe siècle, n’était pas simple. Avant, Jacky Legge avait déjà commencé à donner aux salles des noms de femmes ou à mettre en valeur, par exemple, des veuves qui ont repris des entreprises. Nous avons choisi de nous inscrire dans cette continuité : nous sommes deux femmes et qui plus est, deux femmes qui s’enthousiasment de la chance qu’elles ont de vivre au XXIe siècle en France et en Belgique, des pays qui valorisent la femme, qui protègent ses droits et où les figures de pionnières sont moins invisibilisées qu’ailleurs. Il faut également préciser que, dans notre livre, nous ne voulions pas valoriser que des femmes. Nous citons des femmes5 et des hommes. Nous avons essayé de créer un équilibre. Tout cela et peut-être aussi le fait d’avoir mené à bien le projet « Un musée à soi » avec les étudiants de master a fait que dans le livre la perspective féministe, qui est aussi une perspective de mère, passe aussi par ce geste d’accueil qui est celui du tour des abandons.
Chiara Zampieri : Colette Nys-Mazure, en 2016 vous aviez déjà eu l’occasion de collaborer avec les éditions invenit dans le cadre de leur collection Ekphrasis. Pourriez-vous revenir brièvement sur cette expérience qui reposait elle aussi sur une invitation à écrire un texte inspiré par différents tableaux6 ? Dans quelle mesure l’expérience au MuFIm a-t-elle été différente ?
Colette Nys-Mazure : Ce qu’il y a de commun entre cette expérience et celle que j’ai faite pour la collection Ekphrasis, c’est le côté incorporé. Pour tous les tableaux sur lesquels j’ai travaillé pour la collection Ekphrasis, j’ai à chaque fois été presque une heure assise devant le tableau avec Dominique Tourte, qui m’accompagnait. Pour chaque tableau, nous sommes restés une heure à regarder, à s’en imprégner, en échangeant des remarques. Au LAM, par exemple, nous sommes restés, pendant une heure, assis sur ces petites chaises de musée devant Maternité de Modigliani. Pareil à Douai, même si à Douai, au départ, nous avions pensé à un autre tableau qui finalement s’est révélé beaucoup plus fade. C’est alors que nous sommes tombés en amour pour le trésor de ce musée : Le Reniement de saint Pierre. Pour Vallotton, nous ne sommes pas allés ensemble avec Dominique Tourte, je suis allée seule à l’exposition. Mais le principe est vraiment de s’imprégner, sans a priori, de regarder et puis petit à petit d’attirer l’attention sur un détail, une forme, une couleur, une mise en espace, vraiment de progresser dans le tableau. Ensuite, il a fallu laisser germer en moi ce qui a été semé devant le tableau. Il y a tout un travail d’information, dans lequel lire, aller voir d’autres expositions… Pour Vallotton, j’ai vu d’autres tableaux et gravures et j’ai même lu son roman La Vie meurtrière (1907). Il y a par la suite un travail d’approfondissement de ce que tu ressens spontanément sur le moment, en observant le tableau. Il y a alors la phase d’écriture. Pour Ekphrasis, il y a eu, à chaque fois, ce type de travail. Pour la nuit au MuFIm, j’ai eu une nuit entière pour observer ce qui m’entourait. Une nuit c’est quand-même douze heures, et nous étions à deux. Certes nous étions à deux aussi avec Dominique Tourte, mais avec Isabelle cette proximité a duré toute une nuit et elle n’a fait qu’approfondir une amitié qui existe entre nous depuis toujours… En ce qui concerne la phase d’écriture, avec Isabelle j’ai travaillé comme pour la collection Ekphrasis. Nous avons laissé reposer le texte. Nous avons écrit et réécrit : l’écriture de ce texte nous a pris neuf mois.
Isabelle Gillet : Le temps d’une grossesse ! Effectivement, je partage ce que dit Colette à propos de s’imprégner. Nous nous sommes imprégnées de tout, du son des cloches, des voix et des appels de l’extérieur, des objets… Cette disponibilité aux tableaux et aux objets dans le compagnonnage fait qu’il n’y a pas eu Narcisse croisé au coin de la salle. Il n’y a rien de narcissique qui puisse arriver de par cette incorporation, de par ce lien.
Chiara Zampieri : Isabelle Gillet, vous êtes, outre qu’écrivaine, commissaire d’exposition et professeure des universités à l’Université d’Artois. Dans quelle mesure les discours muséal et académique vous ont influencée dans cette expérience, que vous avez été invitée à vivre in primis en tant qu’écrivaine ?
Isabelle Gillet : Ce regard, qui finalement est un regard d’érudition, fait partie de moi et il est toujours présent. Je ne suis pas scindée en deux. C’est vraiment une forme d’approche comme une autre. Je dirais qu’il s’agit d’une strate parmi d’autres à l’intérieur de moi. C’est possible que ce regard m’ait rendue sensible à des choses en particulier… Finalement, les savoirs auxquels j’ai accès, je ne les rejette jamais. Ils sont là et je les intègre. Mais il n’y a pas de surplomb. En tant qu’écrivaine, je ne suis pas dans un rôle, je ne suis pas en train de m’adresser à des étudiants ou à des professionnels et cela fait la différence. Mon discours est complètement différent.
Chiara Zampieri : Vous ouvrez votre récit par une description multisensorielle du musée qui passe par une série de sections riches en synesthésies, chacunes consacrées à l’un de cinq sens. Pourquoi cette attention portée à l’espace physique du musée tel qu’on peut l’appréhender avec le corps et les sens ?
Isabelle Gillet : Les cinq sens sont très importants. C’est parce que nous avons des corps, nous sommes des corps. Ce n’est pas pour être dans la pratique actuelle de la visite sensorielle, c’est parce que nous avons des sens et qu’au MuFIm il y a beaucoup de matière qui nous remet dans notre corps. Il suffit de penser à la présence de cette chanson en picard, « Les Tournaisiens sont là ». Puis, tout au long de la nuit, notre corps était bien en action. Nous n’étions pas dans l’irrévérence ou dans l’irrespect, mais nous touchions et nous essayons d’utiliser les objets exposés.
Colette Nys-Mazure : Oui, il y a vraiment quelque chose de corporel, de charnel au MuFIm. Puis, il nous a semblé plus simple pour le lecteur si nous jalonnions le livre avec des repères concrets. Il y a ce que nous ressentons, mais aussi cette difficulté de le communiquer à l’autre. Il faut se situer ni trop près, ni trop loin. Il faut que le livre se situe entre les deux et, pour cela, qu’il y ait des repères.
Chiara Zampieri : Tout au long du récit, vous établissez des parallèles entre l’espace muséal et la langue au point que la disposition des objets qui vous entourent semble « créé[r] une grammaire » vous incitant à « déplacer la syntaxe » et à « invent[er] des mots ». Comment ce parallèle s’est-il imposé à vous ? Dans quelle mesure le musée vous a-t-il poussées à formuler des réflexions non seulement sur la langue et sur les mots, mais aussi et surtout sur votre travail d’écrivaines ?
Isabelle Gillet : Il faut partir du constat que, dans ce musée, il y a très peu de textes ou de cartels. Dans certains cas, comme pour le tour des abandons, nous avons cherché du texte et nous avons ainsi recopié mot à mot les deux documents qui contiennent les actes de naissance d’enfants laissés dans le tour. Par son absence de trop de bavardage, le musée a donc été un bon déclencheur pour l’invention de quelques mots. Pour nous, cependant, c’était moins une recherche active du texte qu’un jeu poétique, puisqu’avec Colette, nous nous rencontrons en poésie. Ce qui nous rapproche c’est une envie de réveiller et de vivifier la langue par des verbes, des infinitifs, des déplacements des catégories reçues… Autant le MuFIm fait bouger les frontières, autant nous essayons de faire de même avec la langue et ses catégories grammaticales, lexicales ou syntaxiques. Le geste est le même, même si la matière est différente. Dans ce musée il y a beaucoup de langues. Il n’y a pas que le français. Entrer dans le musée a aussi signifié pour nous entrer dans des cultures plurielles : la culture française, belge, wallonne, picarde… Il y a ici une véritable pluralité.
Colette Nys-Mazure : D’ici aussi la question de la langue maternelle. Ici, notre langue maternelle est le picard, une langue très riche et proche de l’ancien français, qui est très présente dans ce musée. Nous ne pouvions pas en faire l’économie. Voilà pourquoi le livre est parsemé de phrases ou de rimes en picard. En même temps, il était aussi question de dosages. Il ne fallait pas en mettre trop, autrement le livre aurait été réservé aux seuls Tournaisiens.
Isabelle Gillet : Nous nous sommes également beaucoup interrogées sur la question de la traduction. Faut-il traduire ou pas les chansons, les rimes, les expressions… ?
Chiara Zampieri : D’après votre expérience, quel a été votre apport d’écrivaines au patrimoine et, inversement, qu’a apporté le patrimoine du MuFIm à votre écriture ?
Isabelle Gillet : En tant qu’écrivaines nous avons essayé de mettre ce patrimoine en joie. Ensuite, nous avons écrit, à un moment donné, une scénographie particulière du musée. Donc notre texte constitue en quelque sorte aussi une forme d’archive, de mémoire, d’instantané de ce que le musée a été au moment où il passait en relais d’un conservateur à une conservatrice, d’une génération à la génération suivante. Finalement, le patrimoine est aussi dans ce moment de passage de relais, une façon de transmettre quelque chose. L’un des apports du patrimoine a peut-être été le souci d’être justes dans l’approche de ce patrimoine. Lors de cette expérience nous avons été obligées d’être précises, sans pour autant être dans une écriture documentaire. Nous étions dans l’imaginaire, certes, mais en même temps dans le respect des dates, des faits, des noms, du matériel d’archive… Les noms des enfants abandonnés dans le tour des abandons, par exemple, ne sont pas le fruit de notre imagination. Cependant, je ne dirais pas que ce que le patrimoine nous a apporté est de l’ordre de la lourdeur. Au contraire, il nous a apporté, avec allégresse, des ouvertures et des passages entre des strates, des générations, des objets qui ne vont pas forcément ensemble dans la vie de tous les jours.
Colette Nys-Mazure : Le fait que nous sommes dans un lieu patrimonial mais qui fait partie de notre vie, qui est lié à des moments de notre vie, ne fait qu’ajouter des strates à la construction de nos existences. Nous avons eu la chance de pouvoir traverser une nuit dans ce musée, nous avons eu la chance d’habiter pendant douze heures ces lieux et c’est ce qui a fait la différence. Le patrimoine du MuFIm est devenu, pour nous, un patrimoine vécu que nous avons absorbé plutôt que simplement traversé. Le musée nous a beaucoup donné, mais il est possible que nous aussi, avec notre livre, avons participé d’une manière ou d’une autre à la transformation du musée, puisque ce musée ne cesse pas de se transformer et d’évoluer. Peut-être aussi que Le Tour des abandons donnera envie à d’autres écrivains de refaire l’expérience.