La misère créatrice
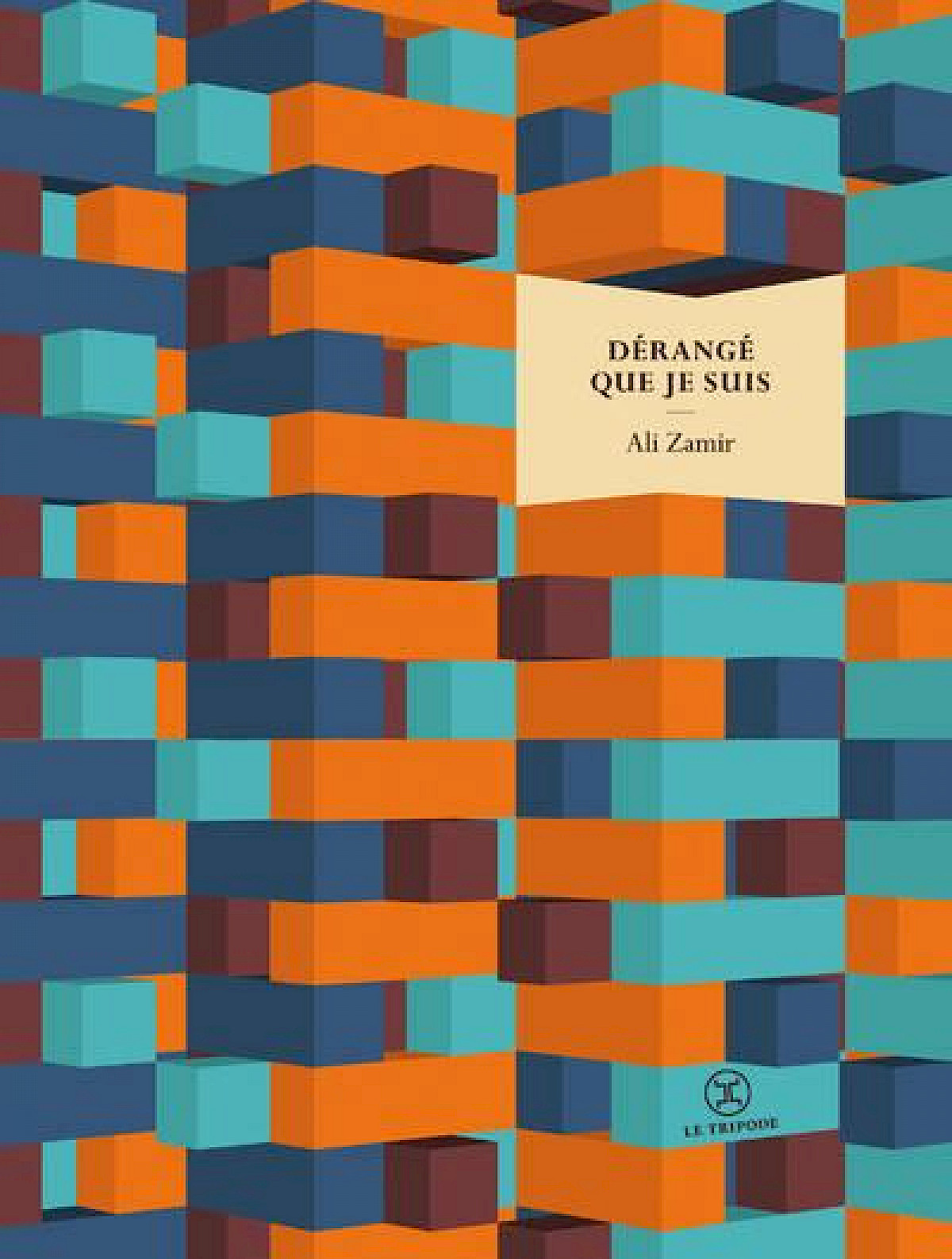
Une plongée dans la littérature africaine offre toujours son lot de magique créativité. Confirmation avec Dérangé que je suis de l’auteur comorien Ali Zamir, qui publie son troisième roman aux éditions Le Tripode.
Dérangé est docker, enfin, plus ou moins. Plus ou moins docker d’abord, car le roman se déroule aux Comores, dans un port qui ne ressemble en rien à ceux de chez nous, où les dockers ne déchargent pas les bateaux de façon rangée comme dans notre imaginaire, mais vont plutôt se ruer sur les embarcations de fortune des pêcheurs pour aller revendre sur leur chariot les quelques marchandises achetées, glanées, volées à d’autres. Pas tout à fait héros non plus : notre personnage n’en a ni la stature ni la contenance littéraire. On connaît à peine son identité, on devine son âge. Il subit beaucoup, décide peu. De ce personnage, on connaît pourtant un trait qui constituera son identité : son langue.

Notre docker va en effet raconter ce qui lui arrive en narration simultanée. Petit journalier d’un port d’Afrique, il pousse chaque jour un chariot dézingué pour tenter de gagner deux trois pièces. Au hasard de ses déambulations il rencontre une femme qui lui propose un défi contre les trois caïds du coin, la bande des Pipipi. Un challenge qui va, évidemment, chambouler sa vie. Mais, plus que la plongée dans la vie du seul personnage principal, le lecteur se retrouve surtout plongé dans cet univers de bric et de broc, de guenilles et de mauvaises fortunes.
Ali Zamir racontait dans une interview vouloir parler des misérables, que l’on qualifierait plutôt de miséreux. Pourtant, loin de la lutte sociale hugolienne qu’évoque le terme, Ali Zamir nous invite dans sa fête de la langue française. Mi-pompeuse mi-joyeuse, elle conduit à une perception du monde, pour le lecteur, à l’encontre de l’habituelle description de ce qui n’est, finalement, qu’un bidonville :
L’astre du jour commençait à s’approcher majestueusement de son lit. Dardant ses rayons vespéraux jusqu’aux entrailles de la Terre, il avait cette couleur qui fait mûrir les fruits, frémir les corps et qui chatouille les cœurs. La place Mzingajou était pleine d’ambiance.
Sous le couvert d’une écriture pleine d’images et de couleur, Ali Zamir raconte pourtant la vie d’un travailleur journalier de misère. Dans un entretien livré au quotidien l a Libre Belgique , il déclarait vouloir donner la parole « aux dockers, aux marginalisés, aux victimes qui disparaissent dans le silence, en mer, à cause de la pauvreté, des frontières ».
Zamir confère à ses pauvres un langage beau, lumineux, en dépit de la situation qu’ils vivent. Une sorte de dignité où, à travers leur regard et leurs mots, la réalité ne peut être que belle. Comme cette femme, au cœur de l’intrigue, décrite ici lors de sa première rencontre :
Alors revenons à cette beauté fatale et tentons l’impossible : la peindre en quelques mots. Oui, ce n’était qu’une Vénus. Je ne l’avais pas remarqué sur le port parce qu’elle s’était couverte de ce tissu de coton, formé de six grands carreaux répétant le même motif, qu’on appelle chiromani . Mais là, elle se faisait jour devant moi avec des vêtements qui me montraient un corps angélique et qui me disait quelque chose comme ‘Que penses-tu de ça ?’ Même si je ne voulais pas la regarder, il fallait que mes yeux tombent sur cette merveille et que je prenne le risque de les abandonner à la merci de ce plat divinement cuisiné. Je ne suis pas aveugle, chers amis. J’ai allumé très bien mes quinquets.
Celle que l’on croirait sortie d’une coquille botticellienne est en réalité une femme vulgaire, parce que normale. Non pas un ange descendu du ciel, mais bien une de ces femmes « qui boivent de l’alcool, parlent de sexe ouvertement », explique l’écrivain. Mais, aux Comores, le sujet reste tabou. D’où la nécessité d’écrire : « On n’ose pas en parler, ce qui fait que l’art est emprisonné. En tant qu’artiste, je revendique ma liberté d’expression, et quand j’écris, j’oublie ces barrières, je brave ces interdits, car c’est mon monde à moi », confie-t-il.