
L’Art de perdre d’Alice Zeniter vient d’être sacré « Choix Goncourt de la Belgique » par des étudiants belges, après avoir déjà obtenu le prix Goncourt des lycéens en France. Retour sur ce roman fleuve traversant trois générations d’une famille issue de l’immigration algérienne consécutive à la guerre d’indépendance. Un roman qui pose la difficile question de l’héritage culturel pour la « seconde génération ».
Naïma est issue de la « seconde génération », celle née sur le sol français. Jamais elle ne s’est posée la question de ses origines algériennes, jamais elle n’a mis un pied en Algérie. L’Algérie est entourée d’un feutre de silence familial, un sujet tabou chez elle dont la grand-mère à la langue incompréhensible demeure la seule entité concrète du souvenir. Pourtant, dans le contexte actuel des attentats et de la radicalisation islamiste, son héritage culturel lui est constamment renvoyé, comme si le fait d’être métisse l’incluait nécessairement dans ce groupe « musulman » dont elle se sent pourtant totalement étrangère.
Dans les trois grandes parties de son roman, Alice Zeniter retrace le périple d’Ali, le grand-père de Naïma, les choix qu’il dut faire et qui déterminèrent son départ de la terre natale après la déclaration d’indépendance de l’Algérie ; l’enfance et l’adolescence d’Hamid, le père de Naïma et, enfin, la quête identitaire de la jeune femme. Ces trois générations, chacune à leur manière, revisitent sans cesse la part d’héritage culturel que l’Algérie leur a laissée, questionnent la transmission, interrogent les pertes, redéfinissent une identité propre par l’adjonction de la culture d’accueil.
Il est difficile d’évoquer ce roman sans parler de ses différentes parties, indépendantes les unes des autres, bien qu’elles soient profondément liées par un souci de filiation, qu’elle soit père-fils ou père-fille.
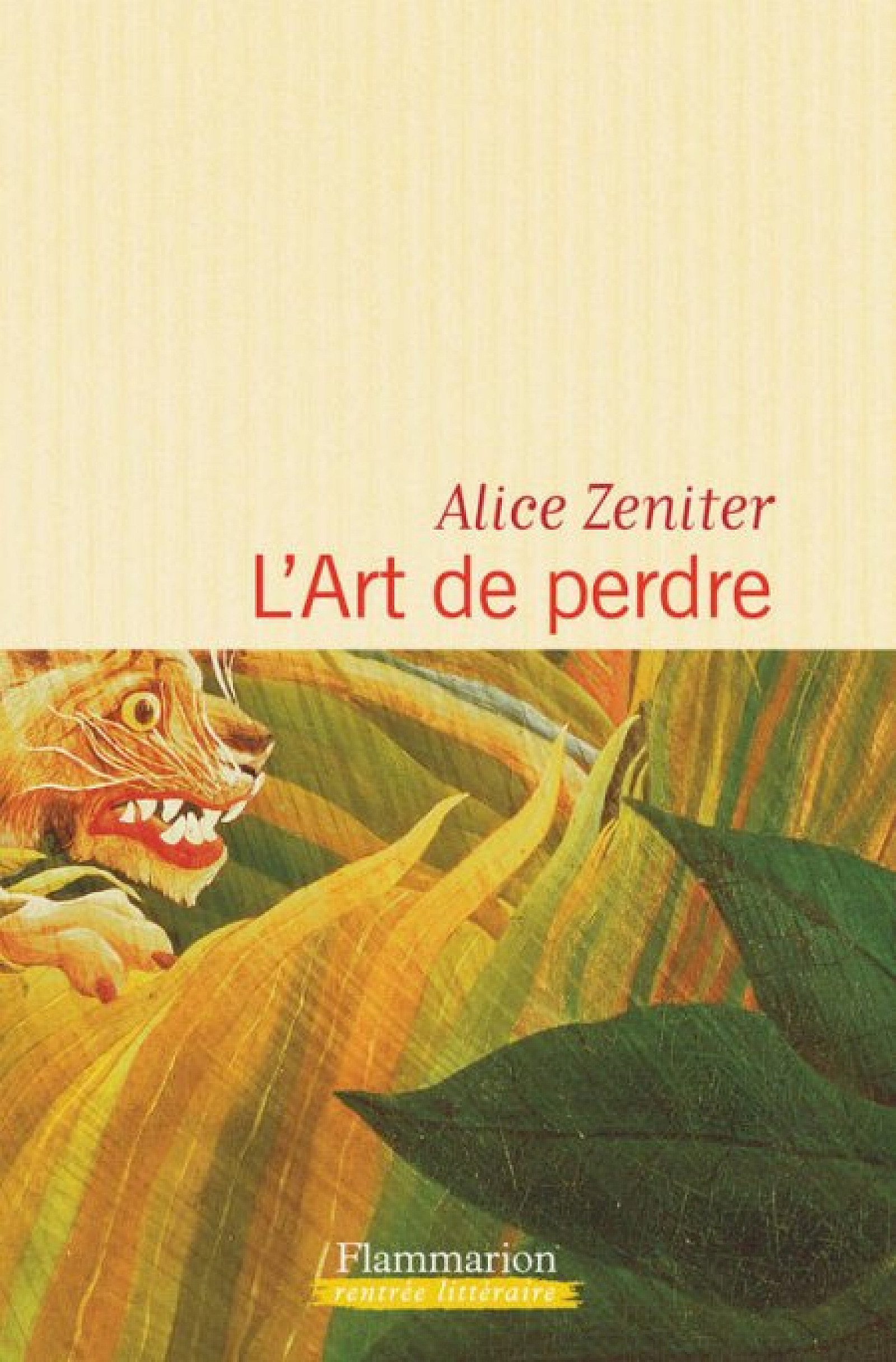
Alice Zeniter retrace tout d’abord les choix du grand-père, Ali, écartelé entre son désir de sécurité pour le village où il fait figure de chef et de principal propriétaire terrien, et les choix difficilement acceptables, car perçus comme pro-français durant la guerre d’indépendance algérienne. C’est ensuite le parcours difficile d’un jeune Algérien, Hamid, propulsé dans un pays, une culture, un système étrangers et racistes où il apparaît comme le réfugié, l’indésirable. C’est ensuite au tour de Naïma ; Naïma qui n’a jamais appris à connaître « sa » culture, ses racines plantées dans ce pays lointain, inconnu et fantasmé.
Ces trois chapitres, dans le roman, possèdent leur identité propre, à l’instar des personnages sur lesquels ils se focalisent ; chacun laisse également place à des sentiments radicalement différents. D’une part, Ali semble dominé par une peur irrépressible d’insécurité pour sa famille, son entourage ainsi que tout le village dont il paraît être la charnière, le repère. Hamid, son fils, confronté aux difficultés d’adaptation dans un pays étranger, semble quant à lui essentiellement mû par la colère de l’injustice dont il est victime, ainsi que par une révolte contenue face au déclassement social de son père, jadis grand propriétaire terrien, suzerain parmi ses vassaux, devenu ouvrier dans une usine dont il subit l’exploitation. D’autre part, Naïma, la petite-fille, nage dans un sentiment d’indifférence face à sa propre histoire familiale, jusqu’à ce que l’actualité lui renvoie à la face la part d’hérédité qu’elle refuse d’accepter et de questionner en elle.
La transition entre ces différentes perspectives se fait naturellement et les protagonistes que la romancière met en scène apparaissent chacun à leur tour en tant que figure complexe dans leur histoire, en recherche d’eux-mêmes, de réponses, sans verser dans un pathos et des clichés trop faciles sur l’immigration. Certes, Hamid donne davantage à voir la violence sociale, symbolique et culturelle qu’exerce la France sur cette famille d’immigrés (le terme est-il bien choisi pour des personnes dont la nationalité française ne pose jamais question ?). Traités en étrangers avant d’être considérés comme Français, ils sont relégués dans des camps, tels des parasites, des parias, relégués dans des coins de France inconnus, rassemblés en villages entiers censés recréer une Algérie factice, par îlots, dans les campagnes de l’Hexagone. Démunis face à ce système, c’est à la débrouille, au courage et à la volonté d’intégration de chacun des membres de cette famille que se crée une nouvelle identité au fil des générations qui évoluent sur ce nouveau sol.
Alice Zeniter rappelle les heures sombres de la France dans cette épopée ; les heures d’une guerre d’indépendance où chacun dut prendre parti, au risque de choisir le « mauvais camp », celui des perdants, et l’incapacité pour le pays d’offrir à ses ressortissants un second foyer. Elle pose un cadre où des questions essentielles s’imposent au lecteur : quelle est la part de responsabilité de la France dans l’accueil de ces immigrés ? Qu’ont été leurs conditions d’accueil ? Pourquoi continue-t-on de nier les violences d’un pays qui se croit – encore à l’heure actuelle – défenseur d’un État de droit à l’épreuve de tout, alors qu’il se révèle incapable de créer un climat propice à la valorisation de ces droits ?
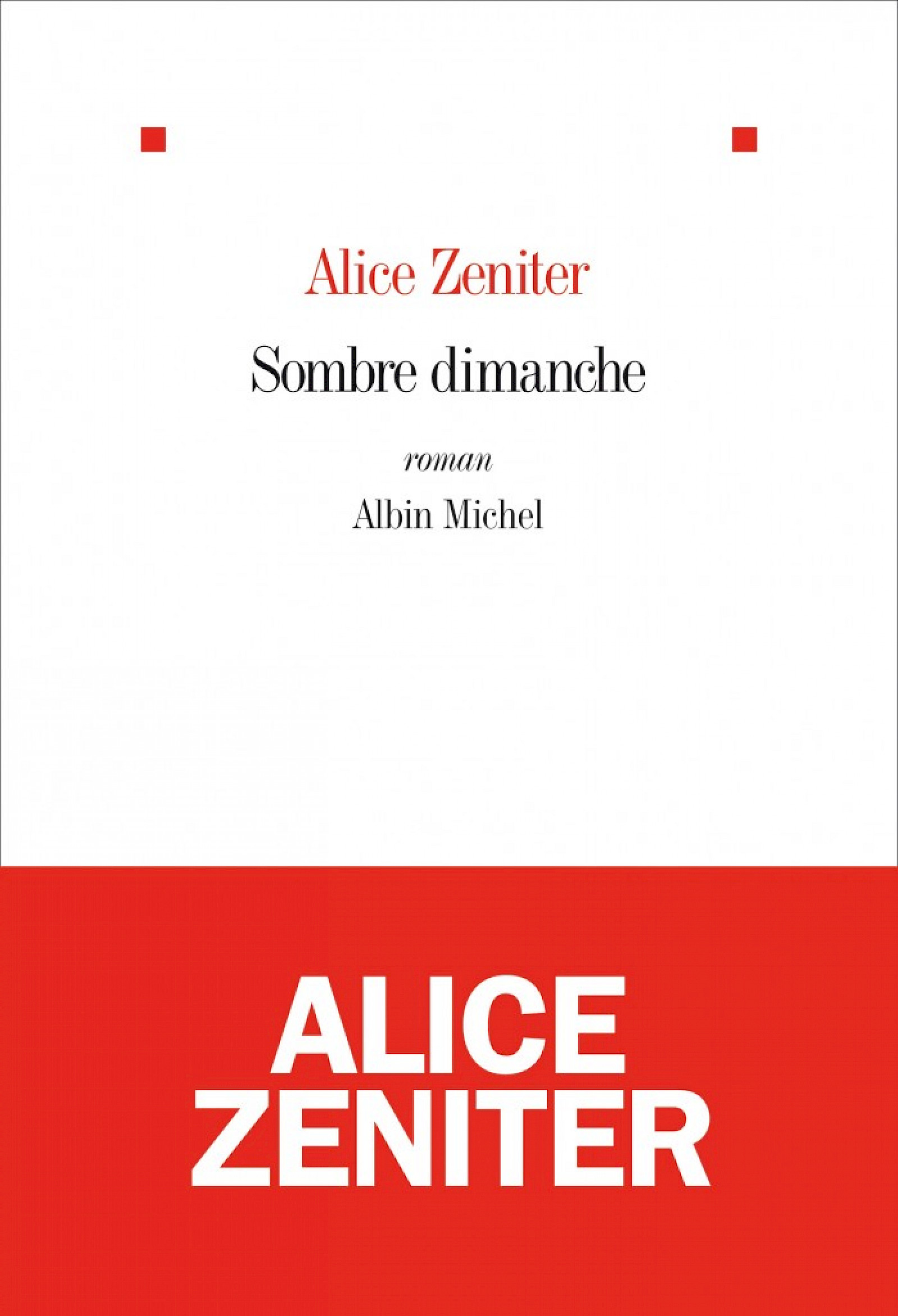
Avec un phrasé accessible, l’auteure s’appuie régulièrement sur un pouvoir d’évocation des sentiments bouleversant de sincérité. Elle nous plonge dans la subjectivité de ses personnages avec une justesse déconcertante. Nous éprouvons leurs dilemmes intérieurs, leurs questionnements, leurs colères et leurs doutes ; la lecture prend un souffle nouveau dès le changement de perspective et de personnage. Les relations entre les personnages sont néanmoins effleurées ; on vit la relation conflictuelle qu’entretiennent notamment père et fils dans la seconde partie du roman, de la même manière qu’on tourne autour du manque identitaire qui creuse un écart entre Hamid et sa fille. L’échange entre les membres de cette même famille paraît superficiel ; l’écrivaine voulait-elle suggérer ces rapports distendus, puisque c’est précisément un manque de repères qu’elle explore ici ? Il s’agit d’une perte , certes, mais qui exige une reconstruction, non pas à la place de ce manque, mais autour, par son acceptation.
Finalement, lorsqu’on referme le roman, on comprend que trois générations consécutives sont nécessaires pour digérer cet héritage. Il laisse un vide en chacun de ses personnages. Ne restent pour eux, comme indices de cette part familiale, qu’une sonorité dans un nom, qu’un pays fantasmé sur des photos jaunies. Car l ’Art de perdre , c’est avant tout consentir à cette part d’insaisissable, pourtant présente, héréditaire, rattachée à son être sans qu’on ne l’ait jamais revendiquée.
Le livre comporte bien des qualités, la première étant de se pencher sur le sort des harkis , ces réfugiés algériens que la France accueillait à contre-cœur. L’auteure, on l’a dit, aborde le sujet avec intelligence et délicatesse. Pourtant, on lui reprochera de tomber dans certains pièges narratifs attendus, le retour au pays « natal » pour Naïma en premier lieu. On sent venir cette quête identitaire dès le début du roman et on n’y coupe pas, mais les bénéfices de ces passages narratifs sont empreints d’une nostalgie à laquelle on ne croit malheureusement pas. Le livre perd ainsi, dans sa dernière partie – la plus décisive – de sa subtilité, si difficilement gagnée par l’évitement des clichés des « pauvres étrangers » dans les deux premières parties du roman. Néanmoins, tout n’est pas gâché, puisque Naïma, malgré son voyage, ne trouve pas réponse à toutes ses questions et laisse en suspens sa propre quête identitaire, consciente qu’elle demeure incomplète et nécessairement liée à un cheminement personnel qu’elle est en train d’éprouver (n’est-ce pas le cas de tous les jeunes gens de cette génération ?).
Au-delà de ce bémol, Alice Zeniter évite de tomber dans l’évocation de la confrontation au racisme en se focalisant sur l’intériorité des personnages et leur construction identitaire. La violence apparaît d’autant plus forte puisqu’elle est profondément symbolique, incarnée d’abord par un système, subi et combattu, plutôt que par des personnages incarnés, qui laisseraient la responsabilité d’État s’évaporer dans leur singularité.