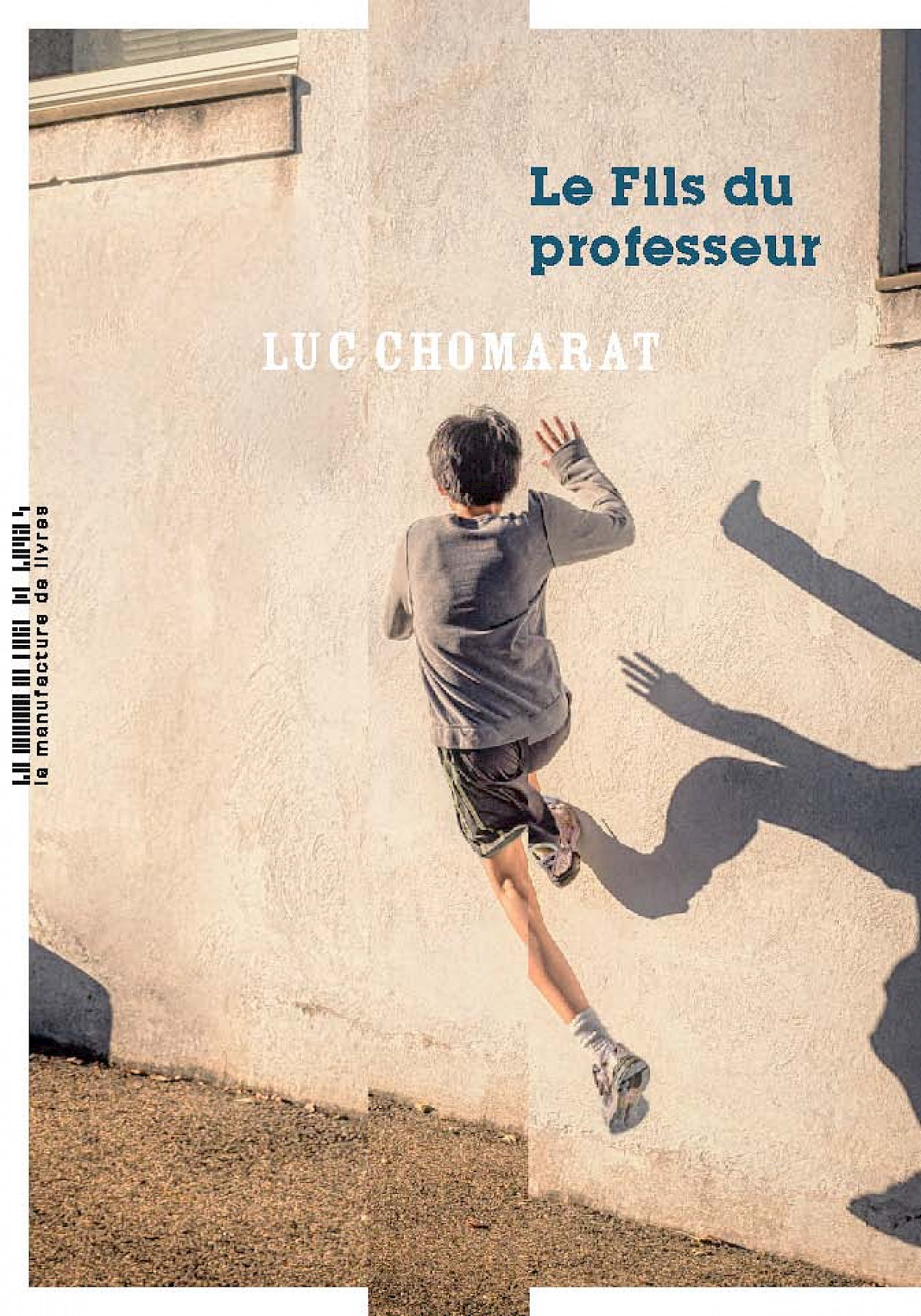
Avec Le Fils du professeur, son huitième roman, Luc Chomarat semble ressasser les diapositives quelque peu ordinaires d’une enfance et adolescence françaises dans les années 60. Cette projection d’antan dresse une image culturelle et sociétale de cette époque et se fait le lieu de retranscriptions multiples, tant factuelles qu’émotionnelles.
Inégale et parfois décousue – ce qui pourrait vaguement mimer le processus de remémoration – la longue immersion nostalgique, aux contours plaisants ou ennuyeux, accorde un temps de pose à l’art. Les albums du Père Castor, les aventures de Guy l’Éclair dans Le Journal de Mickey, la série de science-fiction américaine Les Envahisseurs, la curieuse BD Le Voyage de l’incrédule, la série de bande dessinée Captain Swing, le magazine Pilote ou encore l’épisode des Cybernautes de Chapeau melon et bottes de cuir : voici les alcôves enchanteresses depuis lesquelles le narrateur toise le réel. À neuf ans, lorsque la lune est foulée, il ne peut dès lors pas s’empêcher d’avouer que « la Nasa est très en retard sur [lui] ». Chaussé de lunettes fictionnelles multicolores qui tiédissent le réel, le narrateur va même jusqu’à facétieusement s’inventer des « parents d’à côté ».
Ce panorama culturel, charmant et intrigant, se double par ailleurs d’une certaine profondeur de champ lorsqu’il se prolonge en des réflexions sociologiques notables, tant musicales que sportives. Plus encore, le narrateur étanche sa soif fictionnelle dans le bassin du réel et fantasme le football : cette fiction sur gazon, véritable fil rouge obsessionnel de ce livre, se conçoit comme un levier social caricatural, à petite et grande échelle. Pour lui, être fort à ce sport le mènerait à organiser des soirées avec des filles, ce à quoi ceux qui croient en Dieu et qui lisent des livres, tels que lui, ne peuvent qu’aspirer. Pour sa ville, Saint-Étienne, qui connait alors la « grande époque des Verts », le football prend les allures d’un tremplin social :
« (…) [Dans] le monde des villes où il n’y a pas beaucoup d’argent, sur un terrain de football, tout change. Ces oubliés de l’histoire deviennent tout à coup les plus forts, d’invincibles petites armées qui tiennent la dragée haute aux capitales et aux mégapoles. »
Des parcelles d’une image sociétale émergent également, çà et là, sans qu’un regard ironique ou critique ne vienne s’y superposer pour les moquer ou les recontextualiser. Ces sempiternelles catégorisations étriquées saturent le roman au détriment de l’évocation de certaines coutumes de l’époque pourtant amusantes. Tandis que le narrateur est fier de « montrer sa mère » au parc, il aime expliquer sa vision de la vie à son père : il va jusqu’à inscrire la première dans de piètres réflexions englobantes – et ce, dès la première page (« On ne sait jamais avec les femmes ») – mais rend unique le second, jusqu’à le déifier, précisant que sa voix « descendait d’entre les nuages ». Enfin, accorder de l’espace littéraire à une grossière perception adolescente de la femme idéale, bien que décrite à l’imparfait, me dépasse :
« Pour moi la femme idéale était une photo ou une illustration. Dès que ça bougeait et que ça parlait, il était évident que rien n’allait se passer comme on l’espérait. »
Les retranscriptions des informations glanées dans les discours de ses deux figures de référence, son père et son oncle, cadrent les images précédemment décrites, les plongeant dans le bac de développement d’une actualité mouvementée (mort de Kennedy, guerre froide). Plutôt que de rebondir incessamment sur le sujet du ballon rond, ces apports attrayants, révélant, par exemple, le destin du zéro, auraient pu davantage colorer ces diapositives.
Pour finir, les retranscriptions émotionnelles du narrateur élargissent et éclairent les champs de cette longue projection. La jalousie qu’il entretient envers son petit frère, valsant aux quatre coins de l’histoire, le mène à émettre des hypothèses absurdes et fantaisistes quant à la responsabilité de l’habituelle casquette de ce dernier sur son intelligence :
« Peut-être qu’elle abritait un transmetteur cosmique qui lui permettait de communiquer directement avec mon père et avec la bibliothèque municipale. »
Sous l’apparente brutalité des pensées enfantines à l’égard des adultes, une souriante empathie frétille :
« Le kiné, qui était chauve, me faisait aussi souffler dans un truc avec une aiguille qui mesurait ma capacité respiratoire. Comme il était penché sur l’aiguille pour voir si je faisais des progrès je voyais son crâne chauve et je me disais que peut-être lui aussi il avait des problèmes, alors je le détestais moins. »
À l’inverse, les adultes sont dénoncés dans leur manière détachée de concevoir ce qui n’est pas encore à leur hauteur :
« Ils m’ont regardé un long moment sans rien dire avec ma mère, c’était très gênant, comme si j’étais un paquet arrivé par la poste qu’ils allaient devoir renvoyer contre remboursement, parce que dans cet état-là, non, tout de même il y a des limites. Et ils ont continué à parler de moi comme si j’étais ailleurs, les adultes faisaient tout le temps ça à ce moment-là. »
Intense et enviable, la posture enfantine monte et dévale les reliefs malléables de la fiction et frôle la tendre philosophie des cimes :
« Irridio a la sale habitude de m’abandonner dans le désert. Je ne comprends pas toujours ses raisons. Nous avons encore un vocabulaire limité. Ce qui est sûr, c’est que quand je le retrouve au saloon, je le tue. »
« Peut-être pour la première fois, j’ai senti que la vie allait se terminer un jour, exactement comme l’année scolaire, et qu’il était bon d’être là, d’être vivant, au soleil, d’avoir deux bras deux jambes, de respirer l’air de l’après-midi, de pouvoir courir. »
Dans cette traversée de l’enfance à l’adolescence, Luc Chomarat fait le constat d’une impossibilité, celle pour un fils de lier une relation profonde avec un père professeur qu’enfant, il pense décevoir et avec qui, adolescent, il forme un couple maladroit de « deux types dans un roman de Camus ». Toutefois, et c’est là que les lecteur.rice.s peuvent également se sentir concerné.e.s, l’émerveillement que procure tout procédé ludique rassemble instantanément les êtres dans un mouchoir de poche. Lorsque la mère du narrateur met le feu au papier fin qui emballait une des oranges du panier kabyle, qu’elle a plié en une sorte de cylindre, il commence à brûler puis à se déplacer à travers la pièce comme une étoile filante qui frappe tous les cœurs :
« Mon père m’a regardé à ce moment-là, et j’ai vu que, lui aussi il était sidéré. Sans blague, il m’a souri. C’est comme si on avait cinq ans, d’un seul coup. Elle pouvait faire ça. Faire entrer le mystère du cosmos dans le salon, rien qu’avec une allumette et un petit papier. »
De plus, cette projection de diapositives des années 60 attise le feu nostalgique de nos plexus et exhortent à coucher sur le papier ce qui nous échappe, déjà :
« Je savais que ces années filaient et je les regrettais déjà, comme si elles étaient arrivées il y a longtemps. J’avais déjà la nostalgie de tout ce qu’il y avait autour de moi (…). »
C’est dans toute leur complexité que les obsessions d’un narrateur sont inspectées jusqu’à l’éparpillement et l’essoufflement alors que l’explosion créative de l’enfance aurait pu ne jamais cesser de se faire entendre. Une phrase douce-amère, rappelant le merveilleux Petite maman de la réalisatrice Céline Sciamma, aurait même pu ensorceler le monotone gouvernail de l’histoire. Quantité de négatifs évoqués seraient partis en fumée, tant elle ouvre de riches potentialités relationnelles, auxquelles chacun.e de nous s’est frotté un instant :
« On se serait bien entendus si on avait eu le même âge. »