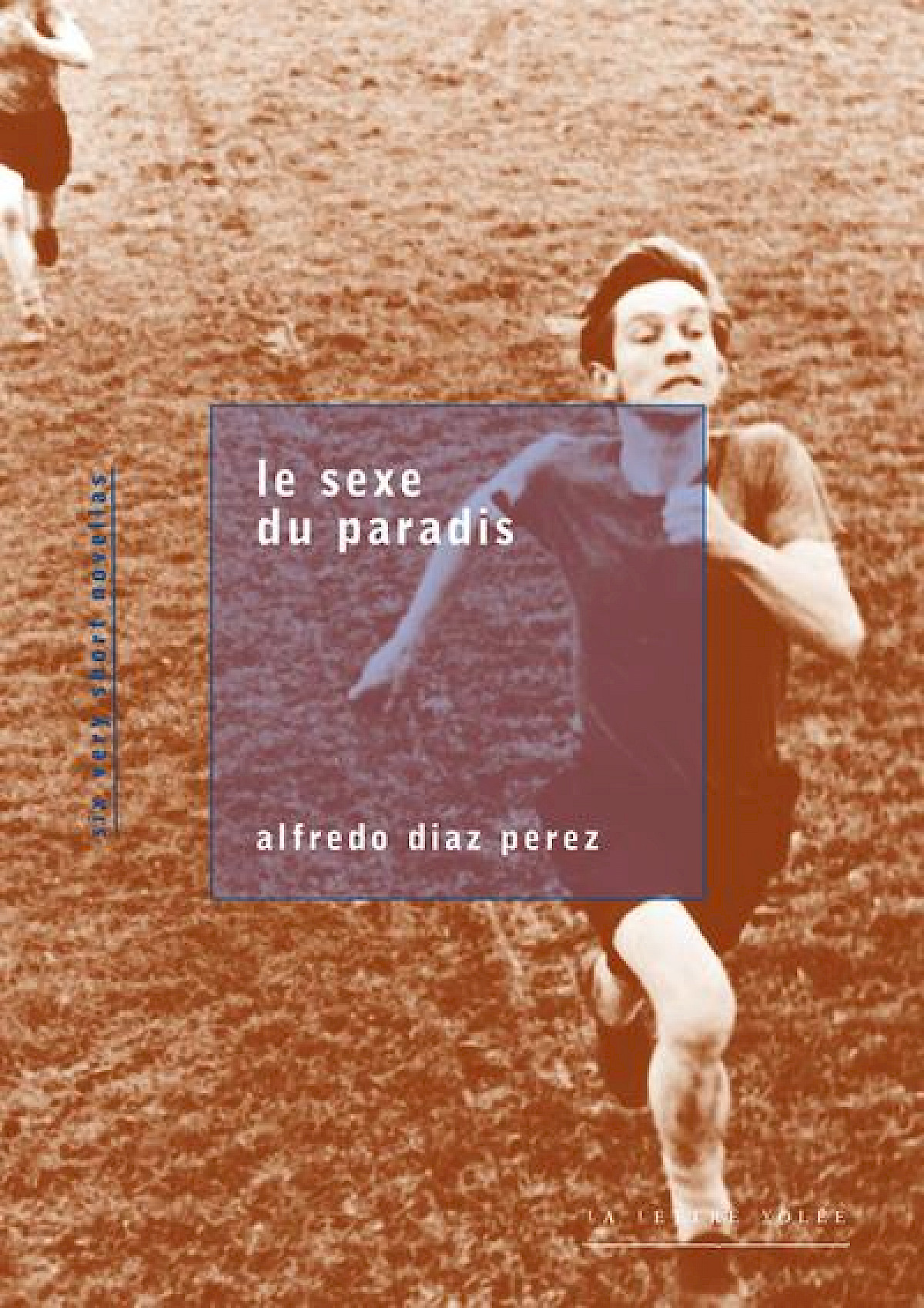
Avec le Sexe du paradis, le réalisateur et écrivain Alfredo Diaz Perez déploie six nouvelles fantasques, absurdes et crues qui arpentent, à enjambées inégales, les affres de la recherche identitaire avec, pour balises principales, l’exagération, la folie, la littérature, le cinéma et le sexe.
Chacune de ces nouvelles pourrait être résumée en une sobre ligne de script contre laquelle Alfredo Diaz Perez rebondit, démultipliant les narrations, les styles et les rythmes. Ce foisonnement se resserre autour de la question de l’identité, réfractée en rayons variés comme autant de pirouettes à cette interrogation éprouvante. Il y sera question de se définir par rapport à une relation à autrui ; en regard d’une collection particulière ; en s’inscrivant dans un monde éditorial ou cinématographique ; en multipliant les casses, en consommant des drogues, en surmontant sa haine et son refoulement, en dépassant toutes les limites, en devenant un personnage de fiction libéré des attentes paternelles ; en faisant de son corps son domicile.
L’identité se prête également au jeu lorsqu’elle trempe dans une folie aux quelques bulles de lucidité qui mènent à être « témoin de soi », mais aussi lorsqu’elle se joue de son caractère péremptoire : une photographie, matérialisation figée de l’identité, peut progressivement se liquéfier lorsqu’on remet en cause son authenticité… Cette teneur facétieuse impacte également le lecteur qui, à l’instar de certains personnages, ne possède pas les références sur lesquelles reposent certaines intrigues : nombreuses, elles ne laissent aucunement présager qu’elles sont fictives. Cette duperie cocasse se disloque dès qu’elle est découverte et ne fait que lasser le lecteur, après lui avoir fait décocher un demi-sourire.
En une ligne, ces six explorations peuvent curieusement se résumer alors qu’elles paraissent parfois denses et opaques à la lecture. La saveur de certaines idées se dénature au contact de détails répétitifs et ennuyeux. « Ne te réveille pas » se verrait par exemple rehaussée par la caméra de Wes Anderson, à même de magnifier l’idée autour de laquelle cette nouvelle se construit : l’amant du narrateur fait d’une couleur – le violet – le blason identitaire de ce dernier. La pièce dans laquelle ils se côtoient ne jure que par ce ton, des murs aux draps et, très vite, le violet habille le narrateur de la tête aux pieds.
La nouvelle à épingler est sans doute « Des vies parallèles, je crois » . Elle propose une enquête sans queue ni tête sur la disparition, vingt-cinq ans plus tôt, d’un acteur prénommé Jude, perdu dans le brouillard d’une narration qui se projette sur deux époques. L’identité de ce disparu fluctue et ricoche sur celle d’un autre personnage de la nouvelle. Cette enquête pourrait être portée à l’écran tantôt par Quentin Dupieux, au vu de ses farfelus dialogues :
- Il y a un rapport entre Jude et Jude Lawson ?
- Vous avez entendu parler de la théorie des cordes, Einstein ?
Tantôt par David Lynch ou Charlie Kaufman, tant certaines scènes hypnotiques miroitent de potentialités métaphysiques :
Jude se regarda dans le reflet de la mappemonde. Il le vit, l’étranger familier. Ça tenait, je crois, à presque rien. À presque deux fois rien. Le rien de ce visage, embué d’ombres glacées, réfléchi dans le globe. Bref, nothing strange. Un étranger réfléchi dans une mappemonde dans une salle de bain. Et l’observant. Un étranger dont le regard aride disait bien le connaitre. Un étranger familier. Jude eut le réflexe de se présenter à lui.
L’histoire de Jude n’existe pas. Elle commence par la fin et finit par le milieu.
C’est l’entremêlement réussi de ces deux univers cinématographiques qui a lieu dans « Des vies parallèles, je crois » :
Nu, avec son corps nu pour accessoire, une porte, invisible pour lui une seconde plus tôt, lui barrait la route de ce qui aurait dû être sa chambre à coucher.
À la manière d’un film et de l’émergence de scènes inopinées, d’incessantes remarques et scènes sexuelles surgissent – crues et inutiles – balayant d’un revers le beauté des quelques descriptions absurdes, déployées telles de longs plans-séquences pétrifiés. Ces passages sont pourtant hautement autosuffisants :
Un homme entra. Un tourbillon de vent et neige envahit le lounge bar avant que la porte ne se referme complètement derrière un Viking roux. On appelait de cette façon Harvey Lester. Simon trembla de froid. "Un teint de fromage caillé", pensa de lui Joe Harper. Le Viking roux lui souriait à perte de vue. Manifestement, ils avaient rendez-vous.
Balise de cette recherche identitaire plurielle, la littérature est un monde à conquérir pour chacun des narrateurs du Sexe du paradis. Si Idries, d’« Un colin bon marché », fait une lecture queer de La Princesse de Clèves, il va jusqu’à concrétiser ses ruptures par une appropriation littéraire symbolique, notant sur la page de garde du livre subtilisé à l’amant, le prénom de ce dernier et le motif de la fin de leur relation :
En résumé, Idries avait subtilisé des romans sous les lits d’Éric et d’Oscar, à côté des matelas d’Hervé et de Ricardo, sur le rebord de la fenêtre d’Yves, sur les tables de chevet de Marcel et de Jonathan, dans la cuisine de Jean-Claude, dans les toilettes de Dany et de Sylvain, dans la salle de bain de Thomas, dans le sac de voyage de Didier et dans la poubelle d’Hubert.
Elle ne manque pas non plus de s’imprégner de la vulgarité ambiante :
Il trouva le style de Genet aussi lourd qu’une bite gorgée de sang.
Ou de se prêter à d’autres relectures ludiques : « Des vies parallèles, je crois » imagine un Gatsby gay et renomme le chef-d’œuvre d’Emily Brontë, Les Bas de Hurlevent tandis que « Off-hours » officialise l’existence des films Julio et Roméo et Othello à l’intérieur d’Iago.
Tout questionnement détient une part obsessionnelle, ce qui ne rate pas ici. Le sexe obnubile véritablement chacun des narrateurs de ces nouvelles (« j’ai besoin de me faire enculer », « travaill[er] aussi dur qu’une bite dans le cul » ; « j’aime toutes les queues », « une bite bourrée de matière grise ») et brise l’investissement du lecteur qui finit par percevoir que les fragments absurdes et réjouissants qu’il a collectés ne sont que des passages dilatoires avant que les grivoiseries ne reprennent, parfois clairement déplaisantes :
Une bouffée de femme ménopausée en chaleur envahit Simon.
Ce qu’ils préfèrent, c’est la scène du viol dans Va te faire foutre.
(…) un homme est pétri de contradiction, (…) de violence, de viol.
Cette obsession s’étend de tout son long pour se magnifier quelque peu au contact du dernier narrateur, chercheur maniaco-dépressif, qui a trouvé le gène du sourire alors que lui-même s’en tient tristement éloigné, se rendant à des vernissages puisqu’« on y rencontre des gens qui vivent à côté de leur vie ». La « sagesse du cul », et son ancrage dans le présent, est la seule chose pour laquelle il se sente doué. Chez lui, la fixation charnelle se pare quelquefois d’une jolie formule, passée entre les mailles de la crudité usuelle :
Je me suis vu comme un aventurier des mers terrestres. Mon corps est mon domicile.
Par ailleurs, il arrive que ces allusions soient mieux intégrées au paysage général lorsqu’elles se teintent de burlesque, grimant fréquemment le reste de l’ouvrage :
Au moment de l’extase, Polo plongea en chute libre du toit et cria en éjaculant face au ciel étoilé : "Je dois encore vivre ma vie" avant d’atterrir dans la Ford Mustang où Debbie l’attendait pour filer droit vers l’île du paradis.
S’il est asséné qu’échapper à soi-même relève de la chimère, la dissolution de la question identitaire dans ces frasques burlesques et provocatrices ne fait que prouver le contraire ou, en tous cas, pose des conditions à cette fuite. Alors, retenons-le, pour nous dérober à nous-mêmes, nous voilà priés de nous frotter, activement – par la création – ou passivement – par la transformation de soi en un personnage – aux vallées fictionnelles, littéraires ou cinématographiques, qui déplacent les clôtures de notre identité.