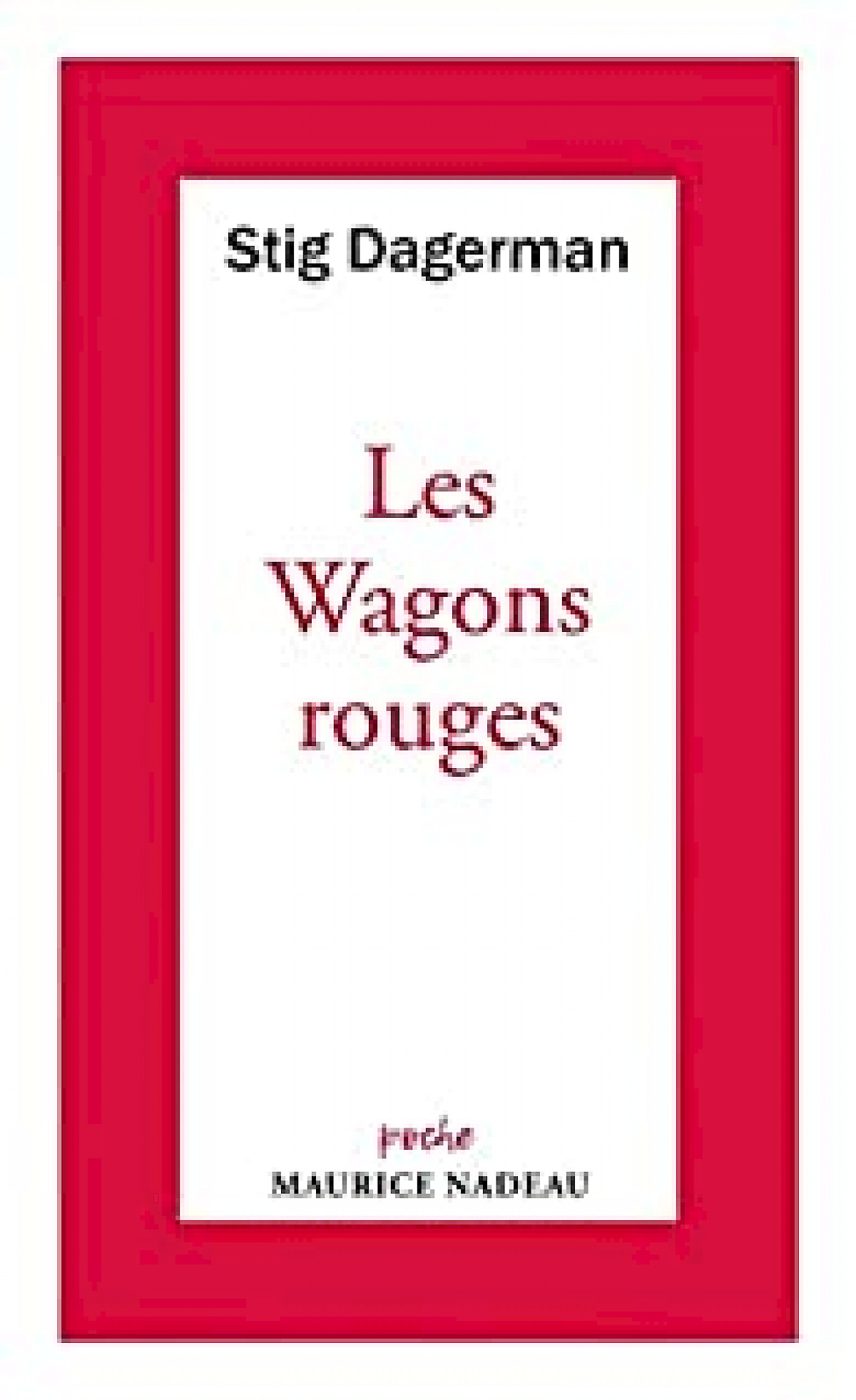
Découvrir Dagerman avec Les Wagons rouges , c’est loger dans sa paume un fil rouge intense qui borde un univers où folie, lucidité, absurde et résignation forment un tissu dense et palpitant.
Les Wagons rouges se décline en neuf nouvelles, signées par le célèbre écrivain suédois Stig Dagerman, originellement publiées entre 1946 et 1963 et traduites en 1987, 2016 et 2022 (pour la présente édition) par Carl Gustaf Bjurström et Lucie Albertini. Ces neufs histoires se structurent autour de narrateurs empêtrés dans un environnement hostile, porte-paroles d’une folie obsessionnelle ou d’une lucidité critique, ce qui impacte la dose de fantastique qu’on y retrouve, sans jamais toutefois l’évincer complètement.
À l’entame du recueil, deux nouvelles séduisantes s’offrent à nous : Les Wagons rouges et L’Homme de Milesia . Leur emplacement de choix donne le ton à l’ouvrage, tant elles se veulent les plus réussies, déployant un univers fantastique riche, soigné et fascinant, tandis que d’autres, telles que Quand il fera tout à fait noir et Une Histoire du temps passé, ne décollent pas et ne s’émaillent que de quelques éclats qui auraient pu trouver écrin plus soigné. L’Homme qui ne voulait pas pleurer et Le Condamné excellent quant à elles dans la critique acerbe qu’elles font porter sur les mécanismes de pression sociale et d’aliénation dans le monde professionnel et judiciaire. De façon plus décousue, nous retrouvons cette lucidité critique dans Le Procès et Comme un chien. Enfin, la nouvelle Le Huitième Jour, en position centrale du recueil, se perd dans le marasme de la longueur, même si elle dispense des anecdotes amusantes d’un genre nouveau dans l’ouvrage, celui de la comédie théâtrale aux multiples rebondissements et quiproquos comme chez Beaumarchais. Inscrite dans une dynamique boccacienne d’enchâssements de récits, éloignée des univers logés avant et après elle, elle participe toutefois à l’illustration commune d’une absurdité tragi-comique.
Sœurs, les nouvelles liminaires – Les Wagons rouges et L’Homme de Milesia – piègent le narrateur dans un même basculement envoûtant en deux temps, celui de la perte des coutures du corps et des espaces et celui de l’entrée dans les tourments d’une inspection obsessionnelle du réel. Il s’agit donc de s’éloigner de son corps et du monde, par l’éclatement de leurs contours respectifs, de se détacher de ces contingences imposées et, concomitamment, de se rapprocher de soi et du réel, de les scruter avec un regard neuf irradié par une hypervigilance monomaniaque, à même de rehausser les surfaces, de les hérisser de mouvement, de les broder de signes ou de marques.
Animée par la même construction paradoxale d’éloignement et de rapprochement, Les Wagons rouges et L’Homme de Milesia s’établissent toutefois autour de deux ressorts différents – interne et externe – conduisant à cette perte de limites corporelles et spatiales. Dans la première , c’est la perception de « traits absurdes peints dans un rouge plus profond » sur des moyens de transport éponymes qui amène le narrateur (Helge Samson) à égarer les limites instituées. La seconde inverse la chronologie et offre avant tout une cause à cette perte : l’acquisition, par le narrateur (Ralph Singerton), d’une toile, qui passe de mains en mains, mystérieusement enroulée. Tandis que le premier homme, seul, ressent une fracture avec le monde suite à une perception terrifiante, le second écope d’un objet extorqueur d’une vérité folle à la fin. C’est cette acquisition inopinée, ce portrait cauchemardesque duquel une lumière vive et étrange émane des yeux, qui le fait basculer dans un univers sans issue martelé de personnages inévitables, à la Charlie Kaufman.
Perdre les coutures du corps et de l’espace
Cet éclatement des contours physiques et environnementaux passe par une disposition à la perméabilité du corps, traversé par les peurs et par un désancrage. Les narrateurs des deux nouvelles en question ne possèdent pas d’habitats fixes et louent une chambre chez Mme Öberg ( Les WR) et chez Nelly ( L’Homme ). Ces espaces impersonnels s’impriment d’ailleurs en Helge Samson ( Les WR ) – lorsqu’il dit percevoir les dimensions de sa chambre étroite quand il se promène dans de vastes espaces, tels que des parcs ou des forêts – tout comme il imprimera l’espace de ses perceptions par la suite. Dans Le Condamné à mort, l’angoisse meut les espaces : les murs avancent en rampant vers le narrateur, le plafond s’abaisse et le plancher monte.
Dans la suite du recueil, la percée du corps poursuit son cours de manière poétique :
Son front lorsqu’il ne portait plus son bonnet de fourrure devenait une immense falaise de craie disparaissant dans les nuages. ( Le Condamné à mort )
Quand elle ne mène pas à un entremêlement angoissant :
Il ouvrit son manteau, la neige autour de lui s’envolait comme un nuage. Toute sa personne enflait, son couteau paraissait encore plus long qu’il ne l’était. ( Une Histoire du temps passé )
Qui peut également se jouer de l’intérieur :
Ses yeux auraient pu éventuellement éveiller l’inquiétude de quelqu’un, son regard était presque toujours tourné vers le dedans, dans le mauvais sens humainement parlant […]. ( Les Wagons rouges )
Broder le réel de signes et de marques, lui insuffler du mouvement
Il est clair que les deux narrateurs susmentionnés se dédouanent de toute responsabilité dans ce réel redessiné, ils ne font que détecter ces signes et en rendre compte. D’ailleurs, Ralph Singerton ne se méfie pas tant de l’alcool ou de ses yeux que directement de cette « réalité confuse » dans laquelle il gravite.
Dans Les Wagons rouges , la folie de Helge Samson se loge dans sa capacité à concevoir la nuance et à l’élever en étendard obsessionnel : ces marques rouges sur les wagons de la même couleur vont jusqu’à le faire quitter son travail dans un magasin de tissu. En proie à l’angoisse d’un travail abrutissant, ankylosé qui plus est par la résurgence de ces signes, le regard de Helge Samson anime tout à coup le tissu qu’il doit découper pour une cliente, à tel point que les enfants qui l’ornaient le parcourent en courant puis se couvrent de sang. Une Histoire du temps passé va jusqu’à dérouler une époque durant laquelle les objets inanimés n’existaient pas, de sorte qu’ils parlaient, ce qui est dévoilé anecdotiquement sans que cela ne soit développé, malheureusement.
Si, quelquefois, un doute demeure (« Une ombre n’est-elle pas passée sur le visage du marchand de tableau ? Il m’a semblé en reconnaitre un signe, mais il y en a si souvent sur le visage des gens que je n’y ai guère prêté attention », L’Homme ) et confirme le genre fantastique de ces nouvelles, les observations des narrateurs sont de manière générale péremptoires (être « jaune » sur la tête, est affreux ou agressif pour Ralph Singerton et L’Homme de Milesia ne comporte pas moins de huit chevelures blondes) ou contradictoires, une forme pouvant être décriée et usitée (tracé par autrui, le triangle est de mauvaise augure mais en reproduire un sur une porte permet de se souvenir de son passage). L’hypervigilance monomaniaque des narrateurs pour certains détails du réel ne manque également pas de prendre des allures paréidoliques (« une arabesque de néon rampait sur un toit comme un serpent fou », Le Huitième Jour ). Sentiment élevé de persécution, dépersonnalisation ou passage à l’acte sont les issues de cet affolement de l’œil.
Apposer un regard lucide sur le réel
Hors de toute folie, le narrateur extorque de son environnement des différences imperceptibles, traductrices d’échelons sociétaux. Dans L’Homme de Milesia, les rues du quartier des riches se composent d’un asphalte brillant de première qualité et les larges avenues sont bordées de pierres dont une sur trois est en marbre. Le quartier « des pauvres qui espèrent encore devenir riches » est pavé de façon à peu près égale tandis que le quartier des « pauvres désespérément pauvres » ne l’est pas du tout. C’est la neige qui représente une solution anarchique des plus douces car, avec elle, toutes les rues se ressemblent, et c’est joli d’y penser.
Dans la lignée de Kafka et d’Orwell, Dagerman dénonce l’aliénation de l’homme par les institutions. Délicieusement rendue grotesque, l’obligation de se plier aux émotions attendues sur un lieu de travail est par exemple pointée du doigt (dès qu’un employé aura pleuré la mort d’un personnage qui émeut unanimement, un de ses supérieurs arrivera « accompagné par le chef de bureau pour contrôler les faits », L’Homme qui ne voulait pas pleurer ). Il en va de même pour la capacité désolante de l’homme à se déshumaniser si la société le désire.
L’homme est une chose essentiellement pratique. Donnez-lui de la lumière et il ne peut plus se passer des incendies. Donnez-lui de l’obscurité et il devient un chat. ( Comme un chien )
Par ailleurs, le pouvoir odieux qui incombe aux juges de sceller la vie ou la mort d’une personne par la perception qu’ils ont de ses actes conduit le narrateur du Condamné à une interrogation déroutante, suite à un revirement cocasse de peine.
Alors, comment peut-on se fier à votre compassion puisqu’on ne peut même pas se fier à votre dureté ?
Les structures judiciaires et étatiques sont démantelées à coups de précisions absurdes et cyniques, révélatrices d’un auto-sabotage escompté. Dans Le Procès, les témoins sont aveugles pour éviter à coup sûr que les accusés puissent dire qu’ils ont mal vu. Les fonctionnaires de la Maison de Police qui sont chargés d’appuyer sur des boutons aux couleurs diverses sont quant à eux tout bonnement daltoniens.
Au bout de cette critique du monde, deux voies, empruntées en alternance par Dagerman : celle de la résignation et celle de l’absurde. La première est pesante (« J’ai appris que cela ne sert à rien de maudire, de s’indigner, de menacer puisque tout suit son cours et rien ne peut être changé ») et ne peut que faire songer au suicide de l’auteur le 4 novembre 1954, à l’âge de 31 ans. La seconde, jubilatoire, se veut prolixe en exemples. Ralph Singerton s’étonne par exemple du fait que Nelly, sa logeuse, ait glissé dans sa boite aux lettres un sandwich avec un œuf à la coque ou, plus tard, affirme ne vouloir dévoiler pour rien au monde sa véritable identité au marchand de tableaux puis, la seconde d’après, le fait par distraction. Dans Comme un chien, les réunions plénières se tiennent uniquement la nuit et les campagnes télévisées abordent de vrais sujets, d’un ton dramatique, comme celui des écrivains saouls qui font des fautes d’orthographe. Lors d’appels en « téléviphonage » (à définitivement adopter pour redorer le concept derrière le mot décrié de la visio), il est d’usage de régler la couleur de son visage pour refléter tout un panel d’états d’esprit farfelus.
Lie-de-vin : j’éprouve une vive sympathie pour tout ce qu’il y a de meilleur dans les efforts des hommes ; […] Vert pré : je désirerais reposer sous l’herbe de ma ville natale. […] Jaune canari : j’exige d’être cru sur parole […]
Autre réjouissance à noter : la présence de quelques chiens qui ponctuent le récit – que ce soit des bergers allemands qui « chahutent dans la boue » ou un « triste basset aux oreilles pendantes » – pour y camper malheureusement des personnages désabusés. Comment ne pas voir enfin un clin d’œil aux aphorismes de Nougé ( La Publicité transfigurée ) dans cette magnifique formule :
Oui, mais qui rêve de liberté ne peut pas le dissimuler. Ça peut se voir même aux oreilles. ( Le Huitième Jour )
Une lueur s’est imprimée dans le regard, à la traversée de ces neuf nouvelles. Aussi, l’envie de résolument emprunter cette voie absurde pour éviter la résignation. Il s’agira de chercher dans le réel ce qui fait signe ou sens, de détricoter joyeusement ce qui est institué pour broder librement ce qu’il nous plaira.