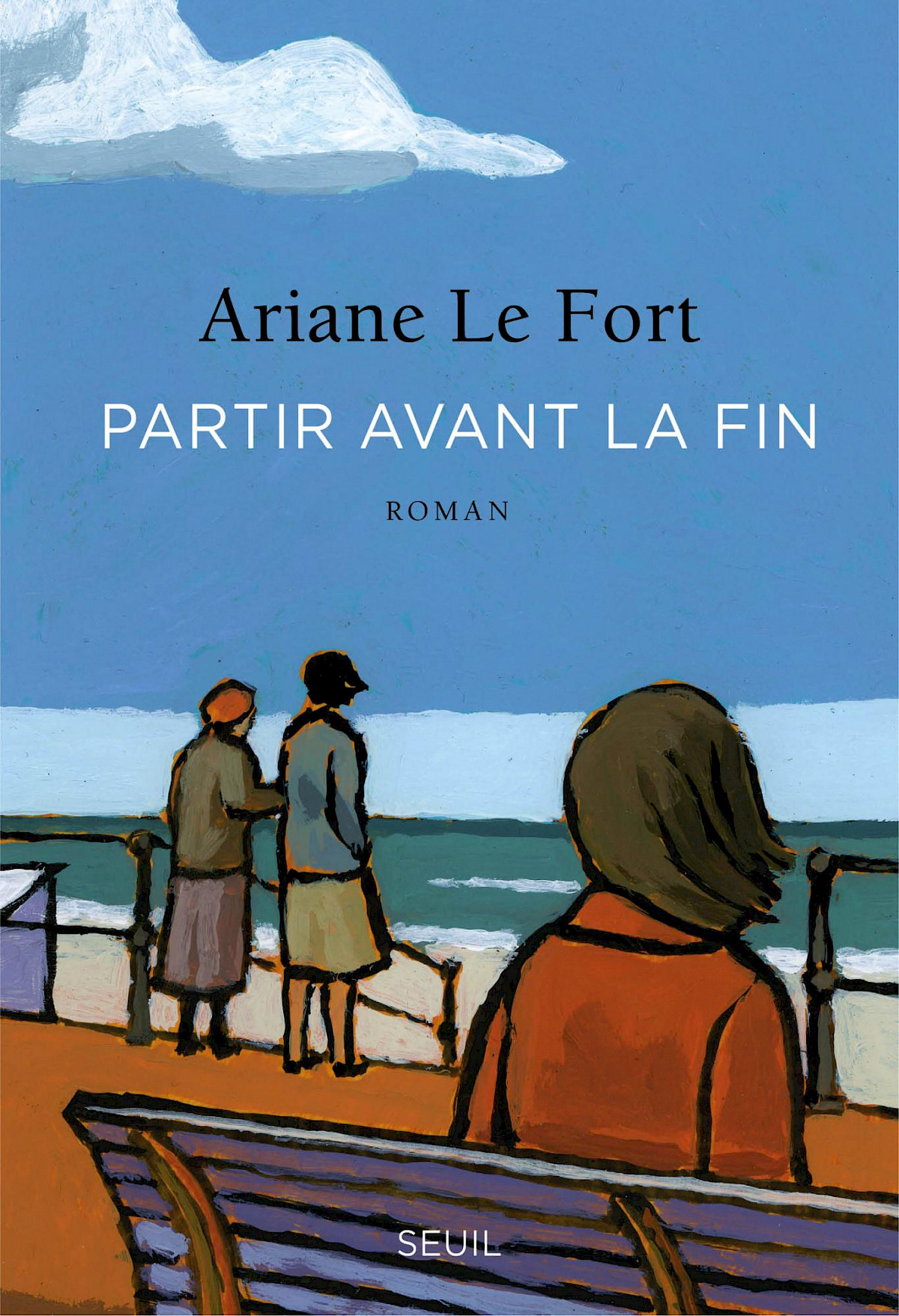
Publié aux éditions du Seuil, le nouveau roman d’Ariane Le Fort, Partir avant la fin , est un livre qui nous donne à expérimenter un âge où les relations sont amenées à évoluer ou à disparaître.
Le première fois que j’ai lu ce roman, j’étais au bord d’une piscine tunisienne. Était-ce le climat excessivement éloigné de celui que nous connaissons à Ostende ou la consommation joyeuse et journalière de gin fizz ? Peu importe. Il m’avait laissé aphone. Me voici, quatre mois plus tard, refermant la même couverture et j’ai recouvré mes mots.
« Ça commençait mal. » — En effet, aurions-nous envie de répondre.
Dès le premier chapitre, Ariane Le Fort nous immerge dans un monde contemporain de smartphones , de SMS accompagnés de smileys et de slogans publicitaires. Qui sont les personnages ? Pourquoi se rencontrent-ils ? Quel est même le nom de la protagoniste ? Nous le saurons plus tard. Ou peut-être jamais. Ce qui doit compter, c’est l’être humain et les relations qu’il tente de nouer avec ses semblables. Ce roman, loin d’être dirigé par une analyse profonde, telle que pourrait l’envisager aujourd’hui encore un Houellebecq, nous livre une somme de petits détails emplis de petits sens : une moquette peut être à la fois kitsch et douce aux pieds.
S’il y a une chose qui nous intéresse particulièrement chez Le Fort, c’est sa capacité à faire apprécier le réel à travers ce qu’il peut avoir de banal, voire de ridicule : une conversation creuse à propos de la pluie, un « silence soi-disant amical »… Le vocabulaire se veut reflet de son sujet ; ainsi flippé et nichons parsèment ce court roman comme autant de variations sur la vie moderne. Il nous vient même un sourire devant les barakis de la côte flamande, ou le chat Chicon. La Belgique est présente jusqu’à un concert d’Arno où Léonor, notre héroïne découverte, rencontre son nouvel amour : Nils.
Il ne faudrait pourtant pas classer trop rapidement Partir avant la fin du côté, souvent injustement honni, du régionalisme. En effet, l’écriture blanche de l’auteure, à peine assaisonnée de quelques figures justement disposées pour trahir les chamboulements mentaux des personnages, offre une liberté de ton en adéquation avec la liberté d’action. On allume un joint, on finit une bouteille puis une seconde, on expose sans fioriture le sexe d’une vieille dame et ce sont ces moments vrais, au cœur des personnages, qui permettent d’envisager une forme d’universalisme.

« C’était comme du papier. D’une finesse presque transparente. » — En effet, aurions-nous envie de répondre.
Tous les personnages ont la cinquantaine, tous ont déjà une vie derrière eux. Ils ont construit, perdu et tentent maintenant de (se) retrouver. Ils sont séparés, divorcés ; les enfants sont partis avec ou après les amours. Léonor, durant deux grandes sections sobrement intitulées Nils et Dan comme les hommes de sa vie, va dresser le portrait de cette génération en pleine recherche, lorsque ce n’est pas en plein retour dans l’adolescence.
Elle travaille dans un musée. Pour la première fois, elle se sent vieille : le vouvoiement d’une collègue la maintient à distance. Sa rencontre avec Nils pourrait pourtant changer la donne. Elle qui, arrivée chez lui, disait : « On était pas là pour parler », s’étonne de le branler quelques minutes plus tard. Un lit sale empêche leurs premiers ébats, laisse place aux frustrations. Le sexe ici est surtout le premier pansement à la misère affective : après l’extase, on attend de se serrer l’un contre l’autre en se sentant accepté pour ce que l’on est. Cela explique peut-être que l’auteure puisse écrire : « je te lécherai la chatte » sans que cette scène ne tombe dans la vulgarité.
C’est que la vérité nue ne s’accepte parfois que sur la peau. À d’autres occasions, elle demande un vêtement, même une simple robe de nuit. Pour supporter le regard de l’autre sur son corps qui a vieilli. Pour appréhender les questionnements dont on ne semble jamais se défaire : « Quelque chose avait changé, un chouïa, un rien. […] alors qu’était-ce ? […] À quoi cela tenait-il, bon Dieu à quoi cela tenait-il ? » Pour entendre les nouvelles concernant maman que nos épaules ne peuvent porter seules.
En cette mère que la maladie accable, que la mort rattrape, nous anticipons notre propre fin. On imagine des vacances à la Mer du Nord ; la demande tombe : « Noyez-moi. » Peu de mots suffisent alors pour saisir la déchéance : la maigreur, la photographie d’un mari devenu étranger… Le corps aimé devient corps souffrant. Les besoins primaires se font cruciaux. Il ne reste que deux idées fixes : atteindre les toilettes et mourir. C’est un combat pour ne pas faire sous soi. La vie devient un citron qu’on croque avec l’écorce. Mais on se heurte à la difficulté de partir, à quelques marches. Tandis que cette mère cherche les restes de sa mémoire dans un miroir ou bien au fond d’elle-même, ses filles guettent ses gestes dans l’espoir de la moindre réminiscence. Ce qui fait réaliser à Léonor : « Il fallait prendre soin de soi, prendre soin de soi et des autres, prendre soin de soi et du décor autour de soi, qui nous encerclait et dont on ne pourrait jamais faire l’économie, sinon la décrépitude allait être plus rapide encore. » D’où l’importance de la moche mollesse d’une moquette.
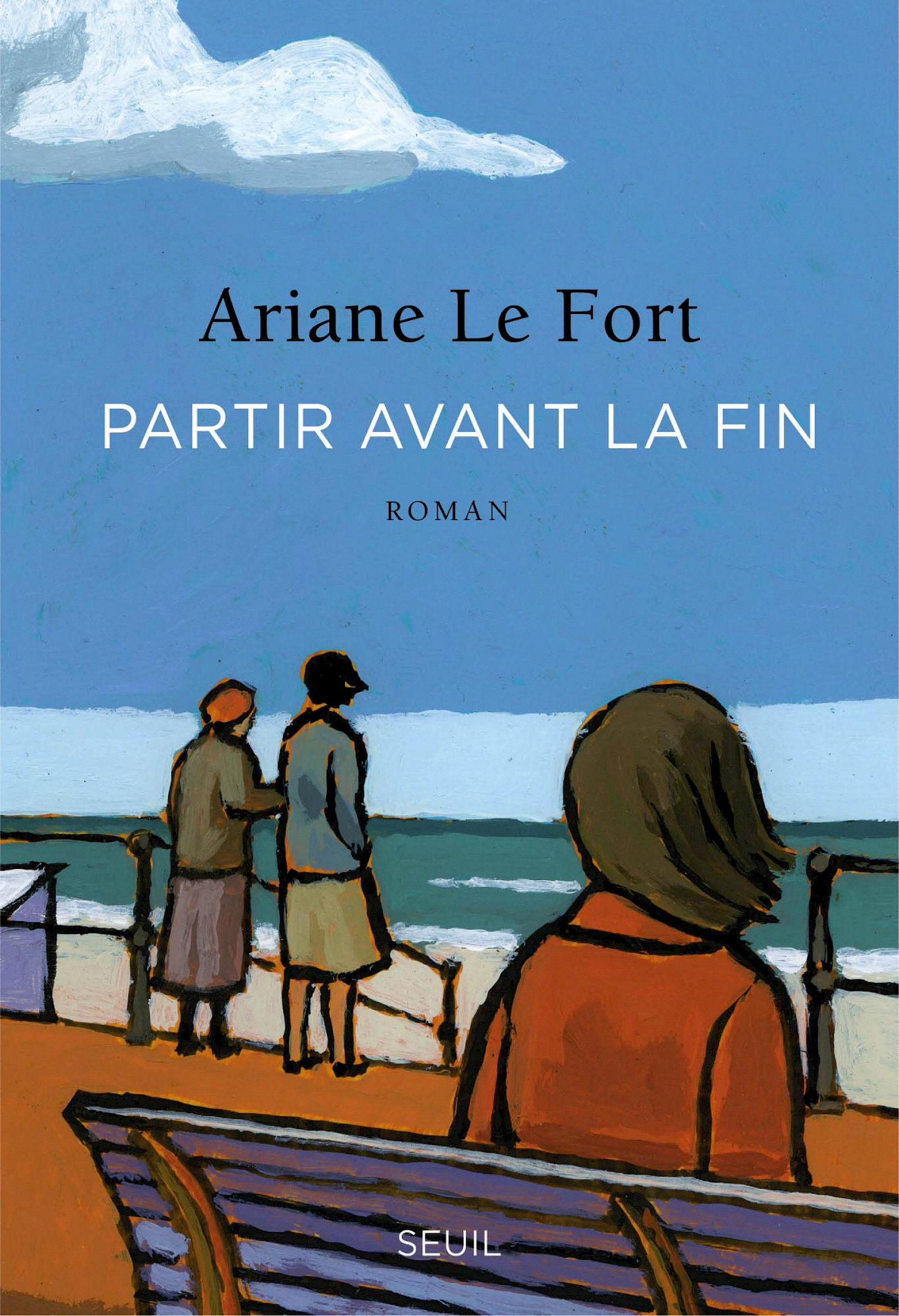
Dans ce combat, Léonor sera épaulée par sa sœur Violette. Musicienne, toujours en voyage, elle a refait sa vie avec une femme beaucoup plus jeune qu’elle. Mais Léonor, elle, se sent surtout vivante auprès des hommes. Cependant, comment choisir entre Nils et Dan ?
Nils qui est apparu presque miraculeusement. Lui qui rejette ce qu’il appelle « les codes bourgeois » et dont le jardin ressemble plutôt à une forêt. Lui qui est à la fois dominateur et protecteur, profondément tendre malgré tout. Lui, pourtant, qui n’arrive pas à s’ouvrir sur les poussières de son passé et qui attend de Léonor qu’elle l’aime et le comprenne sans autre choix que de les deviner… Dan, rencontré aux États-Unis alors qu’ils étaient encore étudiants. Dan qui s’est marié par intérêt avec une femme frigide qu’il trompe en entretenant un adultère irrépressible depuis plusieurs décennies. Dan qui a invité Léonor à Budapest pour les vacances… Comment faire lorsque les souvenirs récents empêchent les souvenirs anciens de reprendre forme, que les souvenirs lointains empêchent le présent ? Le temps déborde, les heures se dilatent, les jours filent. Les quotas, aussi, sont respectés.
Alors, pour se préserver, Léonor rit. Elle décide de prendre à la légère ce qu’elle ne peut gérer. Elle en vient à plusieurs reprises à souhaiter que quelque chose se produise, par hasard, par circonstances. Elle redevient « une fillette docile en attente d’être surprise ». Le lecteur, quant à lui, n’a d’autre choix que d’attendre avec elle que quelque chose d’important arrive.
C’est une histoire « aussi banale qu’impressionnante » que nous livre ici Ariane Le Fort, servie par un style sans aspérités et des chapitres-événements très rapides. Si l’on peut regretter l’une ou l’autre explicitation qui nous semble dommageable tant le non-dit possède ici sa propre puissance, ce livre nous donne à expérimenter un âge où les relations sont amenées à évoluer ou à disparaître.