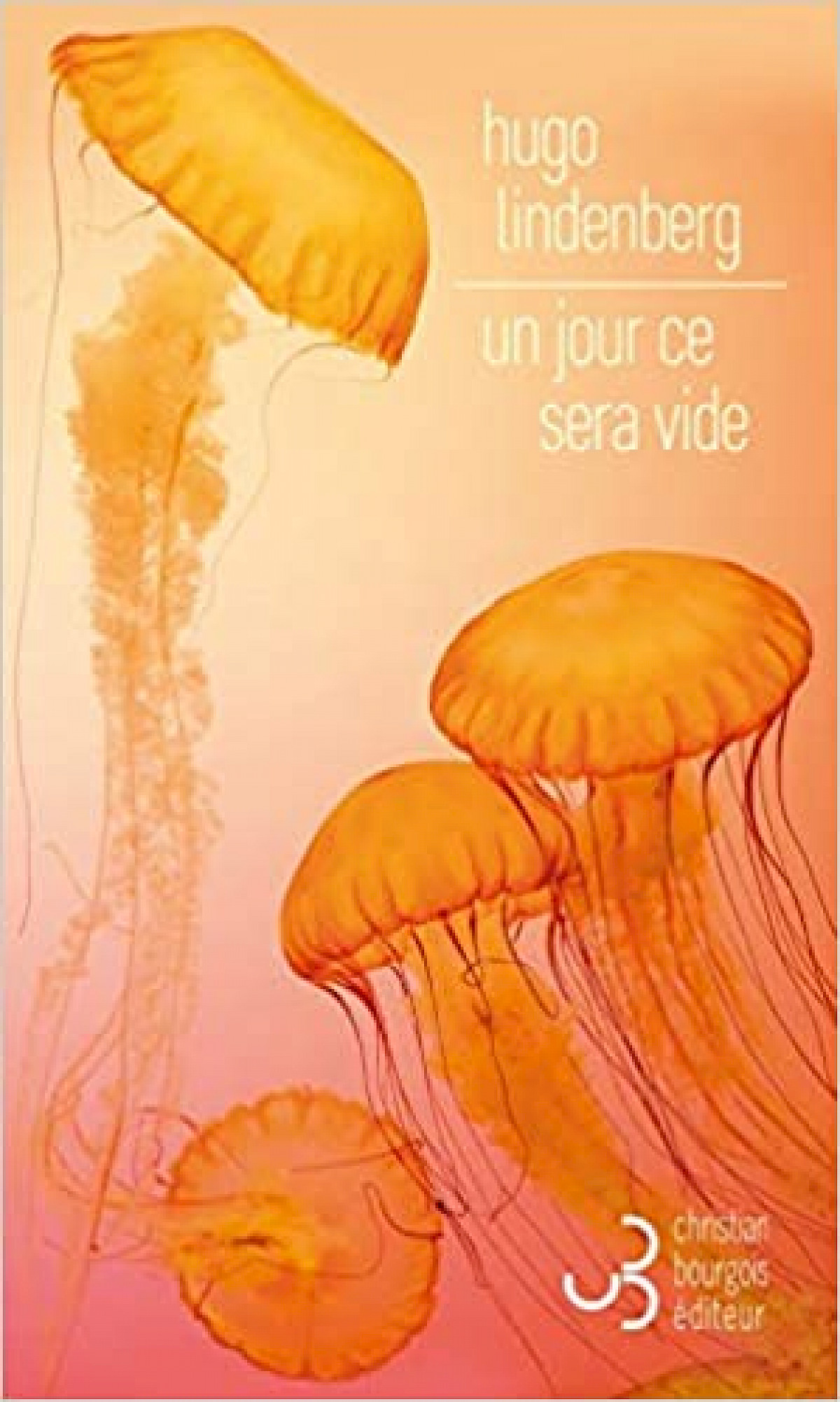
Avec Un jour ce sera vide, le journaliste Hugo Lindenberg signe un premier roman éclatant qui donne à voir la manière dont un enfant tourmenté dompte lumineusement le traumatisme de la mort de ses parents et le poids d’une lourde histoire familiale, aux contours flous, durant l’été de ses dix ans, avec sa grand-mère et sa tante folle.
Comment un enfant de dix ans introverti et hypersensible voit-il le monde ? Se construit-il autour d’une rencontre estivale ? Écrit-il le temps ? Découvre-t-il les deux facettes du vide ? Dépasse-t-il les diktats identitaires de genre ? Enfin, pourquoi de gracieuses méduses habitent la couverture et le cœur de ce petit bijou ?
La rencontre
Tout commence lorsque cet enfant en rencontre un autre, Baptiste, sur une plage, autour d’une méduse et de l’angoisse, pour lui déjà, de perdre ce qui n’existe pas encore :
« Mais je sais qu’il suffit d’une maladresse de ma part, un geste trop craintif par exemple, pour que cesse ce moment de grâce où rien n’existe entre nous sinon un peu de curiosité et cette masse compacte et urticante qui ressemble à un extraterrestre. Chaque seconde nous rapproche du moment où il faudra dévoiler plus de soi qu’on ne voudrait. »
Tout en décrivant cette aube relationnelle, le narrateur traduit également ce délectable « moment de grâce où rien n’existe » encore lorsque nous nous abandonnons aux premières pages d’un livre. Cette conscience absolue de ce qui est et de ce qui adviendra ne peut que nous replonger dans cet âge de l’enfance où tout est ressenti de façon décuplée, quitte à napper de fiction ce qui est vécu. Auréolé de confiance et de chance, Baptiste paraît en effet irréel aux yeux du narrateur (« sa peau semble faite du même grain que le sable ») qui va jusqu’à supputer « (…) qu’il n’ait même jamais mangé une pomme farineuse ». Allégorie de la souple allégresse estivale (« Les vacances lui vont bien (…) Son corps met le monde en mouvement, alors que tout semble buter sur le mien »), Baptiste sera sincèrement porté aux nues par son nouvel ami et cette entière admiration est hautement communicative.
À cette rencontre succède la naturelle prise de rendez-vous des enfants, que le narrateur rehausse d’une douce ironie : Baptiste lui dit « à demain », « comme si [ ils ] tuai [ ent ] t ensemble des méduses à heure fixe depuis des années ». Alerte, il est alors assailli par une nuée de questions, multipliant les acceptions de cette affirmation.
L’écriture du temps
Orné d’épithètes paradoxales, le temps, dont le narrateur démontre tantôt l’aspect dilaté, tantôt ramassé, s’habille du rôle de personnage dans ce roman. Un jour ce sera vide pourrait être le premier tome d’une longue série, à l’instar de La Recherche de Marcel Proust, dépliant soigneusement d’autres étapes de la vie de l’enfant-je.
Brandissant un ambitieux adage (« Tout ce qui échappe à mon regard n’est que fiction »), le narrateur, retenu dans l’été interminable de ses dix ans, met à profit cette dilatation du temps pour scruter tout ce qui l’entoure avec une docte minutie. Malgré cet adage, son hypersensibilité lui fait vite réaliser que ce que son regard perçoit n’est pas pour autant réel : l’écume fictionnelle qui hérisse le réel se perçoit aussi bien dans la gestuelle de la « famille cabine » qu’il étudie depuis sa serviette de plage (« Le père qui était très poilu et portait une barbe ne cessait jamais de bouger, d’aller chercher des choses, de revenir décrivant une orbite perpétuelle et anarchique autour du carré de serviettes familial »), avant de devoir se contenter de « spectacles de seconde main », que dans celle de la mère de Baptiste (qui boit « comme si elle était sur scène ») mais aussi dans la sienne (« J’ai alors parfaitement conscience du personnage que j’incarne. Dix ans, des dents de lapin, de grandes boucles noires et de longs cils, des taches de rousseurs autour du nez, des manières timides, des vêtements sages, un petit bouquet de magnolia à la main. Je suis la vie »). La fiction semble aussi bien constituer une écorce de sauvetage pour qui manque de confiance en lui.elle ou un tremplin pour qui en regorge et la sautillante possibilité, alors, de transformer toutes les « tentatives maladroites de la journée » en « épopées joyeuses ».
Se loge à la base de chacun des cils de l’enfant de belles et vaporeuses définitions du regard : déclencheur d’explosion poétique (« Le reflet des nuages noirs étalé sur les fenêtres étroites donne l’impression que la maison abrite un orage »), manière d’aimer (« Je la regarde, assis sur un tabouret. Je ne fais rien. Bientôt ça l’agacera. (…) Mais je peux encore étirer le moment, l’observer, à condition de ne pas faire trop de bruit. C’est ma manière à moi de l’aimer. Une manière de chien, ça me suffit parfois, c’est même une sorte de bonheur. »), source d’expérimentation (« Je plisse les yeux par goût du spectacle et pour regarder le monde s’embrasser sous mes paupières. La tache d’humidité que je fixais au plafond y forme un lac argenté. Je cligne cent fois. ») ou de mimétisme (le narrateur n’hésitant pas à « piocher dans la gestuelle de la mère de Baptiste. Bouger [s]es bras comme s’ils étaient lestés d’un orchestre de bracelets, soupirer avec intensité, caresser les choses plutôt que de les toucher. »).
Déchirant, le ramassement du temps est par ailleurs épinglé : le narrateur, qui n’a de cesse d’envelopper tendrement du regard sa grand-mère, dont les mains lui offrent le « spectacle [le] plus mélancolique » qui soit, l’imagine, dans un splendide instantané, à vingt ans :
« Et une tristesse me vient de très loin. Une tristesse qui me donne envie d’échanger avec elle ma jeunesse, pour lui donner une vie encore, une vraie vie, dans laquelle elle aurait quelqu’un d’autre qu’un enfant de dix ans pour veiller sur ses vieux jours. »
Cette bouleversante écriture du temps, frémissante de mélancolie, dépoussière des sentiments doux-amers et en dévoilent la beauté pastel.
Combler et admirer le vide
Dans Un jour ce sera vide, Hugo Lindenberg présente l’hypersensibilité (inhérente à l’enfant-je ou, tout du moins, grandement alimentée par son statut d’orphelin) dans sa magnificence paradoxale : c’est parce que le narrateur en est affublé qu’il est éminemment conscient du vide corporel inéluctable qui nous guette mais aussi pour la même raison que chacun de ses sens l’irradie continuellement. Au fil des pages, le narrateur se met à exister, révélé par deux êtres qui lui font comprendre que cette plénitude, digne colmateuse de gouffre existentiel, est à cueillir tout simplement au creux de lui-même, lorsque, mûrie par leur fréquentation mutuelle, elle s’est gorgée d’un rayonnant aplomb. Il connaît en effet de vives sensations corporelles en compagnie de sa grand-mère (« Qu’elle plie le linge ou qu’elle repasse, la sensation est la même que lorsqu’elle me lave. Une rivière somnolente s’écoule le long de ma nuque ») ou de Baptiste :
« Il lève et sans lâcher mon poignet m’entraîne dans les vagues. Je serpente à son bras comme un foulard au vent. Me voilà immergé jusqu’aux cuisses. Bientôt l’eau glaciale me ceinture et deux vagues plus loin elle s’enroule à mon cou. Et c’est l’une des choses les plus agréables qui soient. »
Ces deux condiments (Baptiste et sa grand-mère) colorent ses sens et l’ancrent dans une riche réalité sensorielle indétricotable d’un heureux temps présent, annulant génialement toute obligation de songer à l’avenir.
Le vide, lorsqu’il est mental, n’est pas classé dans ce qui doit être dépassé : il prend ses aises dans l’esprit de ceux qui ne sont pas tourmentés. Tandis que l’espace mental de Baptiste est « (…), une très grande maison aérée, avec plafonds de trois mètres de hauteur et parquet ciré, un piano à queue et de grandes fenêtres ouvertes sur un jardin luxuriant », celui de son nouvel ami s’apparente davantage à « (…) un taudis aux persiennes duquel [ il ] observe le monde ». Assailli de pensées parasites qui génèrent des « bruits dans la tête », l’esprit du narrateur, alourdi par la compagnie étouffante de nombreuses créatures, prenant le contour des malheurs de son enfance orpheline et de ceux, partiellement inconnus, de ses ancêtres, migre alors volontiers vers le vide pacifique et silencieux de l’esprit délié de ami, générateur de créativité. Preuve d’hypersensibilité, cette capacité à se figurer le flux mental d’autrui – dont l’attendrissant potentiel comique est rapporté (« (…) mais une pensée vient me distraire. Une pensée si affreuse que je ne peux plus me l’ôter de l’esprit. Quelque chose d’irréparable. Et si j’avais oublié de tirer la chasse le jour où j’ai dormi chez Baptiste ? ») – se veut rafraîchissante mais accélère également ses angoisses (et si le foie haché, offert par sa grand-mère aux parents de Baptiste révélait « l’enjeu disproportionné de cette rencontre fortuite avec un petit garçon de son âge » ?). Enfin, ressentir énormément a la touchante conséquence d’exacerber les indices émotionnels de ses semblables : expert en émotions, le narrateur, en vaillant funambule, ressent les craquellements de celleux qui l’entourent, allant même jusqu’à couvrir de pudeur des émotions qui ne sont pas siennes et à se faire le réceptacle de souffrances plus larges (« Que se passerait-il maintenant si tous les soldats morts sous leur croix se mettaient à me parler en même temps ? »).
« Ça m’énerve, parce qu’il y a un tout petit fil, très fragile, tendu à l’intérieur de moi, un fil invisible que je ne sens pas, mais dont je sais que si un jour il casse, si à force de colère, d’ongles plantés dans les poignets, de désespoir, je le casse, alors moi non plus je n’aurai plus le courage et ça je ne veux surtout pas y penser. »
La douceur comme solution
C’est avec la même finesse qu’Hugo Lindenberg manie enfin l’épineuse question du genre qui, simplement évoquée par un petit garçon de dix ans, conduit au merveilleux éloge de la douceur.
« Ce qui fait de Baptiste un vrai garçon, un garçon exceptionnel, c’est qu’il n’a besoin de rien pour en être un. À moi, cela demande une concentration permanente. Je dois toujours bien penser à mettre une intention de garçon, de ce que j’imagine être un garçon, dans chaque phrase, chaque geste, chaque idée, parce que je vis dans la peur d’être démasqué et cette peur est d’autant plus difficile à maîtriser que je n’ai qu’une idée grossière de ce que doit dire, faire ou penser un vrai garçon. Baptiste, lui, n’a pas à s’en soucier. Il n’est pas comme ces idiots de l’école qui se rassurent dans la violence et la domination ou leurs valets qui leur prêtent allégeance en riant faux. (…)
Mais Baptiste était Baptiste, il pouvait préférer le rose à toutes les autres couleurs, être doux et bienveillant, adorer jouer avec sa sœur sans que cela ne vienne jeter le trouble sur son identité de petit garçon (…)
C’est [la douceur] qui nous protège toujours, même des garçons de la plage, parce qu’ils savent ce qu’il y a [dedans]. Leur agressivité ressemble à de la peur pitoyable devant lui. »
L’enfant-méduse
Avant de rencontrer Baptiste, l’enfant-je auscultait une méduse, dont on décèle l’aptitude à fédérer des amitiés, et celle-ci ne le quitte plus. Motif de rencontre estivale mais aussi de réévaluation des rapports de force traditionnels, celle dont les structures sensorielles peuvent être très élaborées constitue le parfait alter ego d’un être à l’acuité sensorielle communicative. Il la mobilise pour matérialiser l’agitation de son esprit (où se donne « un concert de voix molles des méduses ») jusqu’à s’identifier entièrement à elle, dans sa célébration de Baptiste (« Je suis comme une grosse méduse dont tous les filaments seraient tendus vers lui »).
Dans Un jour ce sera vide, une parure dorée couvre l’hypersensibilité et l’introversion qui, premières, déroulent l’histoire : même si leurs aspects les moins réjouissants sont abordés de façon immersive, leurs fantastiques atouts sont prouvés, page après page, à la fois par la conscience aigüe de la beauté du réel qu’elles impliquent (qui aurait cru que lire l’enthousiasme de quelqu’un qui observe tenacement des fourmis était aussi réconfortant ?) que par la puissante manière qu’ont celleux qui en sont marqués d’interagir avec autrui, diffusant amour et admiration par leur regard. Alors que le solaire Baptiste est du côté des observés, le discret narrateur est de ceux qui observent (encenseur de fonds marins, en parfait introverti, il remercie sa grand-mère de ne jamais l’amener au restaurant « (…) tant il est clair que [ leurs ] repas n’ont pas besoin de publicité »). Il est rejoint par le.la lecteur.rice qui, passif.ve et ravi.e, prolonge ce regard, observant un spécialiste éplucher le réel de ses yeux.