Un refuge qui fait écho

C’est à l’ombre de la gare des Guillemins à Liège que je retrouve Éric Piette. Nous n’aurions pu imaginer cadre plus symbolique pour cette rencontre tant l’œuvre du poète carolorégien, Bruxellois d’adoption, est marquée par le voyage et le défilé des trains. Le temps de trouver un café où nous attabler et la conversation commence. « Ne jouons pas les inconnus, tu peux me tutoyer. »
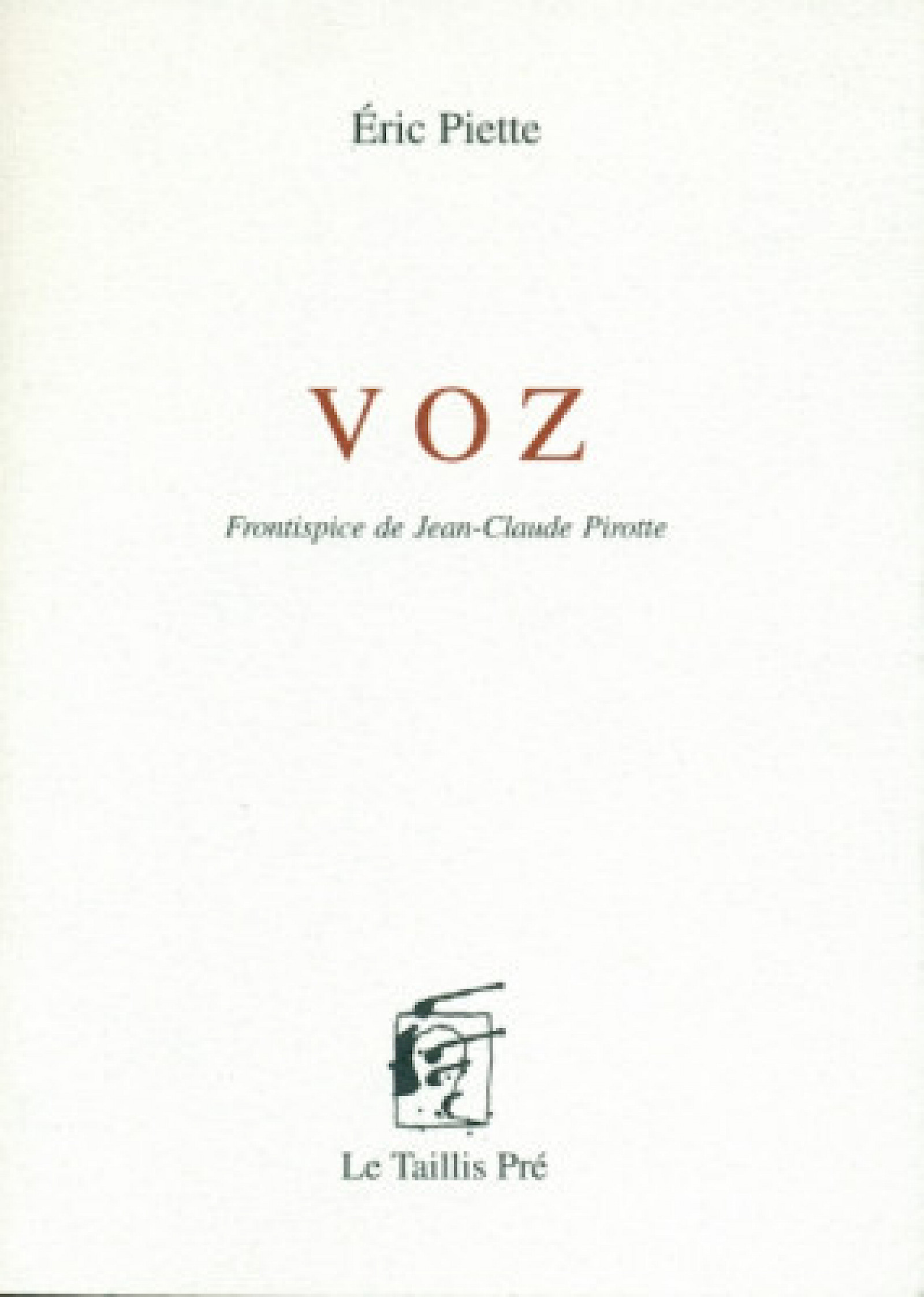
Dans
VOZ
1
, ton premier recueil, tu disais que «
la souffrance est un chien de compagnie / laissé à la gare de Liège
». J’espère que tu ne l’as pas croisé en chemin.
J’avoue qu’en débarquant sur le quai, j’ai revu cette image d’un jeune type qui me ressemble, cinq ans plus jeune. Je me suis dit que ce chien de compagnie, il me léchera toujours et que j’ai bien fait de prendre ce train pour Vienne en octobre 2010. La gare a changé. Je ne savais pas, il y a cinq ans, si quelqu’un m’attendrait à Istanbul. Mais je sais aujourd’hui que j’invente de nouvelles lignes de fuite.
Plus que les voyages, ce qui m’a interpellé dans ta poésie est l’utilisation des noms de ville, non seulement dans les poèmes mais également en guise de titres. Tu as expliqué que c’était pour toi des mots-images, la marque d’un tempérament. Pourrions-nous y voir également une façon de se repérer, de s’ancrer à un endroit ?
Tout à fait. J’ai toujours eu le sentiment d’être né quelque part et de venir de nulle part. Je suis là où je suis et parfois je ne sais plus où je suis. Le ventre d’une mère n’a pas vraiment de nom et comme dit Achille Chavée, « sortir du ventre de sa mère, c’est ça l’exil ». Peut-être que je suis un exilé volontaire et que cet exil m’aide à survivre mais je ne vivrais pas, sans doute, si je ne pouvais pas inscrire un nom (de ville ou autre) sur le papier. Et cela parce que, justement, et comme tu le dis bien, cela m’ancre (pardon pour le jeu de mots facile). Écrire, c’est nommer. Et peut-être que nommer de quelque manière que ce soit me rend plus réel ou rend plus réel Istanbul, par exemple, même si cette réalité s’accompagne toujours d’une sorte de rêve. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’œuvre de Jean-Claude Pirotte m’a tant interpellé lorsque Alain Dantinne me l’a fait découvrir.
Le proverbe dit que les voyages forment la jeunesse. Corrige-moi si je me trompe mais j’ai l’impression que tes poèmes forment, c’est-à-dire mettent en forme, ton enfance.
Tu as tout à fait raison et je m’en rends souvent compte après la publication d’un livre. Finalement, l’enfance nous tient aux basques, ne nous lâche pas, met en mouvement quelque chose en nous d’incompréhensible. Je crois qu’on y revient toujours. Là est la base, peut-être, de mon besoin d’écrire. On résume trop ce que j’ai écrit à « l’enfance blessée » mais je ne comprends pas. Alors, j’écris.

La famille occupe une place en creux dans ton œuvre. Tu dédies
Voz
à ton grand-père avant d’offrir de façon ambiguë un poème à ton père « dont l’existence fut attestée ». Dans
l’Impossible Nudité
, tu sembles un peu apaisé en dédiant ce recueil à tes parents. La poésie te semble-t-elle le meilleur outil pour ce type de questionnement ?
Tout ça est très ambigu, je ne pourrais pas y répondre clairement mais j’y ai justement pensé avant-hier. Je me suis rendu compte que ce « père dont l’existence fut attestée » n’était qu’une ombre et que je ne savais pas à qui je m’adressais. La figure du père (le grand-père, peut-être) est très présente dans mon premier recueil et celle de la mère dans
l’Impossible Nudité
. Mais j’ai remarqué aussi que les deux premiers dédicataires de
l’Impossible Nudité
sont deux figures parentales2
. La famille prend de la place, oui, puisqu’elle est « lieu de décomposition ». On écrit d’où l’on vient même quand on ne sait pas d’où l’on vient. Du « non-dit de l’enfance », il s’agit pour moi de dire. Dire quoi ? Je le saurai vraiment quand je serai mort. Donc, je ne le saurai jamais. Mais une chance est certaine : de la décomposition il faut composer.
La matière sonore est aussi un moyen par lequel tu passes pour toucher la question, je pense à
pas à pas
ou à
amer
qui renvoient en filigrane à la famille. Avons-nous là une de tes façons de composer ?
Je suis très sensible à la musicalité (oui, je sais, c’est banal) et il faut, quand j’écris un poème, que lorsque je le relis, je sente quelque chose de mon corps qui vibre. J’ai besoin de rythme. Ce n’est pas pour rien que je pense souvent à Cendrars, à ce qu’il dit du rythme des trains du monde entier, etc. D’où, peut-être, le besoin d’assonances, d’allitérations, de rimes intérieures. Sans doute aussi une grande influence d’Apollinaire dont la musicalité et l’arrière-plan poétique (comme Villon, Carco et tant d’autres) me séduisent particulièrement. Je crois que la nuit a un rythme qui ne ressemble pas spécialement à une rime riche. Il me semble aussi que je me débats contre toutes sortes d’enfermements comme l’a bien relevé Pierre Schroven il y a quelques années. Cela ne m’était pas apparu immédiatement. Est-ce pour cela que je n’utilise pas de ponctuation ? Je fais confiance à une sorte d’instinct qui n’est peut-être simplement que celui d’un lecteur qui souhaite ne pas se taire définitivement.

Derrière le pur travail de la forme m’apparaît une envie d’aller vers l’autre, que ce soit grâce aux nombreuses dédicaces, aux citations, ou à travers certains de tes thèmes, notamment les lieux de sociabilité comme les cafés ou les wagons de trains. Quel type de contact la poésie te permet-elle d’atteindre ?
J’ai toujours ressenti un besoin d’aller vers l’autre et vers l’ailleurs. Aller vers l’autre, c’est une façon d’aller vers soi et aller vers l’ailleurs, une façon de se rendre compte qu’on est ici. Ceux que je lis, morts ou vivants, demeurent vifs, m’apportent un surplus de vie. J’ai donc une dette envers tous ceux qui me permettent de supporter le fait que nous soyons (presque) obligés de durer le plus longtemps possible sur cette Terre. Malgré moi, je ne peux m’empêcher d’avoir une infinie tendresse pour l’humanité. Mais l’humanité, c’est aussi le paysage. La chose essentielle que m’a apportée le fait d’avoir eu la chance d’être publié, je le répète sans cesse, c’est de rencontrer. Ce sont les rencontres entre un tu et un je ou un je et un tu. Écrire, c’est s’adresser. Pourquoi ai-je besoin de m’adresser à… ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que ceux qui viennent à moi après m’avoir lu m’offrent une fraternité et c’est peut-être cela que la poésie permet : la fraternité. Mais aussi la résistance.
Certains poèmes de
l’Impossible Nudité
ont été composés avec d’autres poètes. Comment sont nées ces collaborations ?
La manière d’écrire avec « tel auteur », c’est soit que je le cite en italique, soit que je fais directement référence à son œuvre, un poème, une conversation, un état. Nous sommes de toute manière des lecteurs. Je continuerai la banalité de mon propos en ajoutant : des lecteurs qui écrivent. Je me sens en dette. Je suis accompagné par ces
frères humains
et je me ne me sens pas l’unique dépositaire de quelque chose que j’aurais à dire si toutefois j’ai réellement des choses à dire. Il s’agit de filiations. On en revient encore à la famille. Ma famille est composite, composée et composante. Toujours ce binôme, aussi : décomposition/recomposition.
À côté de cette volonté d’aller vers l’autre, un aspect inquiétant transparaît dans l’évocation des masques, des regards scrutateurs. Comment fais-tu la part des choses entre l’exposition que demandent les rencontres et les jugements qui peuvent en naître ?
Je fais ce que je peux. Michaux a écrit dans
Poteaux d’angle
: « C’est à un combat sans corps qu’il faut te préparer. » Un jour, je comprendrai vraiment ce que cela veut dire, mais il semble que ça touche à ça. Qui n’a pas de masque ? Qui n’en porte pas ? Et n’y a-t-il pas toujours de la vérité dans le mensonge et du mensonge dans la vérité ? « De faux masques tombent, de véritables apparaissent. »
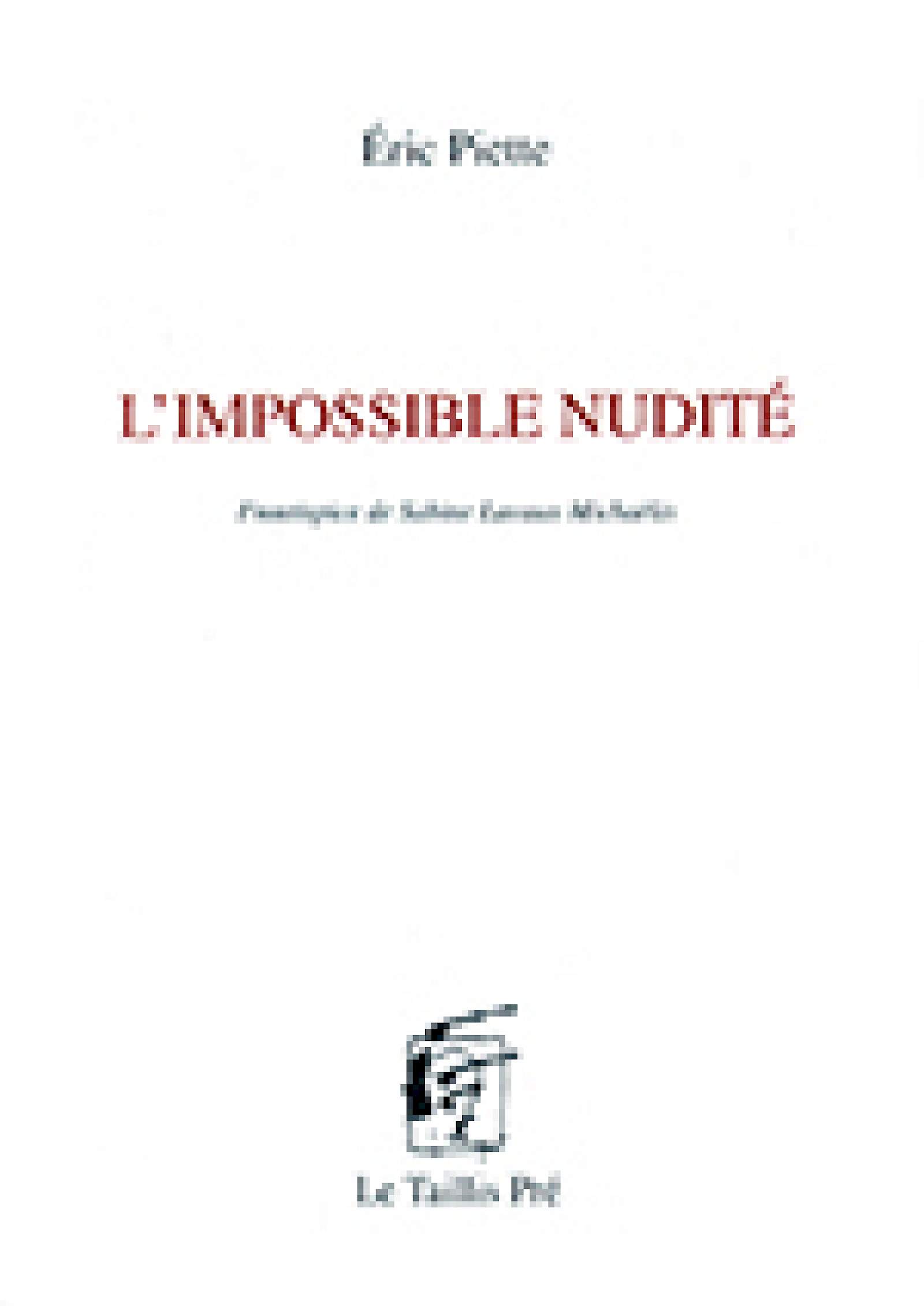
Dans l’Impossible Nudité tu écris : « peut-être devrais-je écrire en prose / ou pas du tout ». Cela fait un moment que tu voulais te lancer dans l’écriture d’un roman. Pourtant, si les poèmes de ton deuxième recueil sont numérotés, ce qui donne un semblant d’ordre, tu n’utilises ni majuscules ni marques syntaxiques. De plus, nous y retrouvons plus de poèmes très courts que dans Voz . Comment envisages-tu ce grand chamboulement que sera l’écriture en prose ?
Avec angoisse. La prose m’a toujours fait peur. Parce que cela demande beaucoup de travail. Ne pas répéter le même mot à foison dans dix pages d’un roman, ce n’est pas la même chose que mes petits brouillons poétiques.
Tu fournis beaucoup de travail dans l’écriture poétique. J’entendais que tu restais parfois dix heures par jour à ta table à écrire. Me viennent deux questions : comment choisis-tu finalement les textes qui formeront ton recueil et aurons-nous un jour une parution spéciale de tes brouillons ?
Ta question me fait rire parce que la semaine dernière, j’ai écrit un poème qui se terminait ainsi : « mots que je ne publierai jamais / ils sont des dessins perdus ». Dans le fond, ce que je n’ai pas publié restera dans les tiroirs et c’est moi, devant toi, le brouillon que tu lis. Pour répondre à la première partie, vu que j’ai l’art de tout faire à l’envers et qu’il paraît que je suis le roi de l’esquive, choisir ce que je publie ou non est un travail presque aussi intense que l’écriture. Car il faut qu’il y ait une cohérence : ni trop peu, ni trop. Il faut parfois laisser reposer, relire et, instinctivement, encore, jeter des pages à la poubelle. Eh oui ! J’en suis encore au papier !
Tes recueils ont reçu différents prix. Tu disais que cela t’intéressait finalement moins que le contact avec tes lecteurs. J’ai cru comprendre que tu siègerais toi-même bientôt dans un jury. Cela change-t-il ta vision de la chose ?
Cette année, ce sera la deuxième fois que je serai jury du prix Gauchez-Philippot. L’année dernière, c’étaient les romans, cette année, la poésie. J’ai été surpris de voir la manière démocratique dont cela se passait. Peut-être n’en va-t-il pas de même pour tous les prix, je n’en sais rien. Par rapport à mon travail, cela m’enrichit. Car parfois je découvre de très belles choses que je n’aurais pas découvertes autrement. Mais cela pose aussi l’inévitable question : qui suis-je pour juger et juger quoi ? J’en reviens donc à mon amour de la littérature et c’est cet amour-là qui prime, aussi subjectif qu’il soit. Que faire d’autre ? Comment agir autrement ? Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais dû me forcer à poser comme principe le « non-copinage » car ce qui importe, et je le répète fortement et contre ceux qui prétendent le contraire, c’est cet amour de la littérature qui me porte. Pour terminer de répondre à ta question, profondément, je remarque que cela m’apprend à me faire confiance.

Dans le même temps, tu pilotes la revue
Feuillets de corde
.
C’est une revue créée par Daniel Simon et Jack Keguenne il y a un peu plus de deux ans. Ils m’avaient invité à participer à un numéro et, lorsqu’ils ont décidé mutuellement de se séparer, Daniel Simon m’a proposé de reprendre cette aventure avec lui, ce que j’ai fait durant une année. Nous avons suspendu provisoirement la publication mais à notre avis les
Feuillets de corde
vont reparaître épisodiquement. Il faut savoir aussi que Daniel Simon a créé une nouvelle maison d’édition qui porte le nom de
Traverse
et, en primeur, je t’annonce que mon troisième recueil, intitulé
Vers l’île
, paraîtra chez lui à la fin de 2015.
Cette expérience de collaboration autour d’une revue m’a montré tous les aspects que j’ignorais et tout le travail que cela demandait. Ce que j’appellerais l’arrière-salle de la publication. J’ai encore plus de respect pour le travail des éditeurs petits et grands, et surtout petits, qui donnent tant et tant d’eux-mêmes, jusqu’à l’épuisement, pour défendre ce qu’ils pensent devoir accomplir jusqu’au bout.
Finalement, Eric Piette ne chercherait-il pas, plutôt qu’un
appartement prêté
, un lieu
refuge
où se poser ?
Ta question de conclusion me ravit. Cela rejoint presque la totalité de tes questions dans le fond. Qu’est-ce donc sinon un refuge, la littérature ? Un refuge qui fait écho. Qu’est-ce donc l’écriture sinon aussi un refuge qui fait et donne écho ? Le nom des villes sont des villes-refuges, des symboles-refuges, que sais-je ? Et puis je songe à cette épigraphe de Michaux dans
l’Impossible Nudité
. Qu’ajouter ? Finalement, s’il est vrai que je suis un exilé de naissance, n’est-ce pas un bon choix que de chercher refuge ? Dans l’amitié, l’amour, les lieux, la littérature. Mais n’est-ce pas aussi, si l’on y regarde de plus près, le propre de notre condition humaine : trouver refuge ?