Je n’aime d’amour

Début mai, Chantal Thomas, ou l’élégance littéraire française dans ce qu’elle a de plus authentique et sadienne, présentait à Passa Porta son dernier ouvrage. L’occasion d’une rencontre située à mi-chemin entre mère, océan et composition romanesque.
Nous nous retrouvons, Chantal Thomas et moi, dans la cour intérieure située au premier étage de la maison internationale des littératures Passa Porta. Il fait chaud en cette après-midi de mai. Nous préférons, pour notre petite causerie, un banc de bois à l’ombre de la cour au salon feutré par lequel un certain marquis aurait sans doute été davantage attiré. Chantal Thomas a des iris d’eau claire, une voix qui caresse l’âme comme un voile de satin la peau nue des épaules, et la présence d’une mer d’huile. Lorsque je mets le dictaphone en marche, j’ai l’impression de débuter un jeu d’enfant avec une amie d’un jour sur une plage de grandes vacances, tous deux baignant dans le sable meublant d’une flaque de marée. J’avoue d’emblée à ma nouvelle amie que je n’avais rien lu de son œuvre avant de me laisser absorber par son dernier ouvrage, Souvenirs de la marée basse , que je le finis à peine, et qu’il s’agit pour couronner le tout de la toute première interview que je réalise… « Comme un puceau je me présente à vous… » ai-je envie d’ajouter. Le sourire bienveillant de Chantal me précède : « Ce sera donc une première à tous points de vue » me dit-elle sur un ton implicitement complice. Sa réponse me met à l’aise, je pars d’un rire d’écolier et opte pour la spontanéité la plus complète, tout en restant conscient de l’envergure de l’auteure que j’ai en face de moi : grande dame de la littérature, multiplement primée, adaptée au cinéma par Benoît Jacquot ( Les Adieux à la reine ) et Marc Dugain ( L’Échange des princesses ), spécialiste de Sade et de Casanova, directrice de recherche au CNRS, amoureuse de la mer… Pour mon baptême de l’eau, je suis entre les mains d’une nageuse olympique. Que faire si ce n’est le grand plongeon ?
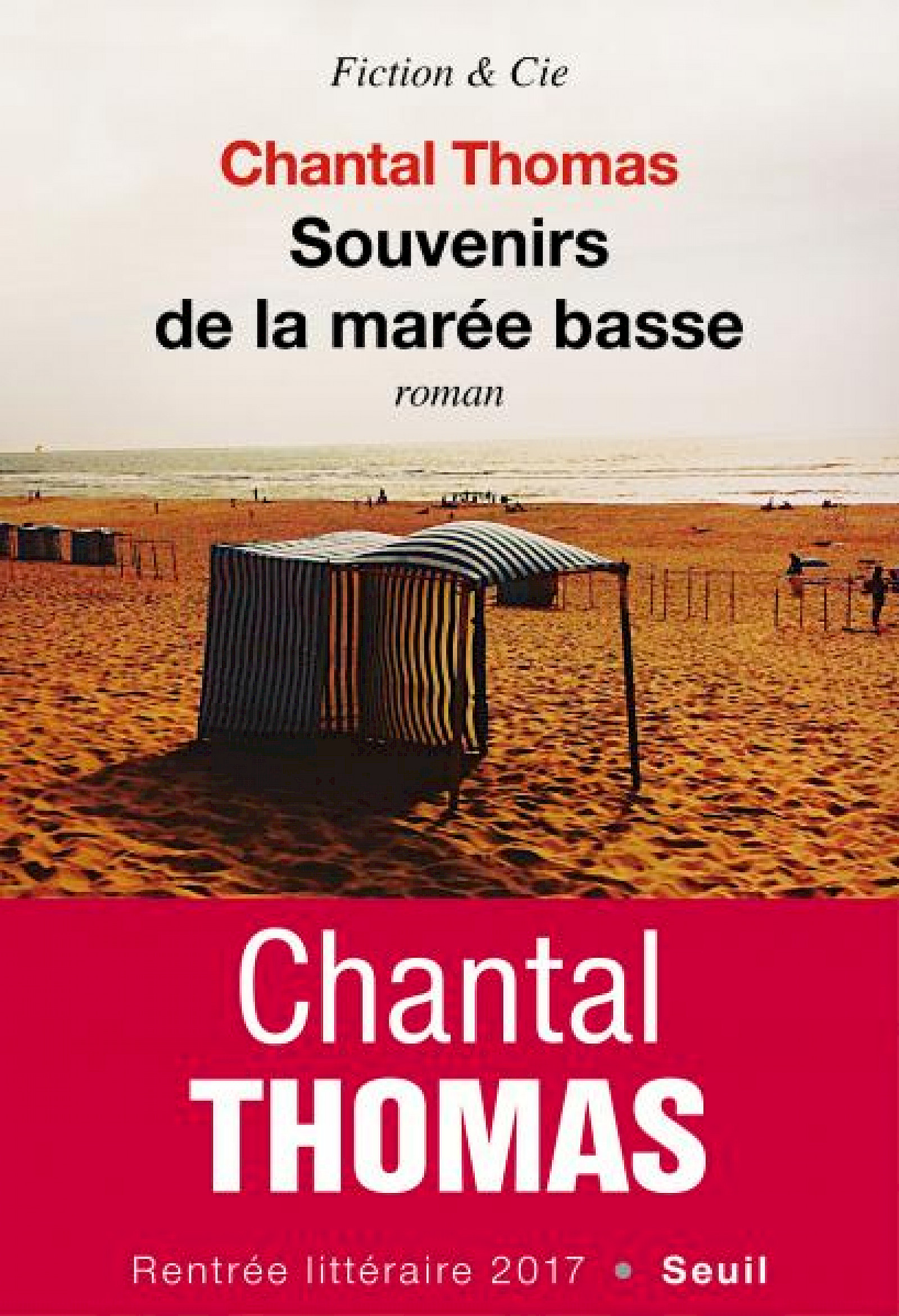
Un chapitre du livre m’ayant particulièrement charmé est celui de la « dictée ». Vous écrivez que, petite, vous vous autorisiez notamment à écrire « j’irrai », en roulant bien les R, tant vous étiez « incroyablement contente d’y aller ».
C’est un réel souvenir d’école. Je me souviens avoir été choquée par la manière dont on nous affirmait qu’il n’y avait qu’une façon de faire chaque chose, l’orthographe étant le sommet en la matière. C’était comme ça pour tout : se mettre en rang, le temps durant lequel on avait le droit de jouer, le temps venu de s’arrêter immédiatement… Tout m’apparaissait comme « en boîte », dénué de chemins de traverses, soit le contraire de la mer, du bord de l’eau. La plage, c’est un espace sans marges, l’inverse de l’oppression.
Je vous cite : « Pourquoi en matière de mots y a-t-il un arrêt dans la suite des métamorphoses. » C’est très parlant. On souhaiterait effectivement, comme les vagues qui roulent plus ou moins fort au gré des vents, que chaque mot puisse évoluer orthographiquement au gré du sens, des couleurs qu’on entend lui donner ou de l’environnement dans lequel il s’exprime.
Tout à fait. Et cela pose le problème de la mauvaise orthographe, qui peut bloquer par exemple lors des examens. C’est très compliqué à surmonter et injuste en fin de compte. Mais je suis persuadée que l’on peut avoir des idées extraordinaires et devenir un grand écrivain malgré une orthographe difficile.
Vous me rassurez. Il y a beaucoup de passages de Souvenirs… délicieux par leur saveur poétique, je pense notamment à ceux évoquant les eaux sous la jetée métallique – océan de temps, d’excitation et de torpeur – ou les relations tumultueuses entre la Princesse du Palais des Mers et le Maître des Dunes. Un passage à forte charge poétique et psychologique est celui où vous apercevez votre mère, déjà âgée, par la vitre d’un autobus et qu’elle vous « apparaît » en quelque sorte pour la première fois.
Je pense que c’est un phénomène qui peut se produire souvent dans les relations familiales : tout d’un coup, quelque chose nous est révélé sur des personnes qu’on connaît si mal, nos parents, par un étranger par exemple, ou par suite d’une phrase prononcée sans que l’on s’y attende et qui ouvre comme un pan d’inconnu.
« Je suis rentré chez moi enthousiaste d’elle, comprenant à quel point la raison n’avait jamais été son ancrage et que moi-même, comme les autres autour d’elle durant tout le temps d’Arcachon, j’avais tenu à la confiner dans un rôle et l’avais détestée d’y réussir si mal. »
Au-delà de la création romanesque, ma mère était, dans la réalité, dépressive. La dépression est une chose qui n’arrive pas d’un coup, elle s’immisce insidieusement. Une mère dépressive ne vous aide pas – même si certaines parviennent à jouer leur rôle, faisant le pas sur ce qui ne va pas pour mieux s’occuper des enfants, conserver à leur yeux une flamme optimiste. Être avec ma mère, c’était comme être avec une enfant pas très bien adaptée. Comme je vivais à Arcachon, qu’il y avait cette amie (Lucile), mon père et mes grands-parents, cela changeait quelque peu la configuration. Mais c’est vrai que le fait de vivre avec une mère qui, soit n’a pas le goût de vivre, soit l’a d’une manière si fragile que c’est comme « par éclair » en somme, implique pour l’enfant de se débrouiller tout seul.
Et pourtant vous avez réussi à vous construire, ce qui n’est pas le cas de tous les enfants de parents dépressifs.
Oui. C’est bizarre… Je pense que c’était vraiment le bord de mer, je nageais de mon côté, ma mère du sien. Elle faisait partie du paysage mais elle n’occupait pas une place énorme non plus. C’étaient des lieux où le dehors était immense vous savez : l’océan, les plages de l’océan, les bouffées d’oxygène constantes, tout cela relativisait la situation ; et, à l’intérieur de ces immensités, de ces vastes étendues, je me construisais des petits endroits à moi, des cabanes imaginaires pour me mettre à l’abri des bateaux, autant de lieux de replis – je suis sûre que dans une ville, cela se serait passé très mal.

En fin de compte, votre mère et vous, vous vous libérez l’une l’autre en nageant, chacune fluidifiée par la fluidité de l’eau.
Tout à fait. C’est une histoire de séparation et de jonction, c’est final. Toutes les deux, nous évoluons dans des courants qui ne se rencontrent pas, peut-être même incompatibles pendant très longtemps, pour finalement nous rejoindre grâce à cette fluidité préexistante qui finit par nous rapprocher.
Cette fluidité qui aboutit à ce très beau passage dans lequel on se rend compte que votre mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui décrit le contraste, le choc entre les souvenirs qu’elle refoule volontairement – la noirceur liée à Arcachon, sa période de femme au foyer – et les souvenirs sujets à un réel oubli pathologique. Je vous cite encore :
« Ma mère a tellement travaillé dans le sens de l’oubli, tellement voulu oublier, que maintenant que l’oubli lui arrive de l’extérieur, en forme de pathologie, elle a une supériorité sur ceux qui ne s’y étaient pas entraînés, ceux que l’oubli frappe de plein fouet. Elle est étrangement à l’aise avec le processus mystérieux et actif en train d’effacer certaines de ses données existentielles. Elle est à l’aise ; elle n’est pas complice. »
Vraiment oui. Nous avons mis beaucoup de temps mon frère et moi à nous apercevoir de sa maladie. Parce qu’elle savait si bien masquer les oublis vous voyez. Lorsqu’elle vous posait une question par exemple, elle n’écoutait pas la réponse ; lorsqu’elle sortait, elle laissait tout en plan. Mais elle avait fait cela tout sa vie, donc… C’est finalement un médecin qui nous a mis au courant. Pour des personnes très ordonnées, très rationnelles, cette maladie doit d’ailleurs être d’autant plus terrible. René de Ceccatty en parle dans son livre Enfance, dernier chapitre : lorsque survient la maladie de sa mère, qui avait été son institutrice et l’un de ses soutiens majeurs tout au long de son existence, c’est une désorganisation flagrante et un choc énorme pour tous deux. Cela me touche que vous ayez retenu ces lignes parce que c’est un passage qui d’habitude n’intéresse personne… Ou plutôt ça intéresse, je pense, mais c’est un sujet trop douloureux. J’ai fait de nombreuses rencontres autour de ce livre et, en général, les gens n’ont pas du tout envie d’évoquer ce chapitre. Alors qu’il donne sens à tout…
Exactement, c’est un moment essentiel : votre mère vous apparaît différemment et la boucle est bouclée en quelque sorte.
Et c’est ce pour quoi j’ai écrit le livre. Cette vie, à la fois banale – même si en soi aucune vie n’est banale –, à la fois d’une impossible liberté, je la recueille. S’il n’y avait pas cet épilogue où finalement je l’aime et l’accompagne dans ce processus d’oubli en essayant de le récupérer, il n’y aurait plus de cercle. Mais beaucoup de personnes sont plus superficielles, préférant les passages de ma mère arrivant sur la plage, nageant, etc. Alors que l’histoire s’inscrit dans le temps, c’est dans le vaste que tout se passe.
Un vaste emmené par cette écriture poétique, votre « petite musique » comme dirait Céline. Comment composez-vous ?
Je suis en effet toujours attentive à insuffler une musique dans mes romans. Particulièrement pour celui-ci. Ma musique naît de touches écrites à la main, fragment par fragment. J’écris une première version manuscrite que je retravaille une première fois lors de la transcription sur ordinateur. Ensuite vient un travail sonore de relecture à voix haute des pages imprimées et d’amélioration jusqu’à la version finale.
Ce premier passage à la main, il est très important pour vous ?
Oh oui !… Quelquefois même il est quasi définitif.
Je vous pose la question car, étant moi-même un enfant du clavier azerty, j’ai tendance à penser que l’écriture manuscrite ne va pas assez vite, en tout cas pas pour moi. Lorsqu’on écrit avec ses dix doigts, on n’est pas tributaire de la lenteur de la main, les idées s’enchaînent et l’on peut écrire, effacer, réécrire et ré-effacer encore…
Et vous effacez tout ?
Euh… oui. Quand ça ne me convient pas, j’efface.
C’est justement la grande différence : quand on écrit à la main, on n’efface jamais tout. On efface même très peu. C’est une énorme différence.
Et cela peut être une énorme perte aussi. On écrit tant en fonction de l’émotion que ce que l’on trouve bon un jour, on peut le trouver très mauvais le lendemain et inversement… Peut- être que les phrases que j’ai effacées hier m’auraient satisfait aujourd’hui.
Oui. Et puis, écrire à la main c’est laisser des traces, de vraies traces comme les écritures sur les murs. Bien sûr, presque tout le monde écrit sur ordinateur maintenant, c’est quasi archaïque de faire ça à la main. Mais lorsque j’entends un ami me raconter qu’il a balancé comme ça tout un chapitre, je n’en reviens pas. Moi je garde tout ; tout ce qui est écrit dans mes livres, je l’ai d’abord écrit à la main. J’y ai ensuite apporté des changements, mais très peu en somme.
Cela me fait penser à Proust et ses paperolles. D’ailleurs vous citez Proust dans Souvenirs… en reprenant ce morceau de phrase incroyable : « la flèche purpurine et crénelée de quelque coquillage fuselé en tourelle et glacé d’émail »
Cette phrase est inouïe. C’est une architecture sonore.
Tout à fait. Elle me fait penser, par sa force, à la musique de la pluie, tout au début de Du côté de chez Swann :
« Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté, suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût laissé tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c’était la pluie. »
Phrase merveilleuse en effet. C’est vraiment cela être écrivain, ou poète : ne pas nommer l’évènement mais le laisser advenir dans toute sa complexité musicale et sensuelle en donnant au lecteur tout ce qu’il y a à ressentir si l’on ne sait pas ce que c’est que la pluie.
Quand on imagine que de tels chefs d’œuvre de mots pouvaient être des premiers jets…