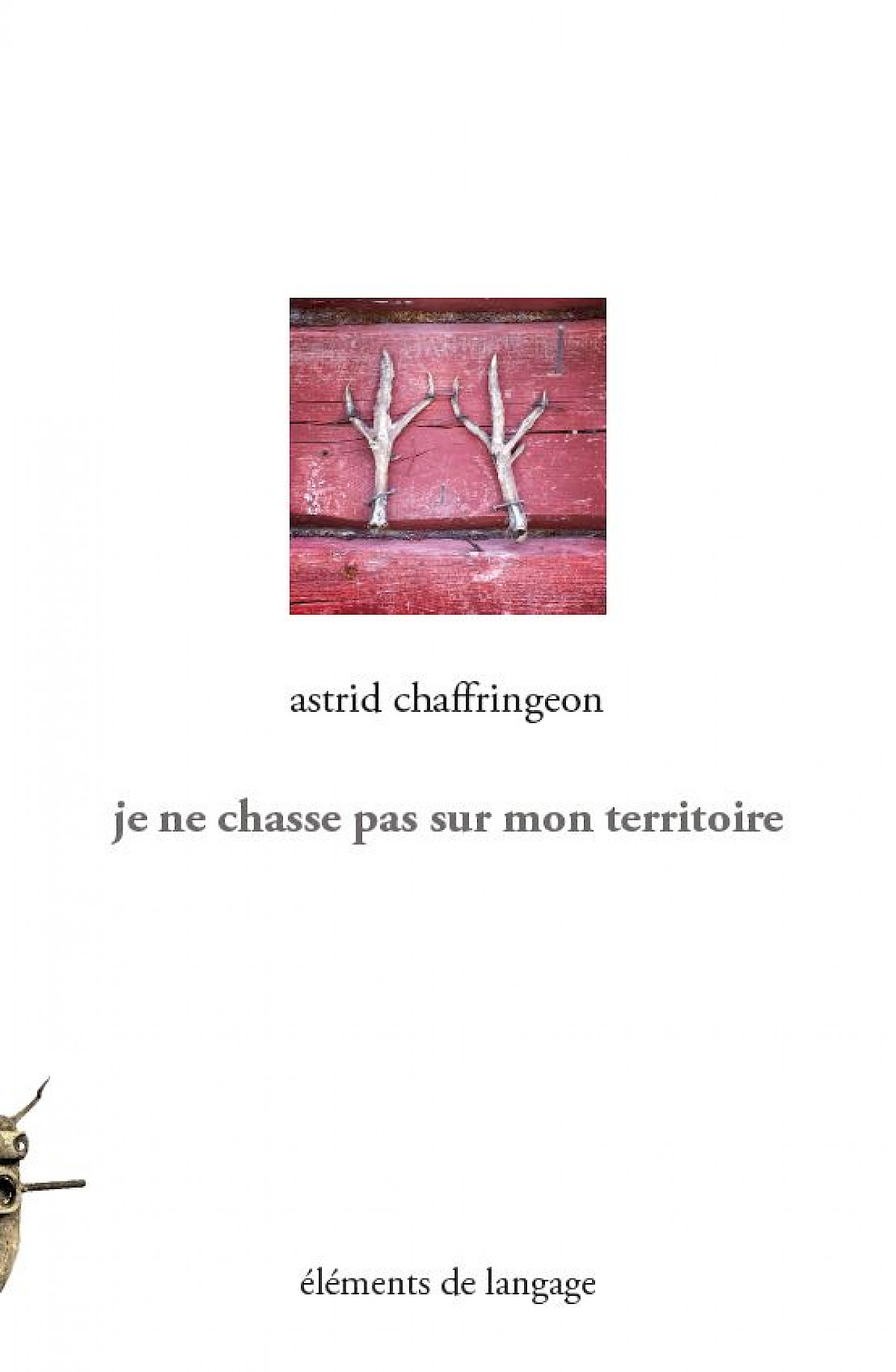
De Paris à Helsinki et ses îles avoisinantes en pérégrinant par Durbuy, le mystérieux monologue en mouvement de la narratrice-photographe Julia Montoro se déroule depuis un point-fixe : celui de sa cellule de prison. Il l’amène à se dégager de ces territoires existants pour redessiner le sien. Avec Je ne chasse pas sur mon territoire, Astrid Chaffringeon signe un second roman éprouvant.
Dès les premières pages, la contraignante posture de thérapeute nous est imposée, tant la narratrice nous prête des pensées, anticipant continuellement nos jugements sur son récit. Ces suppositions – nous penserions qu’elle se laisse facilement emporter par le désir des autres ou qu’il est difficile pour elle d’exprimer rapidement une opinion – traduisent la culpabilité qui la ronge, du fond de sa cellule. Animée par la volonté ambiguë de partager et de taire la genèse de l’acte qui l’a recluse, Julia nous assigne le rôle lui-même ambivalent du thérapeute, à la fois extrêmement proche mais aussi suffisamment distant de son patient.
Louvoyant, son monologue ressasse des questionnements relationnels et artistiques, volontiers redondants, alambiqués et flous, quitte à nous perdre et à nous agacer. Les différents territoires géographiques que Julia évoque pour structurer son récit sont tour à tour raillés,
Heureusement parfois Durbuy se lâche et se laisse emporter par le désir de mal faire. Comme l’année où le Labyrinthe de Barvaux a été le théâtre d’une animation autour des Schtroumpfs quatre mois durant (Schtroumpfs se dit pitufos en espagnol).
présentés dans leur habit primitif et repoussant,
J’avais hâte que l’odeur de la nourriture chaude, de l’eau qui bout, rende ces lieux familiers et ordinaires.
(…)
L’aéroport d’Helsinki sent le neuf, ce qui me trouble. On le dirait sorti tout juste de son emballage. Il singularise et désigne chaque voyageur tant l’espace qui est mis à notre disposition est généreux et ouvert.
ou anticipés par elle-même pour les rendre déjà siens au creux de son esprit. Elle « envisage » en effet le torse de l’homme aimé comme « territoire où plus tard [ elle ] viendra poser sa tête », comme zone d’amour ultérieure. Par ailleurs, en prévision de son voyage pour la Finlande, elle dresse deux listes excentriques et amusantes : l’une sur ce qu’elle sait du pays (à savoir l’absence de futur morphologique en finnois ou la pratique très prisée par les ados du cheval-bâton – hobby-horsing – qu’elle hésite comiquement à classer dans la seconde liste) et l’autre dans laquelle elle se demande si elle doit en avoir peur.
Torturé, peinant à se dire, le territoire émotionnel de Julia se morcelle toutefois joliment dans l’intimité d’un cinéma, au contact physique de la bienveillance enfantine, préservé, pour un temps, de la charge de devoir s’ancrer définitivement quelque part et d’y trouver ses marques :
Je pleure beaucoup au cinéma. Le beau peut complètement me submerger. L’ultra-focalisation, les images et le noir autour, le silence des spectateurs face aux bruits et à la musique des mots ou des instruments font tomber chez moi toutes les réticences et les barrières : je m’effondre. Cela n’a souvent rien à voir avec un moment tenu ou dramatique. Cela peut surgir dès les premières scènes, les premiers pas d’un personnage qui longe un couloir au milieu des chuchotements (…)
Les petits ne disaient rien les premières fois, ils devaient être un peu gênés puis, lorsque nous sommes devenus plus proches, ils riaient comme des baleines, attendant presque impatiemment ces moments où je me noyais sans raison, enfin, lorsqu’ils ont commencé à m’aimer, ils me tendaient des mouchoirs en papier ou me caressaient les cheveux avant de se blottir tous les deux contre moi et accompagner mes hoquets et sanglots de leur présence chaude et tendre.
Muni.e d’une serpe, le.la lecteur.rice avance, les yeux bandés, dans des broussailles émotionnelles étouffantes jusqu’à atteindre le territoire finlandais qui, lumineux, s’offre dans une prose épurée et limpide :
Le plus surprenant et émouvant chez les Finlandais, c’est leur façon de te regarder. Ces gens regardent comme nulle part ailleurs. Comme s’ils avaient dû franchir dix frontières et trois océans pour venir poser leurs yeux sur toi.
Tu deviens pays ou continent du coup. Tu prends de la hauteur, de l’ampleur, tu te gorges de lacs et de monuments. Tu t’étends. Tu t’étoffes. Est-ce par joie toujours renouvelée de confronter leur horizon à des êtres humains – chez eux rien avant très loin devant – mais on dirait qu’ils se moquent toujours un peu de toi et d’eux en même temps. Comme si toute l’humanité n’était qu’un cirque, une farce, un mirage, qu’on faisait tous partie de la même blague.
Finalement, c’est dans le territoire de confiance qu’elle a progressivement aménagé entre elle et nous que la narratrice aurait pu se lover, délestée des reliefs émotionnels qui ont hérissé la chair de ses voyages. Inspirée par le concept séduisant de prison ouverte placée sur une île non loin d’Helsinki, elle semble toujours avoir aspiré à occuper un territoire sans contrôle, offert à soi et non circonscrit par le désir des autres, elle qui insiste sur le fait qu’« (…) on laisse [aux prisonniers de ce curieux espace carcéral] une chance de se réinsérer. On les laisse se débrouiller avec le mal, la liberté. On les confronte à leur propre danger. À eux (…) de définir de nouvelles limites à leur territoire ».
Placée sur un même plan que tout le reste, la teneur de son acte criminel, logée à la fin de ce dense plaidoyer, paraît protégée. Revendiqué comme destructeur de mythes et de structures systémiques (ce qui, malheureusement, est annoncé sans réel appui dans le récit ; de plus, n’aurait-il pas fallu alors pour Julia parvenir à composer avec sa culpabilité initiale pour proposer un éveil féministe fort ?), cet acte est étudié non pour ce qu’il est mais pour ce qui le déclenche et pour ce qu’il dit de notre monde. Il aurait été formidable (et ce tentaculaire monologue, à même de prendre, à tout moment, un autre tournant, aurait alors réveillé un sublime vent de révolte) que la silhouette indépendante de la narratrice finisse de s’esquisser, soustraite au regard et aux attentes d’autrui pour se ménager un territoire à elle, sans devoir commettre l’irréparable. Après avoir choisi de composer contre son gré avec les territoires oppressifs de la société, elle se confronte, pleine de culpabilité, à l’enfermement carcéral. Cette rébellion ne fait tristement que la pénaliser une seconde fois, mais aussi le.la lecteur.rice qui a l’amère impression d’avoir traversé avec peine et en vain une introspection noueuse ne débouchant pas sur ce qu’iel aurait escompté.