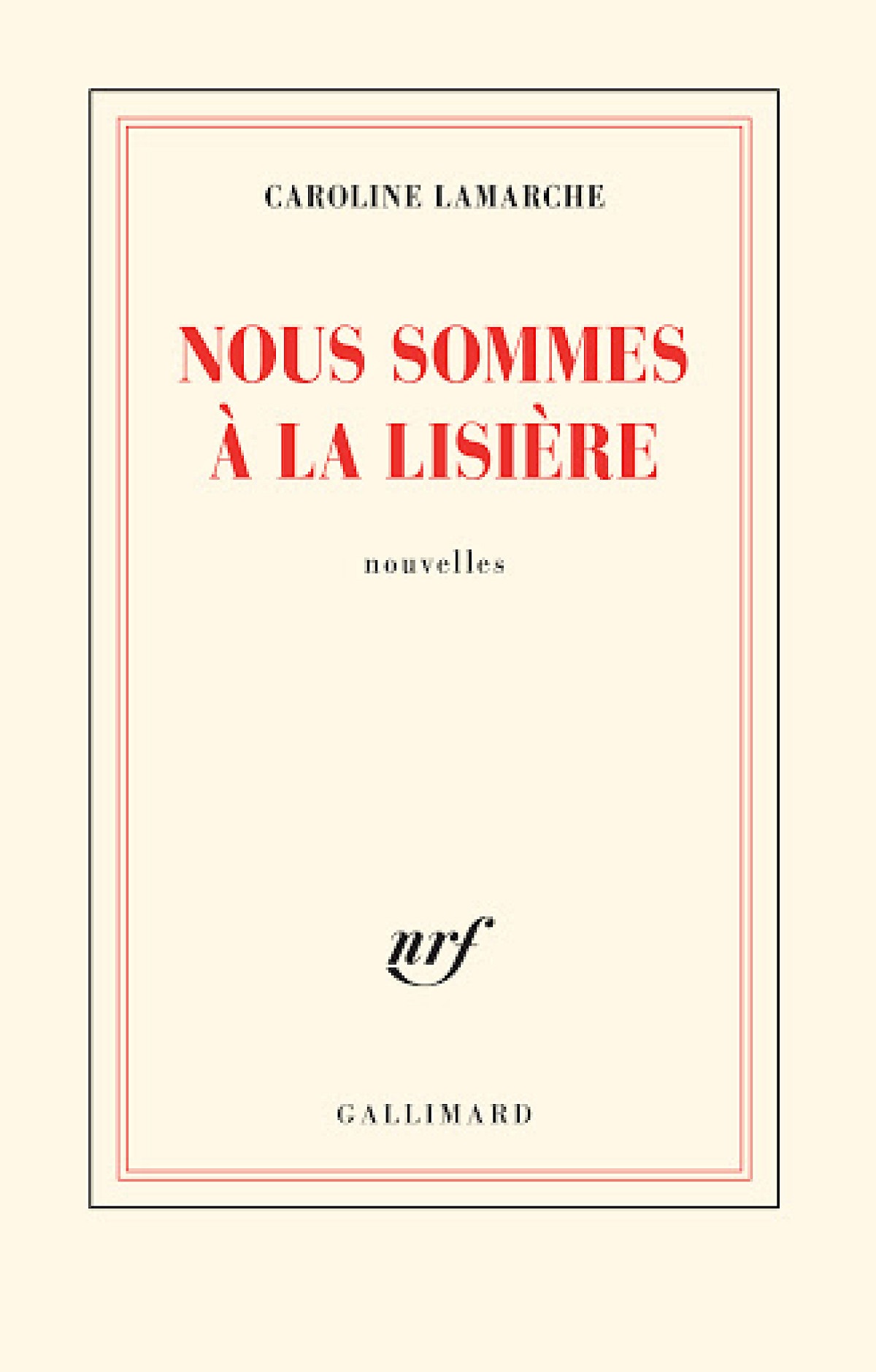
Le dernier recueil de nouvelles de Caroline Lamarche, Nous sommes à la lisière , décrit neuf rencontres entre humanité et animaux. Deux univers qui se ressemblent sans jamais se rejoindre complètement, et qui peuvent s’apprécier, mais sans jamais vraiment se comprendre.
Écrivaine et poète belge, Caroline Lamarche a voyagé entre Liège, où elle est née, l’Espagne et la région parisienne. Il n’est pas surprenant de lire des similarités entre des romans tels que Le jour du chien (Minuit, 1996), qui lui a valu le prix Victor-Rossel, et ses nouvelles qui incluent toujours au moins animal. Prix Goncourt de la nouvelle 2019, Nous sommes à la lisière ne faille pas à cette habitude mais va un pas (ou une patte ?) plus loin en ajoutant une sensibilité humaine à son activisme pour les droits des animaux.
Quand je dis nous , c’est surtout moi. Je vis seul, mais c’est nous. Surtout depuis qu’elle a disparu. J’ai besoin d’un nous dans ma vie. Y a-t-il encore des nous dans nos vies ? Il y a autre chose. Frou-Frou est le miroir de mes pensées.
Cet extrait du premier récit, « Frou-Frou », évoque la tension dominante dans le recueil qui s’exprime à travers la dépendance des humains par rapport aux espèces animales. Même si ces dernières donnent leurs noms aux différentes nouvelles, ils n’en demeurent pas exactement les protagonistes ou les narrateurs. Les animaux servent de prismes à travers lesquels le lecteur ou la lectrice découvre la fragilité et la sensibilité humaines sous toutes leurs formes. Comme la cane « Frou-Frou », ils sont les « miroirs de nos pensées ».
Au-delà de cette perspective anthropocentrique, les tentatives de rapprochement et d’identification à l’autre1 ne manquent pas. La fillette de « Mensonge », par exemple, insinue que le nom de son cheval lui a été donné, « à cause de l’amour », sans doute porté pour sa monture. Elle ajoute par ailleurs qu’« un animal comme Mensonge transporte la forêt à l’intérieur de soi » et qu’« on en devient invulnérable ». Cela étant, rien n’est éternel. Chasse le Mensonge et il revient au galop pour rappeler l’immuable innocence de l’enfant.
Ces tentatives questionnent même certaines traditions chrétiennes, quand, dans « Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien », les poules se voient, comme leurs prétendus supérieurs, potentiellement méritantes de l’hostie :
Peut-être, après tout, le jetterait-on dans la basse-cour proche, celle de sa ferme, contigüe à l’église. Car, en poussant le raisonnement à l’extrême, en quoi un estomac de poule est-il plus indigne de recevoir le corps du Christ qu’un estomac humain ?
De la religion à la littérature, Lamarche passe du coq à l’âne, ou plutôt de la poule au hérisson. Nommé « Ulysse », ce dernier hérisson fait aussi référence à la copie de l’œuvre monumentale bien que déconcertante de James Joyce que la narratrice, professeure de lettres modernes, a jetée dans la mer dans l’espoir qu’elle ne la narguera plus2 . Comme son exemplaire du roman qui survit au naufrage, le hérisson résiste à ses passages sur les routes et « aux piétons incapables de le saisir sans s’écorcher les mains ». Face au snobisme intellectuel, la narratrice se sent incompétente et se conforte en imaginant son Ulysse « blotti sous le ventre bienveillant d’une vache ». L’auteure démontre encore une fois que les apparences sont trompeuses et que la résistance de l’humain ne tient qu’à un fil, ou dira-t-on à une épine ?
Dans le même registre, « Élie » fait implicitement écho au Printemps silencieux de Rachel Carson (1962)3 . Ici, il est question d’une liberté dont le papillon jouit si facilement, alors qu’elle demeure inaccessible pour la narratrice. À travers un rêve, le printemps devient une prison de verre transparent, tout comme sa vie sentimentale. Dans sa nature la plus destructrice et contrôlante, l’homme exerce souvent et malheureusement dans l’ombre. Il est d’autant plus triste de lire que le papillon ne puisse déployer ses ailes que dans un rêve.
L’animal reprend la main dans « Tish », où il est comparé à un humain, voire à un dieu :
Dans le récit de la Genèse, Adam et Ève peuvent tout faire sauf une chose, qui les exclut du Paradis. Avec cette lettre, j’ai perdu le Petit Paradis, cette friche enchantée et sauvage où je veillais sur Odile et Lieve comme un dieu observateur et bienveillant. Ou comme un chat. Une bête errante.
Dans « Tish », il n’est plus question de contrôle mais de bienveillance, et de tolérance. Comme le chat qui erre sans raison connue, le narrateur se complait dans sa vocation auto-désignée de protecteur. Le symbolisme religieux subtil de Lamarche, d’autre part, frappe encore pour démontrer un manque de tolérance, qui daterait peut-être de l’épisode du jardin d’Éden.
« Merlin » oscille entre innocence et responsabilité. « Si vous voulez dire par là que la nature est toujours aussi belle mais que nous la savons malade, oui, en effet, nous ne sommes plus innocents », pourra-t-on lire dans une conversation. L’interrogation de la narratrice sur la souffrance du monde se poursuit ensuite lors d’une rencontre avec une personne malentendante :
Mes paupières brûlent de révolte, un chagrin dur qui a perdu depuis longtemps le tendre chemin des larmes. J’attends que cet homme m’en libère en s’asseyant à son tour, qu’il me parle encore de son ouïe blessée, de cet obstacle entre lui et le monde – un sifflement continu – pour que je puisse comprendre notre innocence perdue, la fin de l’époque enchantée où nous croyions la nature éternelle.
Lamarche rappelle que la « nature éternelle » a toujours été une idée fallacieuse. L’homme a failli à ses responsabilités envers le monde naturel, qui se sent maintenant piégé, impuissant face à lui, comme « l’oiseau prisonnier des branches, pris dans un entrelacs, un piège aérien ».
Le dernier récit de Lamarche, « Rudi », cherche une médiation efficace entre les mondes naturel et humain, une tentative qui se termine en pathetic fallacy4 :
L’adoption d’une créature humaine par un animal est-elle possible ? Quand elle repense à l’écureuil du Green-Wood Cemetery, elle l’appelle secrètement « Rudi ». Comme si Rudi connaissait, lui aussi, ce paysage somptueux veillant sur six enfants enterrés à l’âge tendre. C’est Rudi qui lui est apparu sous la forme d’un écureuil roux, c’est avec lui qu’elle a parlé dans un langage compréhensible d’eux seuls.
Lamarche frôle ici l’anthropocentrisme en proposant un « langage » que toutes espèces pourraient comprendre. Cependant, Nous somme à la lisière ne se lit pas, dans son ensemble, comme une ode à la nature qui raconte les animaux de leur point de vue. L’adoption de l’animal par l’homme, ou l’inverse, ne semble pas vraiment être au programme. La plume de Lamarche baisse plutôt des frontières de plus en plus floues entre les mondes humain et non-humain, et tente d’écouter une nature que nous avons tendance à entendre d’une oreille biaisée, une nature (humaine ?) finalement pas si étrange mais plutôt familière.