Caledonian Road d’Andrew O’Hagan
Rencontre avec un boomer
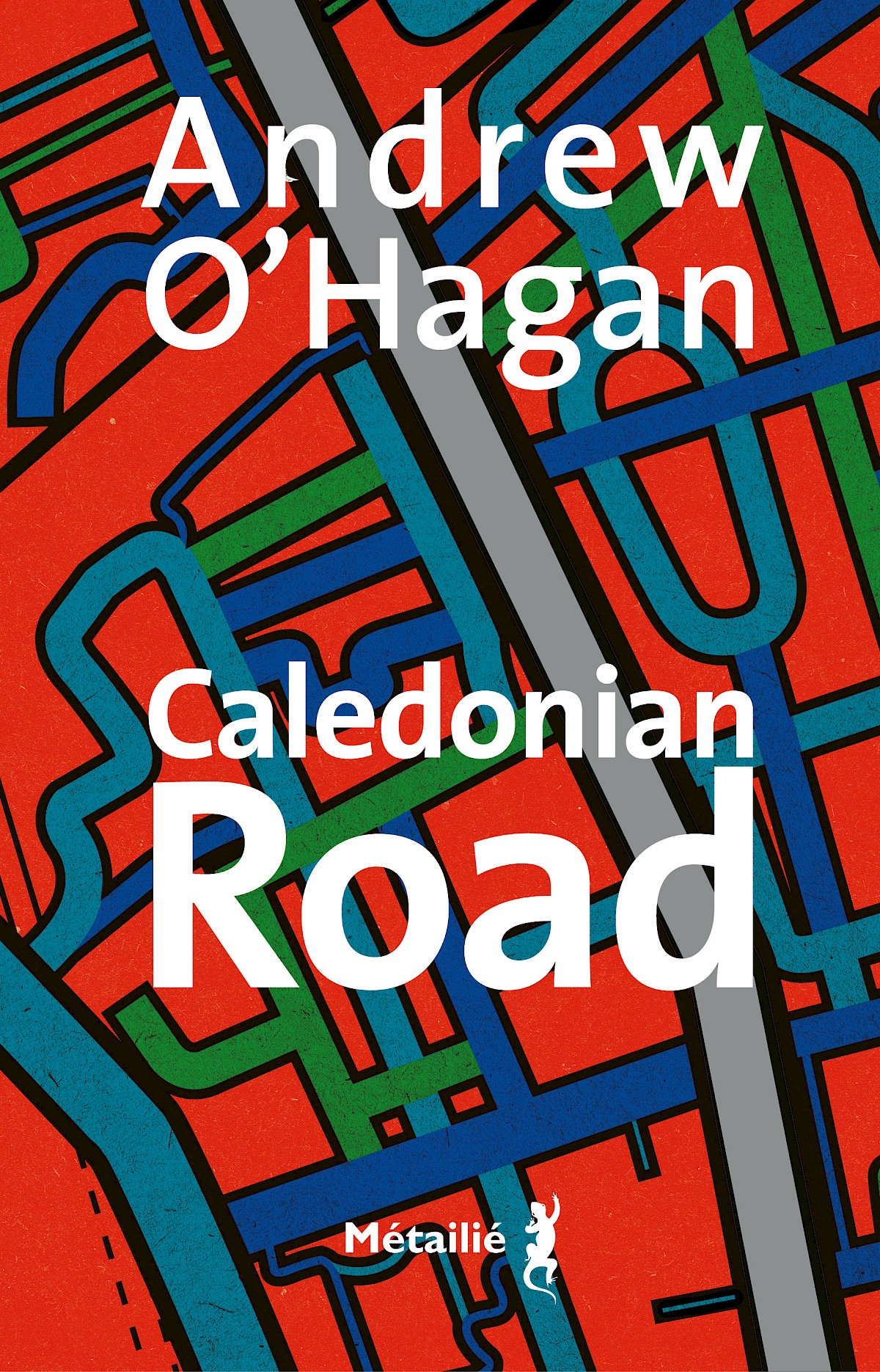
Dans Caledonian Road, Andrew O’Hagan décortique avec beaucoup de cynisme la société britannique du XXIe siècle. Politiciens, ducs ou artistes : tout le monde y passe. Pourtant, c’est le personnage de Campbell Flynn, boomer plein de bonne volonté, qui interpelle le plus.
Reconnue à travers le monde comme un centre d’art et de culture, Londres n’en reste pas moins une ville profondément inégalitaire. De Thornhill Square à Caledonian Road, c’est une réalité tout à fait différente qui se dessine pour les habitants de ces deux quartiers, séparés par quelques centaines de mètres à peine. Ce contraste, Andrew O’Hagan s’en empare pour dresser la fresque de cette société londonienne à deux vitesses, dans une ère post-Covid où la fracture sociale se fait d’autant plus visible. Une réalité complexe qu’il s’efforce de dépeindre avec nuances et précisions dans Caledonian Road. Sur la quatrième de couverture de l’édition française, parue aux éditions Métailié, le roman nous est d’ailleurs présenté comme une « nouvelle Comédie humaine » – rien que ça !
L’une des rares choses que j’ai apprises, commença-t-il, c’est que la délinquance causée par l’opulence est de loin la pire. À l’école, on nous a appris que c’était la pauvreté qui était responsable de la délinquance, mais en fait ce n’est pas la personne qui vole une demie bouteille de vodka chez Tesco qui détruit la société, c’est sont ces riches qui consacrent leur vie à l’évasion fiscale.
En inscrivant ce texte dans la lignée de Balzac, l’éditeur place donc la barre très haut. Mais Andrew O’Hagan peut-il véritablement rivaliser avec une figure aussi marquante de la littérature ? Son ambition, en tout cas, est similaire : il s’agit ici d’écrire un grand roman social, reflétant aussi bien les élites que les plus précaires. Les personnages, dès lors, sont nombreux, mais il faut bien cela pour représenter sans trahir cette ville aux mille visages. Et si le lecteur vient à se perdre, il peut toujours consulter l’index des noms, placé en début d’ouvrage. Cela dit, un tel parti pris n’est pas sans risque sur le plan narratif. Mettre en récit le collectif, n’est-ce pas forcément négliger l’individualité, inhérente à la fiction, et renoncer en partie à sa dimension romanesque ?
S’il n’évite pas toujours cet écueil, Andrew O’Hagan parvient heureusement à sauver les meubles grâce à son personnage principal, Campbell Flynn, un historien en pleine crise de la cinquantaine. Transfuge de classe à la croisée des routes entre bourgeoisie, noblesse et classe ouvrière, il personnifie cette fracture sociale qui divise les rues de Londres, tout en illustrant une fracture générationnelle : celle qui le sépare de ses étudiants et de ses propres enfants. Qui plus est, il fait figure de conteur, et tout au long du livre, analyse le monde qui l’entoure comme s’il s’agissait d’une toile de maître. Ce faisant, il réalise peu à peu que l’image qu’il avait jusqu’alors de lui-même est tronquée. Alors qu’il a grandi dans une famille modeste et se revendique progressiste, il comprend qu’il fait partie intégrante d’un système régi par les privilèges. Un système qu’il dénonce avec d’autant plus d’hypocrisie que lui-même en bénéficie, et que tout son entourage est corrompu jusqu’à la moelle. Exploitation de migrants, trafic de drogue, agression sexuelle… ses amis et sa belle-famille se révèlent de véritables enflures, tandis que lui-même se débat avec ses propres contradictions, en vain. Et s’il est parfois agaçant, voire ridicule, il n’est reste pas moins attachant.
Résultat : là où beaucoup de personnages sont à peine esquissés (voire sous-exploités), lui se détache de la masse. Non seulement parce qu’il donne au roman une structure, mais aussi parce que ses incohérences, ses failles et ses incertitudes le rendent profondément humain. Bien sûr, c’est aussi ce qui le rend difficile à suivre. On se perd par moments dans ses cogitations et ses remises en question sans fin, mais au bout de ces quelque 647 pages, on se réjouit d’avoir passé tout ce temps en sa compagnie. Même si ce n’est pas une lecture évidente, c’est un roman qui ose voir les choses en grand, et je ne saurais que trop le souligner. Quant au style, il reste abordable. Si certains dialogues sont cryptiques, le vocabulaire n’est jamais inutilement complexe, et la longueur des phrases est tout à fait raisonnable. On notera, de plus, l’ironie mordante dont est empreinte la narration – un soupçon d’humour anglais tout à fait bienvenu, étant donné le sérieux des thématiques abordées.
Il aimait prendre des risques, mais il avait visé trop haut avec la salade, et il alla se chercher un petit pain au bacon.
La promesse des éditions Métailié est donc remplie. Sans être un pastiche de Balzac, Caledonian Road se montre à la hauteur de ses ambitions, et renouvelle le genre du roman social, en intégrant à sa « Comédie humaine » des enjeux plus modernes. Des réseaux sociaux au mouvement me too, en passant par le développement personnel, ce roman brosse ainsi un portrait relativement fidèle de son époque, sans s’éparpiller pour autant.
Il témoigne par ailleurs de l’ascension de son auteur sur la scène littéraire anglophone. Plusieurs de ses romans ont en effet reçu de prestigieuses récompenses, dont le Los Angeles Times Book Prize pour Éphémères, son précédent roman paru en 2020. Caledonian Road, quant à lui, s’est vu décerner le Prix Orwell de la fiction politique en 2024, et a été désigné livre de l’année par The New Yorker, The Sunday Times et The Spectator.