Les Larmes de Narcisse de Julie Girard
Un miroir déformant tendu vers les militants woke
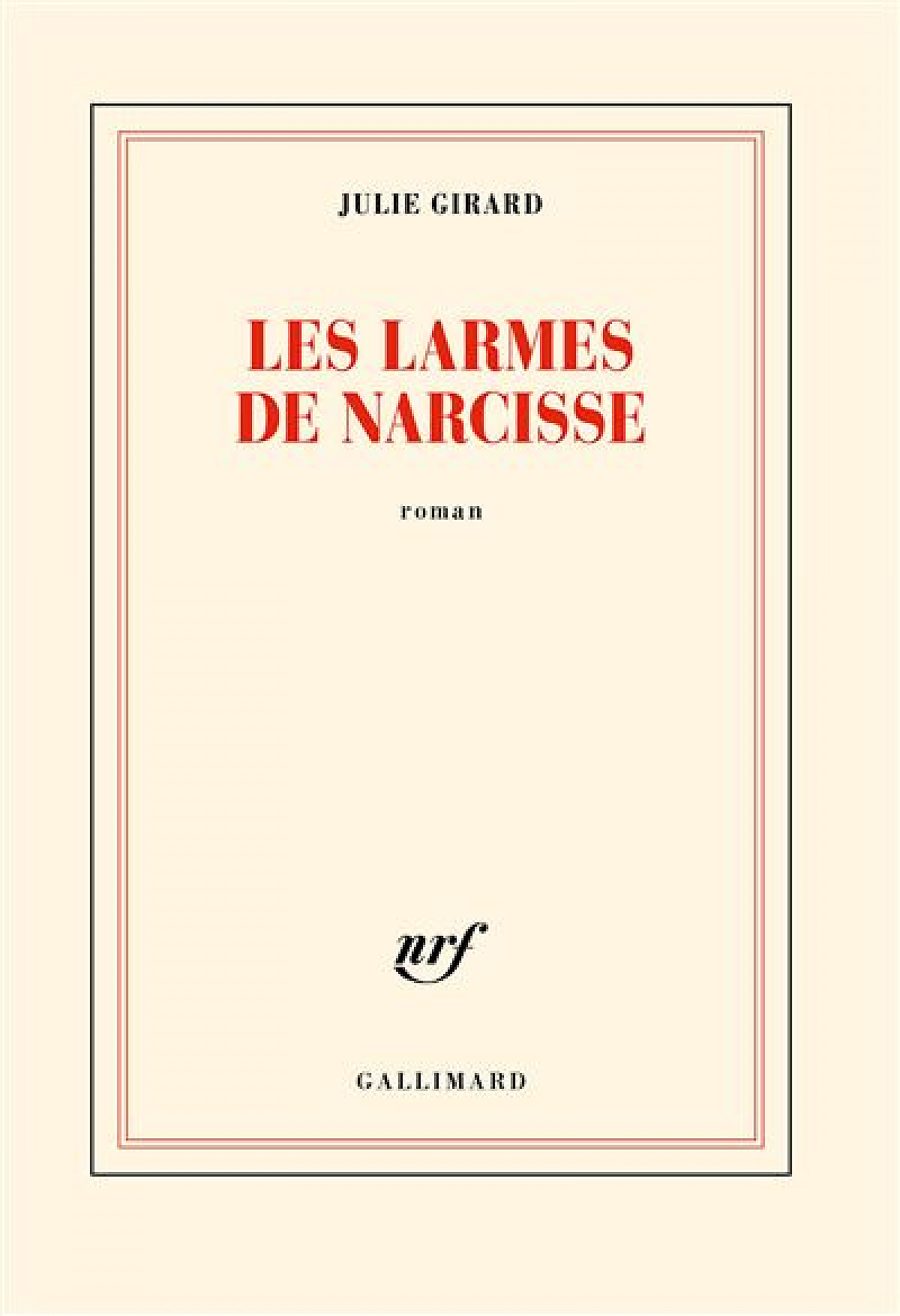
Paru aux éditions Gallimard, Les Larmes de Narcisse dépeint la création par deux amants d’un monde virtuel, présenté comme le dernier bastion de la société face au wokisme et à la cancel culture. Roman ou essai ? La frontière semble plus mince que jamais sous la plume de Julie Girard, autrice et chroniqueuse au Figaro.
Un peu plus d’un an après la parution du Crépuscule des licornes, Julie Girard signe avec Les Larmes de Narcisse son deuxième roman. Le récit d’un amour de jeunesse ravivé à l’aube de la quarantaine, et au-delà de cela, un réquisitoire à charge contre la cancel culture, présentée par l’autrice comme une conséquence malheureuse du wokisme.
« Rien, absolument rien, n’est plus politique qu’une fiction », écrit-elle d’ailleurs. Et de fait : l’intrigue se déroule dans un futur proche, dominé par Respek, un collectif qualifié de woke1 prêt à tout pour museler la parole de ses opposants, quitte à censurer sans vergogne les plus grands auteurs et réalisateurs que la littérature et le cinéma aient jamais connus. Face à cette perspective, deux amants uniront donc leurs forces autour d’un projet commun ; j’ai nommé Lotus Eaters, un monde virtuel proposant à ses adhérents un accès sans restriction aux œuvres « annulées », sacrifiées sur l’autel de la bien-pensance.
Sous couvert de fiction, Julie Girard donne ainsi corps à ses inquiétudes vis-à-vis d’une société en pleine mutation, au sein de laquelle les mentalités ont énormément évolué au cours des dernières années.
Autant le dire tout de suite : ce ne sont pas des opinions auxquelles j’adhère, et ma lecture s’en est fortement ressentie. Moi qui, en parcourant la quatrième de couverture, m’attendais à un récit d’anticipation sur l’omniprésence inquiétante des nouvelles technologies, et notamment le développement récent de la réalité virtuelle, j’ai déchanté dès les premières pages, en découvrant la véritable teneur de la prose de Julie Girard.
Parlons d’abord de Théa, la protagoniste principale de ce roman. Le cliché d’une femme richissime, qui partage son quotidien entre restaurants branchés, voyages à l’étranger et événements mondains. Aveuglée par les ornières de ses privilèges, elle apparaît complètement déconnectée de la réalité, et manque cruellement de nuances s’agissant du wokisme.
Et c’est probablement ce qui m’a le plus dérangée : tout au long des quelque 323 pages de ce roman, l’autrice ne présente qu’un seul point de vue. Celui de Théa, et de tous ceux qui, comme elle, préfèrent tourner le wokisme en ridicule que de lui accorder la moindre légitimité.
Se gardant bien de rappeler les inégalités auxquelles les femmes, homosexuels, transgenres et personnes racisées restent encore aujourd’hui confrontés, l’autrice accumule les exemples visant à démontrer par A + B l’absurdité des revendications de ce mouvement. Entre un présentateur télé viré pour avoir souligné la violence d’un rappeur afro-américain appelant à « pendre les Blancs » et l’accusation diffamatoire d’une influenceuse prétendant avoir été victime d’un « viol virtuel », tout un dispositif semble ainsi mis en place pour que nous ressortions de notre lecture convaincu·es de vivre dans un monde dystopique, pris en étau entre la censure et la bien-pensance.
Mais ces dérives sont-elles véritablement représentatives de ce qu’est, par essence, ce mouvement ? Le wokisme représente-t-il réellement une menace pour la liberté d’expression ?
Au contraire, je crois que la liberté d’expression n’a jamais été aussi puissante, et aussi forte qu’elle ne l’est aujourd’hui. Car là où, pendant des siècles, ce droit était en grande majorité l’apanage des hommes blancs privilégiés, les choses tendent à présent à évoluer, grâce au wokisme justement. Une réalité que certains cercles tentent néanmoins d’enrayer, en représentant certains cas extrêmes comme une généralité, et a contrario en passant sous silence tout ce que la woke culture a pu apporter, en termes de droits et d’égalité.
« On ne peut plus rien dire », disent les uns. Mais qu’en est-il des autres, ceux qui, depuis toujours, se voient imposer le silence par une société raciste, sexiste, homophobe et transphobe ? J’entends que certains craignent la censure, voire une destruction de notre patrimoine littéraire et artistique, entaché par ce passé peu glorieux. Mais est-ce vraiment à l’ordre du jour ?
Au sein des maisons d’édition comme des plateformes de streaming, force est de constater que le cas de Roald Dahl, cité par Julie Girard à plusieurs reprises, reste isolé, et que la tendance, aujourd’hui, semble davantage à la recontextualisation et la lecture critique qu’à la réécriture. (On l’a vu notamment avec la création par HBO Max d’une vidéo d’introduction au film Autant en emporte le vent, et l’ajout par Disney d’un message de sensibilisation au début de La Belle et le Clochard.)
Aussi, je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter outre mesure d’une potentielle censure ou réécriture de nos grands classiques, pourtant présentée à travers ce roman comme une menace imminente, et j’avoue que je suis fatiguée d’assister à la montée de cette vague paranoïaque, omniprésente dans Les Larmes de Narcisse.
On ne peut nier, bien sûr, que Julie Girard manie joliment les mots. Le texte est fluide, parsemé de très beaux effets poétiques, et enrichi de nombreuses références littéraires. Mais malheureusement, en ce qui me concerne, celles-ci n’ont pas eu l’effet escompté. De La Mouette de Tcheckhov, citée à plusieurs reprises, aux Mangeurs de lotus d’Homère, dont il était question plus haut, il m’a semblé que l’autrice cherchait surtout, en étalant ainsi sa culture, à démontrer le bien-fondé de sa pensée.
Si je reconnais les qualités d’autrice de Julie Girard, j’admets donc que je n’ai pas été en mesure de faire abstraction du fond pour apprécier la forme, compte tenu de mes convictions personnelles. Au terme de ma lecture, c’est davantage l’indignation et l’incompréhension qui dominent face à cette représentation caricaturale, et d’après moi trompeuse, de ce qu’est le wokisme.