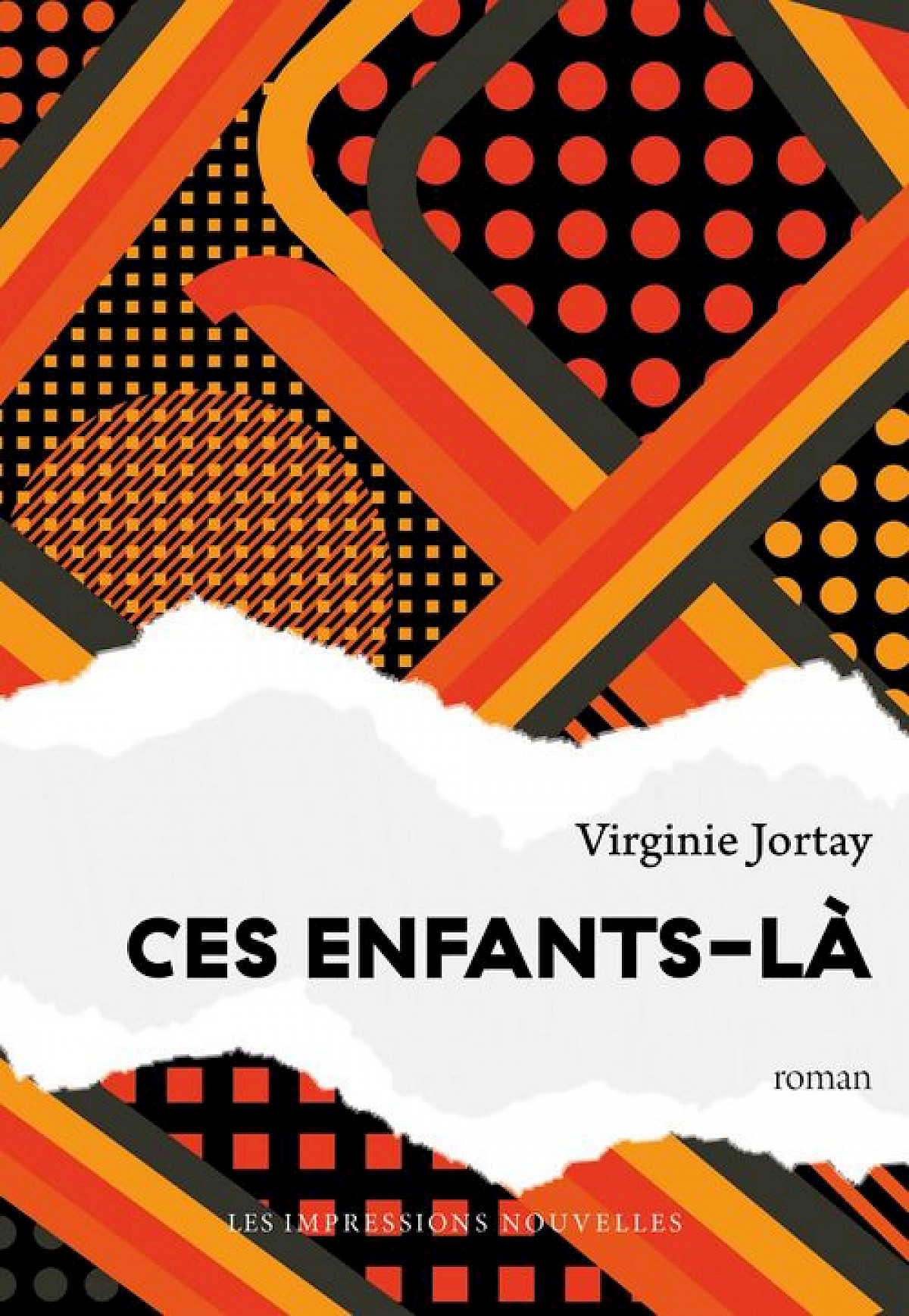
Ces enfants-là , premier roman de la Belge Virginie Jortay, s’inscrit dans la lignée des œuvres qui tente de rendre au réel un passé longtemps enfoui. Loin des planches de théâtre auxquelles elle est habituée, l’auteure nous livre un récit-mémoire engagé, où elle s’attèle à rendre palpables les sensations, à restituer le tout au rien .
De Ces années-là , que reste-t-il ? Maintenant que nécessité s’impose, Virginie Jortay prend la plume et marque la page, tel un couteau marquerait la peau. Née en 1964, elle n’est encore qu’une enfant lorsque les mœurs se libèrent dans les années 60 et 70. Cette libération sexuelle, elle n’en connaît malheureusement qu’un pan; celui d’une enfance et d’une adolescence entachées par le plaisir de cette liberté à sens unique et, pourtant, à double tranchant. Fille d’une célébrité de l’époque, un « grand Monsieur » admiré de tous, la narratrice retrace à travers les pages du récit la relation toxique qui la lie à ce père symboliquement absent et à une mère qu’elle compare, entre autres, à un rémora, sinistre poisson parasite à ventouse. Poussée par « l’urgence artistique d’écrire », elle tente de donner de la profondeur à ce monde d’apparences où tout trouve justification dans la liberté, où la nudité cache les corps meurtris, où les contours des souvenirs sont volontairement floutés.
Récit-mémoire au langage acéré et aux métaphores tranchantes , la force de l’écriture de Virginie Jortay se manifeste à travers les rimes et le rythme psalmodiant de son discours. Telle une prière à un dieu inexistant, intacte et universelle est la rage adolescente de la narratrice du récit. Replongée dans son corps d’enfant, d’adolescente, elle retranscrit à la perfection les sensations occultées pendant de longues années. Aucun dialogue avec les parents n’est révélé sur la page, à la place, à travers un discours indirect libre, la narratrice se replonge dans son « moi » adolescent et reformule les mots glaçants qui lui sont parfois destinés. Elle dira à propos de sa mère :
« Pour elle, son cycle justifie ses états et ses humeurs, le mien doit donc être dompté. Il lui est insupportable que je sois si garçon manqué . Mes hormones doivent être corrigées. [...] Peut-être faut-il songer à m'administrer la pilule? [...] Elle en a parlé avec son docteur, de toute façon, il fera ce qu’elle dira, ce n’est qu’un imbécile qui rêve de la sauter . [...] Et puis ça régulerait ma balance intérieur, ça me reféminiserait .»
Comme pour s’affranchir de cette parentalité toxique, c’est à travers sa plume uniquement que le lecteur découvre le discours parental. Dès lors, seuls les italiques témoignent encore de la difficulté pour la narratrice de s’approprier certains termes. Pour le reste, la mère n’a de voix que celle de sa fille qui, en acceptant ainsi de retranscrire ses paroles, métabolise le discours maternel et la réduit enfin au silence. Ce faisant, elle rend notamment au réel la négation qu’a été son passé.
L’apparente dualité du vrai et du faux est dès lors réévaluée ; réelle est désormais cette négation de tout ce dont elle a été victime dans ce monde d’apparences. Elle dira au cours de son récit que « c’est un non-lieu entouré de non-dits ». En tentant de retracer le fil rouge entre les non-dits et les non-lieux qui ont marqué son existence, l’auteure utilise son écriture pour s’affranchir de son passé et rendre la réalité visible. Et cette visibilité passe également par cet objet de convoitise, ce mystère absolu, ce symbole de liberté qu’est son corps torturé d’adolescente. À la fois nié et objectifié par ces adultes modernes, acteurs de la libération sexuelle, fans de Woody Allen, et ignares de l’ironie, dont ils sont pourtant si friands, c’est en lui donnant les pleins pouvoirs qu’elle parviendra à le rendre réel, à redonner son importance de tout à ce qui a toujours été considéré comme rien . Elle dit en parlant du dessous des apparences :
« Tout ça se passe en souterrain ; aussi impalpables que le sont mes hormones. Même si je sais que tout dysfonctionne, je ne parviens pas à le formuler. Je n’ai que mon corps qui ressent […] Tout ce qui se passe autour est en moi. Cela ne se voit pas donc personne ne le voit ».
Alors, pour que tout le monde le voie, elle se rase les cheveux, se perce une oreille, et dispose de son corps, tentant ainsi de s’en emparer physiquement, de faire en sorte que le rien devienne le tout, qu’esprit et corps ne fassent plus qu’un, de rendre le non-visible visible, surtout à cette mère, jamais nommée.
Toujours présente et absente à la fois, cette mère semble être le début et la fin de chaque chose. Telle une ombre, elle suit et se cache derrière sa fille, tantôt pour lui nuire, tantôt pour rechercher sa protection : mère et fille à la fois. Racine de tous les maux, elle se révélera pourtant elle aussi victime de ces années « de légèreté ». Si elle est un produit de son époque, il est cependant difficile pour le lecteur d’accueillir une quelconque compassion à son égard. C’est par ailleurs dans cet élément du récit que la force de l’auteure se révèle et atteint son paroxysme. En cassant la fragile image du monde parfait mise sur pieds par ses parents – et par son époque –, Virginie Jortay nous rappelle que le corps des enfants, soumis à ses propres lois, ne peut appartenir à un temps. De cette innocence sacrifiée naît un récit violent, marqué par l’antagonisme et l’engagement. Livre-modèle, et véritable lettre à ces corps soi-disants libérés , son récit donne le courage de la parole et invite à prendre de la distance, pour que ces adultes-là restent loin de là où le tout a recouvré son sens.