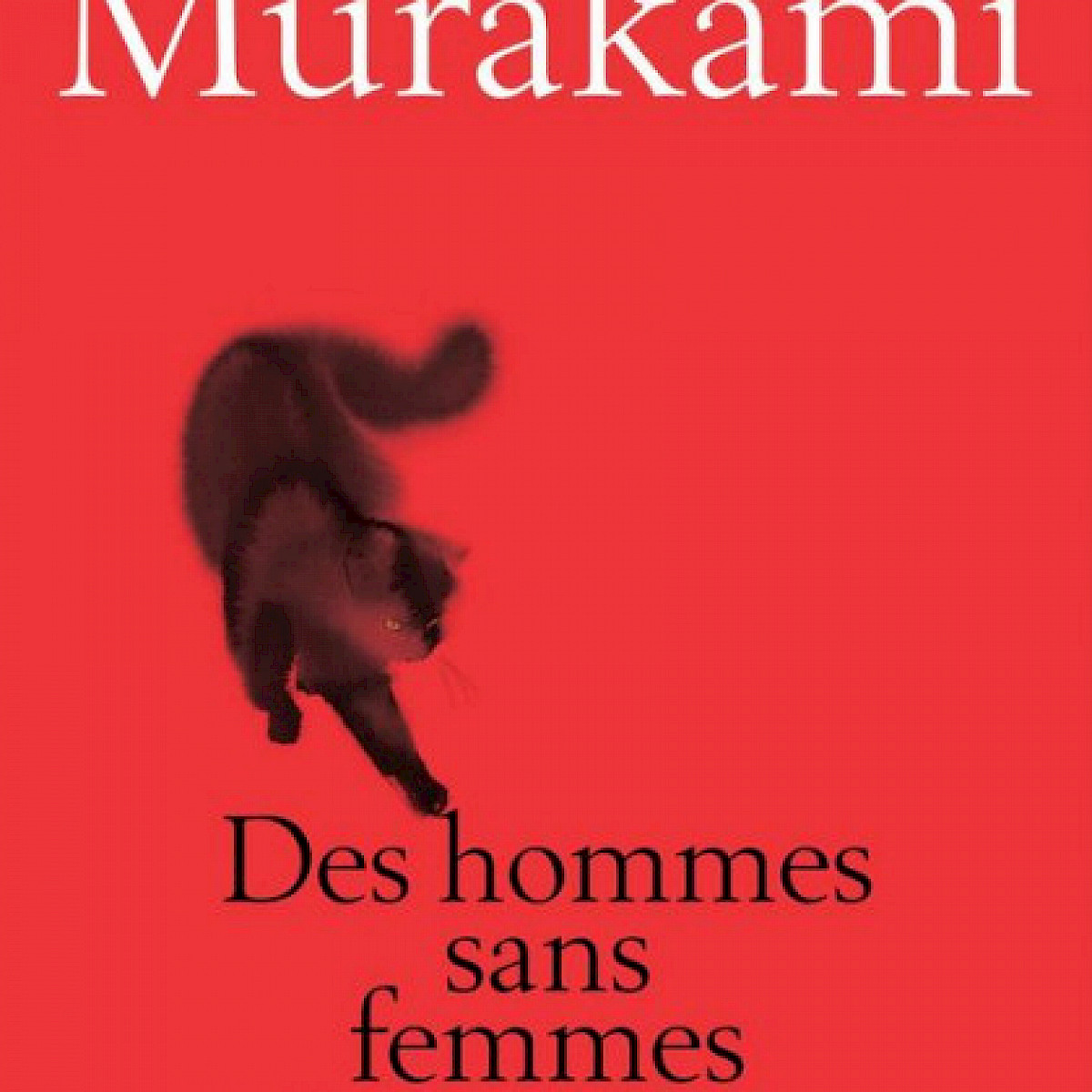
Un moment de pur bonheur construit autour du manque : voilà ce que nous offre (dans une belle traduction d’Hélène Morita) Haruki Murakami avec ce recueil de sept nouvelles plus ensorcelantes l’une que l’autre, dans un crescendo où l’atmosphère se nimbe toujours de mystère, même dans ses moments les plus quotidiens. Le mystère poétique de l’existence.
Il est très facile de devenir des hommes sans femmes. On a juste besoin d’aimer profondément une femme et que celle-ci disparaisse ensuite.
Au fil des sept nouvelles, Haruki Murakami met en scène des hommes qui ont passionnément aimé, parfois de façon chimérique, et que l’absence définitive de la femme adorée, quelle qu’en soit la cause, a plongé dans un isolement irréversible.
Sept situations bien distinctes, mais une même mélancolie à fleur de page, exprimée dans une langue sans aspérités, dont les formules pénètrent imperceptiblement le lecteur et continuent à flotter en lui, comme le souvenir de ces femmes hantent ces hommes désormais échoués sur les rivages désolés du présent.
Les deux premières nouvelles ont pour titres ceux de deux chansons des Beatles. Dès la première, Drive My Car , le charme s’installe : un acteur veuf déchu de son permis de conduire engage comme chauffeur une jeune femme à laquelle il finira insensiblement par se confier au fil des courses tranquilles de la Saab jaune. Des dialogues légers comme ceux des films de Rohmer, plus profonds encore. Il aimait sa femme, il savait qu’elle le trompait parfois. La retrouver est impossible, sinon fugacement, comme lors de conversations amicales avec l’un de ses anciens amants. Une résurgence tactile lorsqu’il regarde la paume de sa main, qui semble garder la trace des caresses anciennes. Pourquoi le trompait-elle ? Pourquoi avec cet homme en particulier ? Le cœur de la femme disparue restera pour toujours incompris. « Comme un petit coffre-fort immergé au fond d’un océan ».
Dans Yesterday , le narrateur se souvient d’un ami connu dans l’adolescence qui lui avait demandé de sortir avec sa petite amie. De cet étrange marché, il lui reste le souvenir d’une fille trop belle, qu’il retrouvera bien plus tard. Comme dans les nouvelles d’Hemingway (auxquelles Murakami emprunte le titre de son recueil) ou plus encore dans celles de J.D. Salinger, une atmosphère se crée et chaque description, vague ou minutieuse, contribue à en diffuser l’entêtant parfum, comme celui de moments de grâce, d’autant plus précieux qu’ils sont impromptus, inexpliqués. Des sensations qui peuvent réapparaître après des années, au gré d’une musique entendue ou d’une question posée et jamais résolue.
L’impossible équation entre amour charnel et amour sublimé est au creux de cette nouvelle et de la suivante, qui voit un séducteur collectionner les aventures tranquilles avant de tomber à son tour dans le piège de l’amour fou, celui dont on ne sort jamais. Non sans avoir découvert auparavant que les femmes sont dotées d’un « organe indépendant » qu’on ne dévoilera pas ici.

Les personnages de Murakami, hommes ou femmes, évoluent sur une ligne de flottaison où rêve et réalité semblent interdépendants et au gré des récits, l’atmosphère se fait plus onirique, impression paradoxalement renforcée par la minutie de l’auteur. Rien chez lui n’est vraiment anodin, le style est précis et original, l’humour sous-jacent, même dans la simple description d’un plafond :
Le plafond était parfaitement ordinaire, de ceux qu’on peut voir n’importe où. Il avait dû autrefois être peint en blanc, ou bien en une teinte crème très pâle. Mais des années de poussière et de saleté lui avaient donné une nuance qui évoquait le lait tourné. C’était un plafond sans aucun ornement, sans aucune caractéristique particulière. Il ne prodiguait aucune revendication, aucun message. Il remplissait parfaitement sa fonction structurelle et n’aspirait à rien d’autre.
Ce plafond, c’est celui qu’aperçoit Gregor Samsa, dans une nouvelle qui propose une inversion de La métamorphose : c’est l’insecte qui se réveille homme, dans un corps nouveau où subsistent d’anciens réflexes, et c’est toute notre apparence humaine qui se révèle alors dans son incongruité. Samsa amoureux baigne dans une atmosphère drolatique où le désir va surgir de façon cocasse et triviale, sur fond d’événements inquiétants. Rien n’est incompatible chez Murakami.
Les rêveries peuvent être le souvenir de vies antérieures, comme dans Shéhérazade où une jeune mère de famille se rend chez le narrateur non seulement pour faire l’amour mais aussi pour lui raconter de fascinantes histoires. Se souvenant entre autre d’avoir été lamproie dans une autre vie, elle lui répond, lorsque il lui demande à quoi elle pensait alors : « Les lamproies ont des pensées-lamproies. Sur des sujets-lamproies, dans un contexte-lamproie. Je serais incapable de te traduire tout cela avec nos mots à nous. » Chez Murakami, l’incommunicabilité est partout. Cela n’empêchera pas Shéhérazade de raconter à son interlocuteur subjugué comment, adolescente, elle s’introduisait dans la maison d’un garçon de sa classe en son absence, pour se coucher dans son lit et s’enivrer de l’odeur de ses affaires, du contact de ses objets familiers. Itinéraire d’une « voleuse d’amour » qui un jour désertera le narrateur.
Voilà au fond ce que signifiait perdre une femme. Les femmes vous dispensaient des moments très particuliers, durant lesquels vous étiez plongé en pleine réalité alors qu’en même temps cette réalité était annulée.
A-t-on jamais mieux tenté de dire l’indicible ?
Le bar de Kino est un lieu où l’on croise des clients tranquilles, emmurés dans leur solitude. Dont une femme énigmatique qui lui fait découvrir de petites brûlures de cigarette sur sa peau : « Sous le soutien-gorge blanc, il y avait de toutes petites marques. D’une teinte qui rappelait celle du charbon de bois pâli. » Le bar sera bientôt cerné d’étranges serpents, annonciateurs ambivalents d’un futur incertain.
La dernière nouvelle, la plus brève, est peut-être la plus belle. En pleine nuit, un homme reçoit un coup de téléphone lui annonçant le suicide d’une femme qu’il a connue autrefois. L’appelant est le mari, qui raccroche, laissant son interlocuteur dans l’impossibilité de le recontacter et en proie à une foule d’interrogations. Mais même si les deux hommes ne se parleront plus jamais, un étrange fil invisible s’est tissé entre eux et le narrateur va se remémorer la disparue tout en se perdant en conjectures quant à son suicide. Une femme à l’intérieur de laquelle vivait également une petite fille de 14 ans. Une femme qui lui avait fait un éloge convaincant de la « musique d’ascenseur », lui expliquant que c’est « une question d’espace » :
… quand j’écoute ces musiques, j’ai l’impression de me trouver dans un espace immense et vide. Il s’étend à l’infini et il n’y a pas de cloisons. (…) Et là, je n’ai pas besoin de penser, pas besoin de parler, pas besoin d’agir. Juste d’être là. Juste de fermer les yeux et de m’abandonner à la beauté du son des cordes.
Et l’on se met à avoir envie d’entendre A Summer Place de Percy Faith, White Lovers de Francis Lai ou Lujong d’Henry Mancini.
Dès qu’on a perdu une femme, les couleurs de la solitude vous envahissent, nous dit Murakami. Perdre une femme, c’est être différent pour toujours, c’est perdre un monde où les sensations et les gestes les plus quotidiens avaient du sens, et ne plus pouvoir percevoir les choses, les couleurs et les sons, sinon de façon irrémédiablement différente. C’est avoir dans le cœur une petite tache indélébile qui pâlira mais nous accompagnera toujours.
Plus rien à faire, sinon déambuler tranquille et s’arrêter au cours d’une promenade dans un parc, pour méditer sur la solitude devant une statue de licorne, en contemplant un jet d’eau glacée.