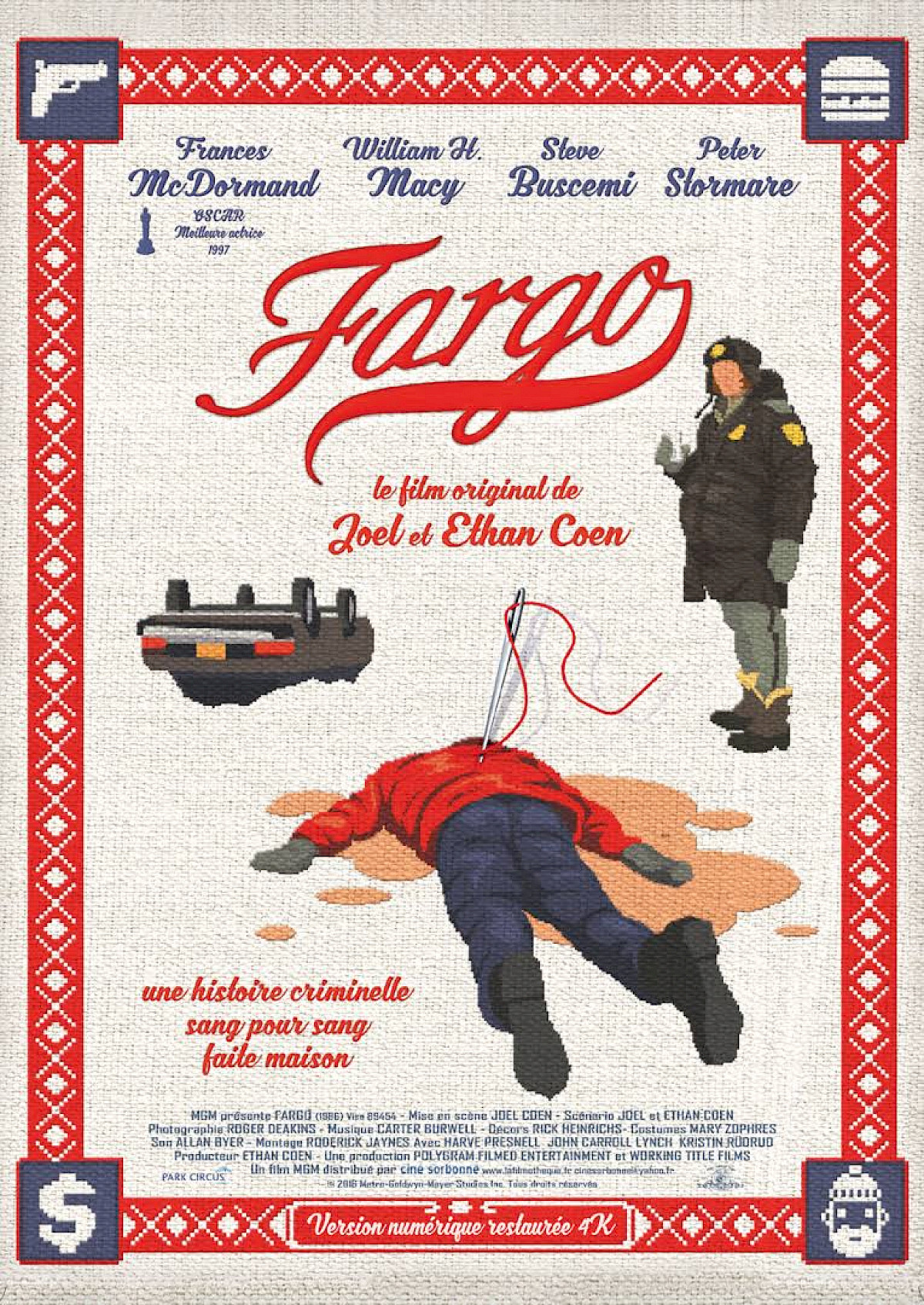
Pour leur sixième film, les frères Coen ont renoué avec les codes du cinéma de genre de manière détournée et indirecte. Fargo est un film profondément marqué par l’histoire du cinéma et de la littérature, un film que l’on peut qualifier de néo-noir, post-maniériste, absurde, avec des références aux westerns, un film que l’on se passe en douce, sous le manteau, mais profondément contestataire et résistant.
Trop de lumière nuit à la clarté, et l’on s’égare volontiers une fois que l’on ne trouve plus rien à quoi se harponner, car au blanc enneigé des vastes plaines du Minnesota, se superpose l’écran cinématographique. Le ciel et la terre se rejoignent, comme un monde déserté de sens.
Fargo s’ouvre sur l’absolu et le vide, le trop vide, bientôt brisé par les trajectoires des personnages et le pacte meurtrier qui les réunit, dans une mise en scène abstraite dont les tonalités d’un blanc aveuglant participent à esthétiser l’absurde et la comédie sombre omniprésente. Et ce même blanc aveuglant, celui des mêmes espaces infinis, n’est pas sans rappeler le blanc de l’enfermement dans lequel les personnages sont les prisonniers de l’immense. Fargo c’est l’histoire de la lutte contre l’oubli et un regard cynique sur la médiocrité du monde.

Jerry Lundegaard est un père de famille endetté qui engage deux malfrats stupides pour kidnapper sa femme, dans l’espoir de faire raquer par le biais d’une rançon son beau-papa détesté et détestable. Arrive dès lors une figure féminine, une mère et enquêtrice venant ajouter au récit une touche de mélodrame et permettant la confrontation de valeurs, entre un monde violent, d’hommes avides, et un monde familial. Au fil du récit, l’écart entre les valeurs portées par l’enquêtrice et les hommes qui entourent Jerry devient abyssal et pousse dans une position tragique et insoutenable, un déchirement sans retour. Comme c’est le cas dans beaucoup de scénarios qui jouent aux confluents des genres et qui embrassent une telle dramaturgie, les choses tournent rapidement au vinaigre, les remords et les corps commencent à s’énumérer.

Ce qui caractérise Fargo , c’est sans aucun doute la dichotomie entre ce qui est montré et ce qui se dessine en filigrane, dans un mélange des genres. En effet, les frères Coen déplacent le traditionnel dédale urbain des films noirs en campagne américaine, permettant aussi de déplacer le point de vue, ce précieux parallaxe sur une Amérique de la marge, un point de vue de sirius sur ce qui fait la banalité du quotidien : la bouffe, les loosers, les supermarchés, les laissés pour compte de l’Amérique profonde. En ce sens, les réalisateurs leur prêtent des mots vides de toutes complexité langagière. Un langage pauvre, vulnérable et rustique, violent et simple, qui ne fait pas avancer les relations entre les personnages et qui d’emblée semble être le symptôme récurrent d’un vide existentiel beaucoup plus grand, vide qui accompagne chaque personnage dans une quête a priori guidée par des actions absurdes : des personnages qui ne se projettent plus en tant qu’êtres, victimes d’un malaise produit par la société. Et, lorsqu’ils ne parlent pas, le silence fait écho et résonne dans l’étendue des grands espaces du Midwest à Fargo, rappelant les dialogues brefs et les face-à-face des westerns. Cependant, il ne s’agit ni de citation, ni même de convoquer explicitement les références du westerns ou du film noir, mais de les détourner pour provoquer l’humour et un regard sur les formes et figures du monde postmoderne. Les personnages incarnent le vide du rêve américain et sont incapables de réussir à composer avec eux-mêmes, avec ce qu’ils sont, détruits et voués à errer dans l’entre-deux, entre ce qu’ils sont et aimeraient être, interstice propre. C’est là que s’immisce le véritable thème de Fargo : accepter l’absurde de la vie et . Les frères Coen poussent la réflexion jusqu´à permettre un certains déterminisme pour Jerry, qui persiste dans le mal. Il est le personnage qui interprète cette crise du « je », une crise avant tout existentielle et émotionnelle du mal-être, dans laquelle il est confiné à être dans la représentation de soi, de faire semblant, d’être pris pour un « crétin ». Tous sont dominés et manipulés par l’espace et le monde qui les entoure.

Ainsi, au détour d’un plan, presque comme dans la vie, il nous reste l’absurde comme seul allié et le rire comme politesse du désespoir. In fine , la question revient à celle du sens, celle des choses et de leurs causalités, de la contingence et de la nécessité. Cet absurde c’est celui que l’on retrouve dans Le procès de Kafka, dans la poésie et la littérature dadaïste. Il est également utilisé dans Fargo comme pur canon esthétique. Mais les frères Coen parviennent à le mobiliser dans les interstices, dans les temps faibles du récit et en font ce que Deleuze nomme « l’absurde par son excès même », qui connecte des sens objectivement incompatibles. Le film apparaît et commence comme un banal film policier, une forme de grotesque et tragique canular sur un habitant médiocre, père de famille détesté. Or, le génie du film c´est précisément de prolonger une réflexion philosophique sur l’absence de sens, un signifiant dans nos actions qui serait dépourvu, privé de la possibilité de produire de la signification. De cette manière, les différents personnages persévèrent au lieu de résister, comme déterminés. Ils persistent comme Sisyphe. C’est à travers ces personnages que les réalisateurs font émerger les contradictions absurdes de la culture contemporaine, pour démonter la vision mythologique du rêve américain dans un film de reconquête.