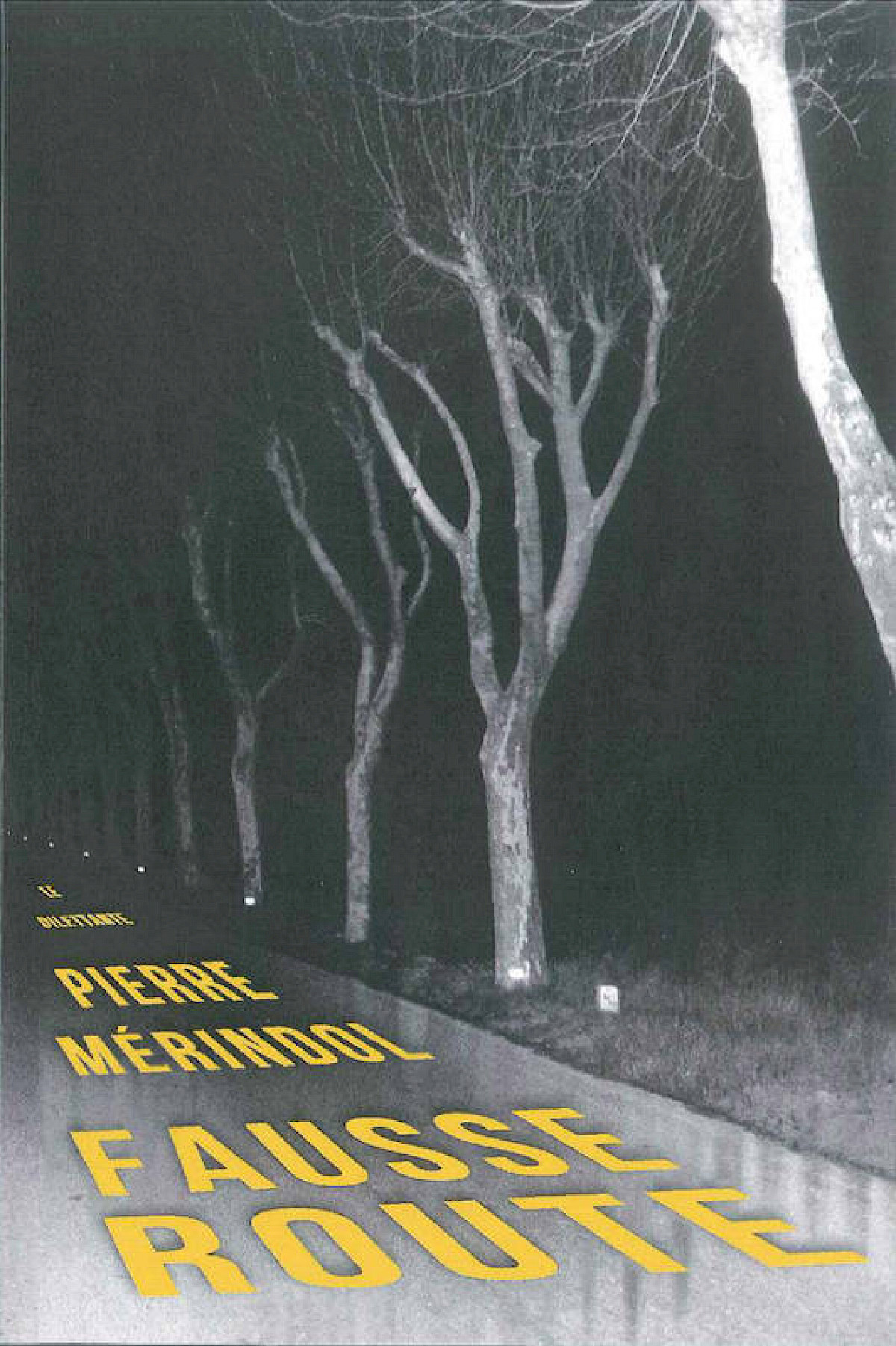
La frustration est peut-être le sentiment le plus fort que m’a laissé Fausse route de Pierre Mérindol. Le sentiment d’être sur le point de dénicher une pépite méconnue, oubliée dans les tiroirs. Sauf que je suis resté sur ma faim ; une ambiance brumeuse, presque malsaine mais une histoire plate, fantomatique qui laisse le spectateur au bord de la route.
Le seul roman de Pierre Mérindol, alias Gaston Didier, se lit à toute vitesse, comme une voiture qui traverse l’autoroute. Les éditions Le Dilettante ont eu la bonne idée de ressortir du placard cette histoire des « années 50 » qui échappe au Nouveau roman et donne une écriture de l’époque singulière passée sous silence.
Qu’on se le dise, la couverture reprenant les codes du texte déroulant est horrible, comme un mauvais remake de Star Wars . C’est malheureusement toute la patte graphique de cette maison qui est à revoir et contraste avec la qualité des livres proposés. Passé cette faute de goût, on se laisse porter par une prose qui jongle entre la poésie et le roman de gare, facile à lire sans pour autant être dénué de descriptions efficaces.
Pierre Mérindol, journaliste de profession, développe une intrigue vieille comme le monde, celle de deux hommes qui flirtent avec une seule femme. Le narrateur nous embarque dans son vieux camion à légumes, entre villes et villages. Lyon, Paris, Saint-Étienne ou encore Valence, un trajet qui dresse un portrait de la campagne française d’après-guerre. On voit défiler les routes de nuit avec une sensation de malaise. On y perçoit le mal-être, l’absurdité d’une population qui digère la défaite et les camps de concentration.
Dans ce conte, le narrateur rencontre des personnages aussi perdus que lui : Edouard qui fascine ou nous énerve par sa brutalité, Françoise se laissant porter au gré des bars et Jules, un jeune qui porte le poids de la jeunesse sur ses épaules fragiles. Une poésie du banal, que l’on regarde dans le rétroviseur. Une traversée en surface témoignant d’une certaine ambiance. Plus proche de la fascination que de l’ennui. L’histoire plaît dans ses imperfections, il laisse tomber les lieux communs de la littérature, un fond de roman noir sans meurtre, sans violence ni sexe (ou presque).
La force est bien sa nostalgie, une écriture à l’ancienne qui nous fait regretter les vieux bistrots-PMU, leur odeur de tabac et de Ricard chaud. Les métaphores témoignent de cette atmosphère particulière :
« C’est de débarquer à Paris par un matin d’hiver avec la neige sale qui traîne le long des murs comme une mousse de bière au fond d’un demi oublié. »
La route et la nuit forment un décor de théâtre :
« Nous avions dépassé Montélimar vers une heure du matin, dont le seul souvenir de ville morte reste comme un assemblage concerté de jeu de cubes multicolores. »
Pierre Mérindol impose des images, des goûts et des odeurs avec simplicité :
« Une nuit d’été à Paris où les légumes sentent fort sur les pavés des Halles, l’huile lourde et les endives amères. »
Ce roman de jeunesse, grâce à son ambiance, conserve son intérêt – si l’on ne prend pas en compte un personnage féminin qui peut paraître soit effacé, soit manipulateur, propre à la France de l’époque alors plus misogyne, et si l’on passe au-dessus de termes (heureusement rares) comme « bicot ». L’histoire est invisible, un prétexte même puisque nous suivons simplement le narrateur sur la route, mais l’écriture ne laisse pas indifférente ; on regrette l’absence d’autres romans de Mérindol qui aurait développé une intrigue plus intéressante, en gardant ce style brut et efficace.