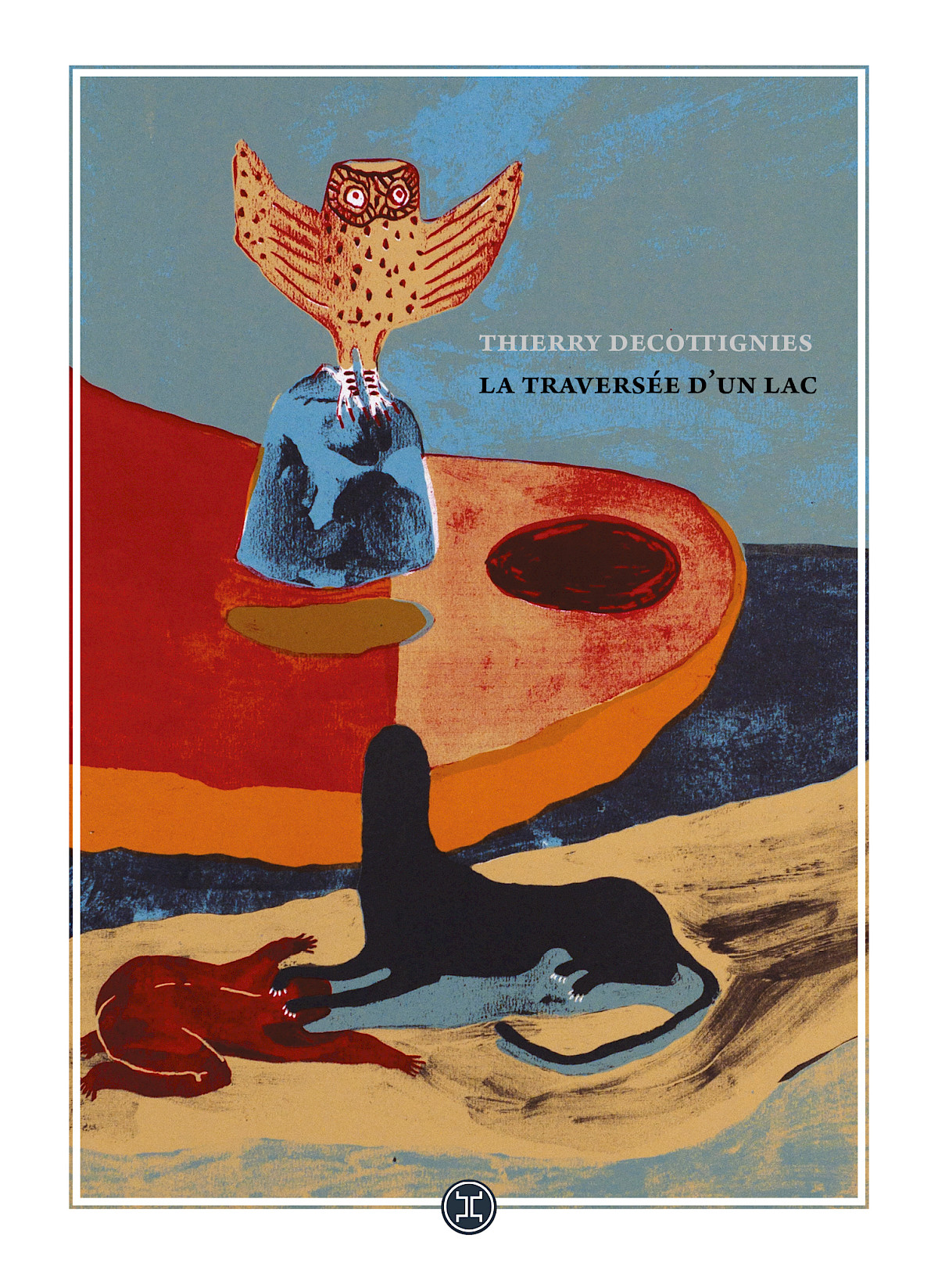
Récit bref et halluciné, la Traversée d’un lac de Thierry Decottignies, récemment publié aux éditions du Tripode, dont il est un habitué, nous plonge dans une odyssée inconfortable et sans retour.
Il voulait très probablement se débarrasser de son angoisse qui devait être intolérable mais ça ne marchait pas, visiblement ça ne marchait pas, ça ne pouvait pas marcher, ça ne marche jamais. À la rigueur faudrait-il mordre à la source, me disais-je, à la source de l’angoisse, mais bien sûr, c’est un peu compliqué.
Avez-vous parfois la sensation que toute votre vie se délite ? Que le monde se désagrège ? Une inquiétante étrangeté vient-elle par moments vous nouer l’estomac ?
La Traversée d’un lac , dernier livre du poète, romancier et traducteur Thierry Decottignies , tâtonne sur la très mince ligne qui sépare le rêve du cauchemar. Je lis ce texte étrange dans mon lit, espace idéal entre l’éveil et le sommeil, le vertical et l’horizontal, la vie et la mort ‒ ne meurt-on pas un tout petit peu aussitôt qu’on ferme les yeux ? Je sens que, si j’arrive à m’endormir, ses songes se mêleront aux miens. Et je craindrai, au réveil, de ne plus savoir distinguer rêverie et réalité.
La Traversée d’un lac est une prose de l’intermédiaire, un art poétique des interstices. Chaque nouvelle page semble nous confirmer que nous suivons la progression onirique du personnage principal : possibilité de se déplacer dans un espace tout en restant au même endroit, personnes familières qui surgissent de nulle part comme si de rien n’était, figure du double (le narrateur s’observe de l’extérieur). Comme dans un rêve, des éléments de sa vie personnelle se mélangent et reviennent sous des formes différentes, tantôt rassurantes, tantôt effrayantes, avant de s’annuler les unes après les autres ; une amie, qu’on croyait noyée, est en fait bien vivante, puis de nouveau possiblement absente, se révèle finalement être sa fiancée décédée, etc.
L’histoire commence par un tremblement de terre dont on se demande tout au fil de la lecture s’il est réel ou métaphorique, à cause de cette sensation prégnante d’un drame originel, d’un événement indicible, imprécis, dont on ne sait s’il est intime ou collectif, mais qui donne toute son atmosphère post-apocalyptique au récit :
Je tenais encore ferme, comme lors d’un tremblement de terre, absurdement, on se retient au premier objet venu alors que tous les objets, bien sûr, sont sur le point de s’effondrer, puisque c’est le monde entier qui s’écroule.
Ce n’est pas tant le monde que la perception qui tremble. Autour du personnage gravitent des motifs précis (chiens, hommes en blanc, alcool, un film vu et revu, le lac), des personnages dont le prénom a été effacé (H,W), une voyante aveugle, autant de symboles ponctuant le rêve, dont le sens n’est qu’éphémère. Tout est narration et interprétation à la fois, sans distinction ; chaque phrase, une clé de lecture possible et impossible à la fois.
Vaclav, le narrateur, rappelle souvent Meursault, le narrateur dans l’Étranger de Camus, ou certains personnages kafkaïen évoluant dans un monde impeccablement fonctionnel mais complètement aliénant. C’est un journal mental, non d’une entrée dans la folie, mais dans un état dans lequel nous pourrions tous·tes nous retrouver un jour, après un événement quelconque, ou sans raison, sans tragédie, comme on entre dans l’eau et se laisse emporter par le courant. Les descriptions des faits sont mécaniques, indifférentes, les personnages alentour sans consistance. Les phrases sont brèves, concentrées sur les enchaînements d’actions ou de pensée, traitées de la même manière, sans que des émotions identifiables ne s’en mêlent. Parfois, cependant, le narrateur se met à courir : c’est comme ça qu’on sait qu’il a peur, ou qu’il cherche à reprendre prise sur le réel. C’est aussi son langage plutôt familier, désinvolte, radicalement sincère, qui le rend consistant ; on imagine aisément sa silhouette en pilier de bar, descendant les whiskys, dans une ambiance de fin du monde.Ce sont aussi des symptômes physiques qui indiquent son aliénation, son allergie à la ville dans laquelle il se promène sans fin : morsure d’un chien, nausées, léthargie…
Tandis que son monde, ou ses mondes, tanguent, Vaclav reste pourtant lucide, précis, presque cohérent, avec parfois des fulgurances : en ce sens la Traversée d’un lac me semble poser à nouveau, et subtilement, cette question éternelle qui consiste à se demander si les fous, les folles, ceux et celles qui abordent les marges mentales de l’existence, ne sont pas les personnes qui voient la réalité, avec la plus grande acuité, dans toute son absurdité ?
La Traversée du lac , c’est la traversée du Styx, à l’envers ou à l’endroit.. Et si vous rêvez d’une nuit paisible, loin du gouffre, n’envisagez pas d’en faire un livre de chevet. Des rappels morbides parsèment tout le roman : père malade, chien enragé, noyades, araignées, souvenirs à enterrer… tout nous ramène à la mort, à sa possibilité, à sa coexistence nonchalante avec la vie.
On lit donc ce roman comme on pense à la fin : avec inconfort, en croyant lâcher prise, sans savoir où l’on va. Il fourmille de références, ou d’évocations littéraires, mais dans une démarche poétique, et avec une sorte d’abandon, comme s’il n’y avait pas d’issue, de problèmes à régler. Le monde est détraqué, par définition. Sans que la question de l’espoir ne se pose.
Se plonger dans ce livre, donc, c’est traverser un cauchemar duquel jaillissent parfois des fragments de beauté, des images qui persisteront sur la rétine de votre inconscient, sans que vous n’ayez envie de les laisser remonter à la surface. Sans que vous n’osiez tout à fait vous demander… qu’est-ce qui est réel ?