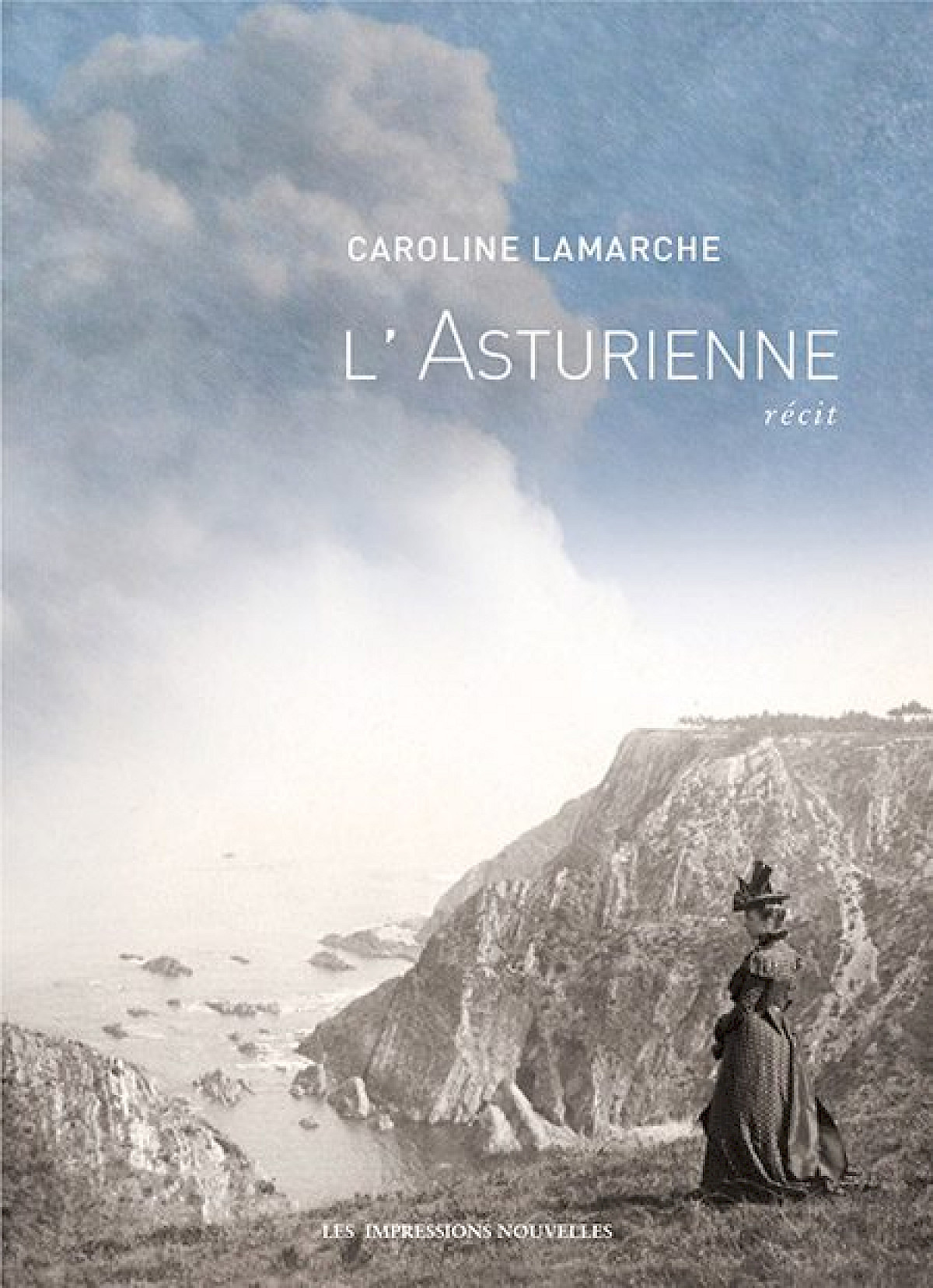
(Re)Connue de Karoo par ses fictions 1 , l’écrivaine Caroline Lamarche signe, avec L’Asturienne , son premier récit documentaire. Au-delà de l’histoire de la compagnie métallurgique éponyme et de la famille Lamarche-Hauzeur, il est question d’une critique subtile des déboires d’un capitalisme industriel inégalitaire et destructeur de la nature.
Caroline Lamarche a eu un jour l’idée d’ouvrir les malles de la cave familiale pour y découvrir un véritable trésor d’archives. La quête de L’Asturienne commence dès lors comme la reconstitution de la saga d’une famille d’abord apparue au début de la révolution industrielle dans la région de Liège avec une houillère2 , et partie ensuite explorer la province des Asturies en Espagne à la recherche de gisements de métaux et d’une mine de charbon quand le pays était indigent et marqué par le banditisme. La compagnie de l’Asturienne naît alors en 1853 suite à la découverte par cet ancêtre de la famille Lamarche-Hauzeur d’une des mines de zinc les plus riches d’Europe.
Ce récit n’aurait néanmoins jamais commencé sans cette fascination qu’éprouve Lamarche pour les archives photographiques et manuscrites de sa famille, lesquelles se complètent mutuellement. Dans son processus de recherche, elle parle d’un « charme de l’énumération » et d’une « délicatesse de l’écriture » qui lui procurent un sentiment ineffable, mélangeant satisfaction et envoûtement, mais aussi « culpabilité et voyeurisme ». À l’ère du clavier et du digital, Lamarche témoigne de manière poétique du pouvoir de la transmission des archives écrites à la main :
« Voilà à quoi je pense en déchiffrant, de plus en plus éprise par nos morts, ce qui, en une seule génération, a disparu de nos vies : l’écriture manuscrite qui est à l’imagination ce que le corps est à l’amour. »

À l’écrit s’adjoint l’oral, caractérisé par les souvenirs de moments plus ou moins agréables partagés avec les membres de sa famille, qui sont répartis dans les nombreuses sections qui constituent les trois parties du livre. Les descriptions de ces réminiscences rapprochent L’Asturienne du mémoire, en fournissant des instantanés d’une génération paternaliste et masculine, sérieuse et sévère. Ainsi, le lecteur ou la lectrice peut lire que Lamarche ne voyait que très peu son père qui était « occupé dans les bureaux », ou que sa « mère [lui] avait un jour confié que son beau-père était un homme sévère qui obligeait son plus jeune fils, enfant, à monter dans sa chambre sans allumer la lumière, pour vaincre sa terreur du noir ».
Ces souvenirs sont aussi teintés d’une riche intertextualité3 qui souligne l’héritage littéraire de l’autrice tout en ajoutant une dimension poétique au documentaire. Par exemple, une des références soutient le sérieux de la famille, tout en indiquant une source biographique possible qui expliquerait la fascination de l’autrice pour le monde animal si caractéristique de sa fiction :
« Les histoires qu’ils [ses parents] nous racontaient étaient celles de la Bible, de J.O. Curwood ou de Jack London, Croc-Blanc , L’Appel de la forêt , Michaël chien de cirque , toutes infiniment plus cruelles que celles qu’on donne à lire aux enfants aujourd’hui. »
Alors qu’une autre souligne l’intelligence de sa mère qui était « capable de résumer Guerre et Paix ou Moby Dick dans les moindres détails » , une remarque appréciée de rééquilibrage entre des ingénieurs masculins et les femmes décrites par ceux-ci, du moins « à l’égard des matières scientifiques », comme des « incorrigible[s] demoiselle[s] ».
Outre ce déséquilibre genré, L’Asturienne décrit un monde en voie de progrès mais en proie aux inégalités sociales. La couleur est à nouveau annoncée à travers l’intertextualité, où dans une comparaison entre À la gloire de la Terre de Pierre Termier et La Situation de la classe ouvrière en Angleterre de de Friedrich Engels, Lamarche écrit :
« Tout en reconnaissant à chacun la capacité de subjuguer le lecteur, on est forcé, entre le lyrique et le sobre, de choisir son camp : exalter la Nature et notre immense dignité ou affronter sa destruction sous l’angle de la détresse humaine. »
Ces tensions sociales hantent le passé et le présent liégeois/asturien en présentant les ouvriers comme les « ennemis de classe » des aisés. Par exemple, Lamarche identifie dans les archives une « distance » entre patrons et travailleurs qui pouvait déjà « signale[r] à elle seule la naissance d’un capitalisme sans visage ». En outre, dans un commentaire plus direct et critique sur la Garde Civile espagnole, elle explique :
« La Garde Civile dépendait de l’armée, elle avait été créée en 1844 pour protéger les grands propriétaires terriens du banditisme et des pillages de la faim. Sa présence sur un site minier ne déroge pas à sa mission : rétablir l’ordre dans les périodes de trouble et faire sentir que l’État soutiendra toujours les patrons, même si les ouvriers ont remplacé les paysans affamés, et les syndicats, les bandits. »
Lamarche s’approprie les « rêves d’autrui », des rêves de révolte des ouvriers face à un paternalisme de plus en plus tentaculaire. Ces rêves prolongent un héritage économique disparu avec la mort de son père, dernier ingénieur des mines de la famille. Quand la dernière « larme de la mine » est coulée, que reste-t-il ? Dans une langue forgée par l’œuvre fictionnelle singulière que nous lui connaissons, Caroline Lamarche empêche, à travers ce récit documentaire minutieux et complexe, l’oxydation et l’oubli d’un passé industriel souvent appelé « glorieux » mais dont les conséquences sociales liment encore notre société.