Mahmoud ou la montée des eaux
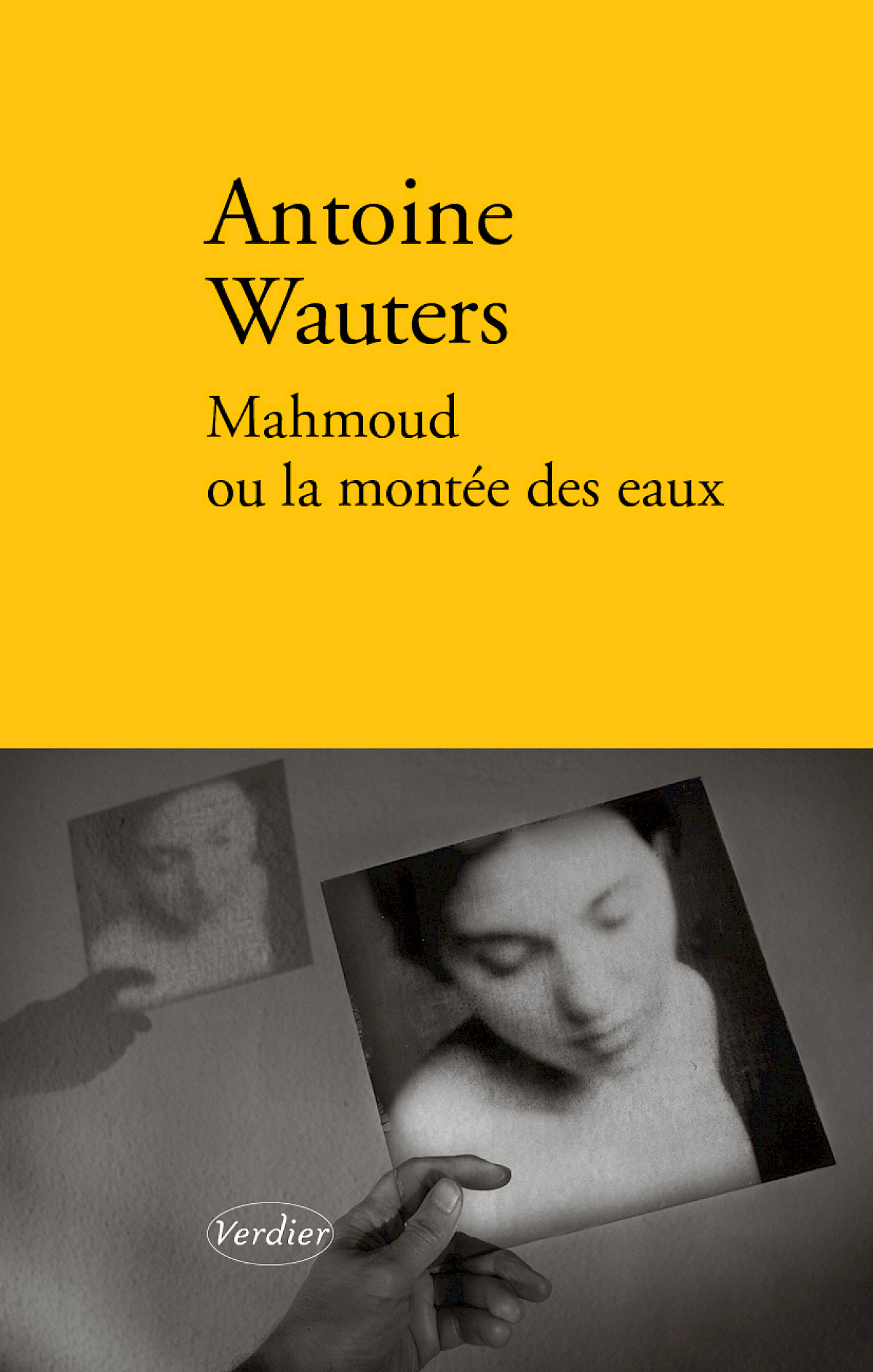
Seule la mémoire peut dompter le vertige. Elle l’enveloppe, elle l’enferme en elle, elle le limite dans le temps et dans l’espace… Elle nous permet de le contrôler, de choisir quand y plonger. Mais seulement, Mahmoud ou la montée des eaux nous montre qu’il faut y plonger pour parvenir à sur-vivre, à vivre au-delà, à être là.
Ces fleurs-là ont été cueillies trop tôt. Leurs jours se sont envolés avec les oiseaux. Un peu de haine et le présent s’enfuit, et le passé tombe dans l’oubli… Mais qui sommes-nous sans mémoire ? Pour supporter de vivre, Mahmoud Elmachi plonge dans ses souvenirs.
Ce printemps-là, tout s’est tu… les rires des enfants, les sourires des passants, l’amour des parents et les poèmes des vivants. La maison, l’école, des villes et des vies entières évanouies, éparpillées par les assauts ou étouffées par les eaux. Il ne reste que les souvenirs et les éclairs réguliers des feux du combat pour délimiter le vide que chacun de nous porte en soi :
« Quand on a perdu un enfant, ou plusieurs enfants,
ou un frère, ou n’importe qui comptant follement
pour nous, alors on ne peut plus avoir un buisson
de lumière dans le cœur. On ne peut plus avoir
qu’un ridicule morceau de joie. Un fétu minuscule. »
Se confronter au vertige, c’est tout ce qu’il reste à faire. Oser se penser, non pour soi, mais aller au-delà de soi. Oublier d’être soi. Se jeter d’une falaise sans se retourner, sans se regarder ; puis écrire, non pas la chute, mais l’importance du mouvement, qui n’en a pas :
« Pour écrire : ressentez à quel point vous n’existez pas,
à quel point vous êtes trouble.
Tout vient de là. »
On voudrait se définir, peut-être, mais, pas plus hier qu’aujourd’hui, on ne sait pas. On part de soi, on revient à soi, peu importe ce qui reste là.
« Vieillir, c’est devenir l’enfant que plus personne ne voit.
L’enfant dont on dit qu’il a les cheveux gris.
Dont on attend des choses, promesses, gloires et
accomplissements, alors que tout ce qu’il souhaite,
c’est rester à jouer avec son bâton en regardant tomber la
pluie, les mains couvertes de boue. »
On est là et on regarde. On regarde l’origine, ou la finalité, mais cela revient au même. Face à la douleur, on ne peut qu’attendre de rejoindre ce qu’on ne voulait pas quitter. Mahmoud Elmachi plonge dans les eaux du lac pour contempler la ville qui renferme son passé. De loin, il les voit. Il pense les entendre aussi. Les ondes des flots lui transmettent les échos des tréfonds :
« Je vais rester ici encore un peu.
Au fond.
À l’origine de tout. »
Si seulement le monde pouvait s’arrêter, ne serait-ce qu’un instant ; si seulement le temps pouvait nous laisser juste un moment nous ancrer…
« Pourquoi les choses bougent-elles toujours ?
Pourquoi le temps bouge-t-il lui aussi ?
Moi, immobile quand tout flanche, je fixe la flèche
de Qal’at Ja’bar. »
Seuls les mots peuvent vaincre le temps, arracher les souvenirs à l’oubli, transformer l’oubli en mémoire. Pourtant, les mots eux aussi sont souvent vides, mais, contrairement à nous, ils peuvent s’ancrer dans ce vide. Ils sont donc peut-être les seuls à pouvoir nous donner la paix :
« Une vie à écrire. Tout ça pour me rendre compte que les
mots ne disent rien, qu’il n’y a rien au fond d’eux, qu’un peu
de silence. Et de paix. »
C’est avec un court poème que se termine Mahmoud ou la montée des eaux . Peut-être qu’en nous aussi il pourra s’ancrer…
« Le ciel n’était pas bleu, mon ange
Nos jours furent bleus. »