Nous deux/Da solo de Nicole Malinconi
Déplier le sujet rouillé
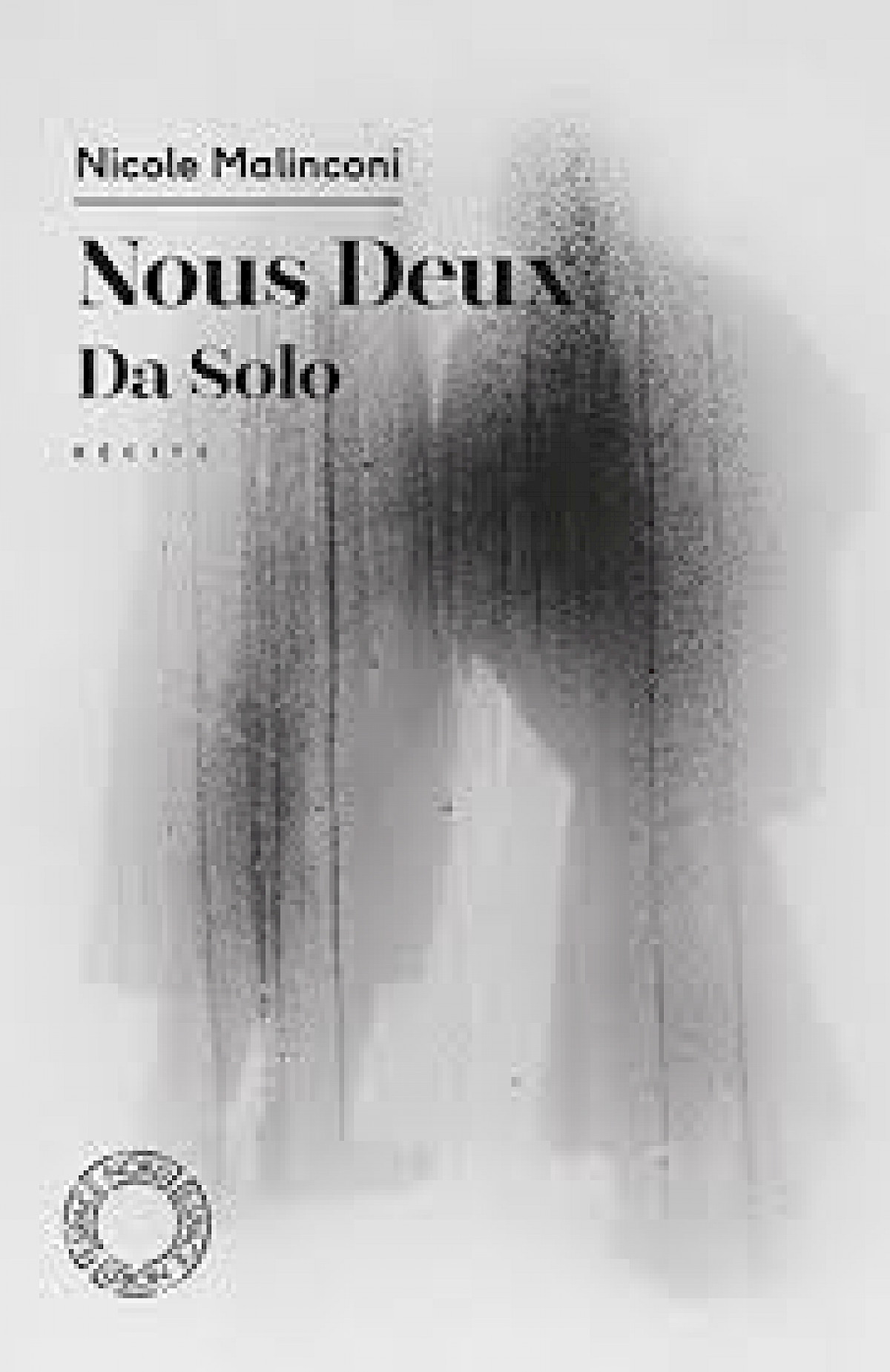
Dans ce diptyque aussi sensible qu’éprouvant, Nicole Malinconi dit le vieillissement du corps face au combat du cœur pour retenir ce qui nous lie aux autres. L’écriture se fait le lieu de rencontre des solitudes que l’on mêle et de celles que l’on garde au creux de la poitrine.
Nous deux/Da solo , récits respectivement parus en 1993 et 1997 (réunis depuis 2002 aux éditions Labor), se sont vus offrir une seconde réédition dans la collection Espace Nord en septembre dernier. L’ouvrage n’a rien perdu de l’acuité et de l’implacable sincérité qui avaient marqué son lectorat à sa parution première – au point de susciter une vive réaction de Marguerite Duras, laquelle écrit, à propos de Nous deux : « […] on peut dire que le livre est admirable. Que son écriture est également admirable. Et que c’est pour cela même qu’elle est intenable, insoutenable ». Cette édition inclut la lettre en question ainsi que le texte de l’adaptation théâtrale de Da solo 1 , enrichissant de ces supports le déjà large panel de façons de dire, réagir, communiquer, qu’offre l’ouvrage.
C’est le récit d’une femme, la mère, puis celui d’un homme, le père. Leur relation longtemps ne tient qu’à l’enfant qu’ils ont en commun et qui se lie de l’une à l’autre, une fois la mort ayant emporté la première. Duo versus solo, « l’homme » du premier récit, que l’on n’entrevoit qu’au travers du regard amer de la mère, est écarté, mis à distance, exclu du « nous ». Il faut l’espace disjoint d’un récit annexe pour que se déploie sa parole, celle d’un père, d’un homme devenu vieux, d’un corps qui peine et craint perdre la tête. Dans ces deux espaces se croisent des absents qui emplissent paradoxalement de leur présence les vies des autres, mêlant distance et proximité, deux états qui se traduisent dans un incessant voyage entre les sujets et entre les temps.
Dans l’un comme l’autre récit, il s’agit de dire la vieillesse qui s’empare du corps. Dire2 et non raconter3 , la nuance est importante. On se situe là dans le « dire » que souligne Duras dans sa lettre à l’autrice : « c’est tellement dit, si complètement dit ». Là où raconter appelle à l’écoute, à la fabrication d’un récit (« faire... »), il y a dans le dire un appel au corps et un appel à l’autre, une intensité toute de spontanéité et d’organicité. C’est cette intensité qui fige les entrailles à la lecture de Nous deux , cette façon qu’a Nicole Malinconi de lier le mot au corps, de ficeler le verbe aux paupières pour ne pas fermer les yeux sur l’ordinaire.
L’avoir et l’être, le devenir
Une collection de propositions, de formulations a priori sans intention, manières de dire le lien plus que grandes déclarations, ouvre Nous deux :
« Heureusement que je t’ai.
Heureusement qu’on s’a.
Si je ne t’avais plus.
Si je ne t’avais pas eue.
Quand je ne t’aurai plus.
Dans la vie, je n’ai que toi.
Quand je t’ai eue.
Quand tu ne m’auras plus.
Si tu ne m’avais pas.
Je n’aurai eu que toi.
Je t’aurai.
Tu m’as eue. »
« Avoir » constitue le socle de chaque phrase, ce verbe qui définit la relation dans laquelle la mère se mure : une possession réciproque et sans concession, de la mère à l’enfant, de l’enfant à la mère – coupées de ce qui n’est pas « nous deux ». Ces murs qu’elle dresse participent à la construction d’une relation-maison, la mère s’entêtant à pérenniser le lien organique tissé dans le ventre : le premier foyer de l’enfant transfère ses qualités à la maison qui, elle-même, devient « un ventre ». Et d’avoir prêté son organicité à la relation, à la maison, il semblerait que la mère en ait privé sa chair : progressivement, le corps se délite, flanche, fatigue. La naissance constitue la césure, l’évènement charnière à partir duquel identifier un avant et un après, entre lesquels voyage constamment le récit.
Nicole Malinconi inscrit au cœur même de la narration l’étiolement de la chair, qui n’est autre qu’une constante confrontation entre un état passé et un état présent, entre un corps dysfonctionnel et un corps vigoureux dont le souvenir revient au visage comme un boomerang, en entremêlant étroitement passé et présent. Ainsi, le récit, porté par la voix de la fille, louvoie entre distance et proximité, empruntant tantôt l’imparfait pour les souvenirs à deux, tantôt le présent pour ceux de la mère – elle qui, seule, est toujours au présent :
« La cigarette est pendue au coin des lèvres de ma mère, au visage de ma mère penché sur le tissu.
Depuis l’enfant, elle ne reconnaît plus l’homme. Je veux dire plus rien de lui qui lui soit reconnaissable, comme au début, quand ils avaient mis ensemble leurs deux misères et ça leur était une consolation. »
Le discours de la mère, rapporté, est forcément au présent lui aussi, qu’importe si « elle dit : » ou si « elle disait : » (« Elle disait : Je pourris »). Là même où la grammaire demanderait un imparfait, le verbe de Malinconi adopte le présent :
« Elle trouvait que l’intérieur des figues est dégoûtant ; ne comprenait pas comment tu peux avaler ça. »
Il se trouve que les évènements qui précédent le temps de l’ avoir , celui à deux, ce « temps du ventre »4 prolongé jusqu’au dehors, sont conjugués au même temps que ceux de la vieillesse : pour la revoir vaillante et vive, mouvante jusqu’à nier la fixité des photographies, afin de contrer l’immobilité à laquelle la vieillesse et la maladie la contraignent, il faut dire les souvenirs au présent. Pour insuffler du vivant au quotidien sclérosé, il n’y a de passé que celui de l’enfant. On se situe dans l’instantanéité du dire , dans son organicité, dans son appel à l’autre. Alors ça dit aussi ce qui est, ce à quoi on est réduit quand on n’est plus que ce que l’on est : l’urine, les déjections, le sang, la lymphe. Car le corps se rappelle bruyamment à la mère, qui doucement bascule dans un être définitoire et décisif : « C’est parce qu’elle est réduite à ce qu’elle est qu’il a fallu venir à l’hôpital ». Et c’est parce qu’elle n’a plus la parole que l’autrice la lui donne au présent.
C’est toute la force du récit de Nicole Malinconi qui s’enracine dans ce choix : dire sa mère sous le jour cru et blanc de la vérité, « ce à quoi elle est réduite », dans un continu glissement de l’être à l’avoir, dans un entremêlement incessant du passé au présent.
Déplier le sujet
La mère n’a pas de prénom. Ce qu’elle est , c’est « ma mère », « une femme qui a un enfant », « une mère qui attend sa fille pour mourir ». Le père, s’il n’a pas non plus de prénom, n’est en revanche pas défini par ce lien. Le père ne le devient qu’à la mort de la mère ; c’est là seulement, sur la dernière page de Nous deux , que « l’homme », « l’Italien », devient « mon père ». Da Solo donne les prénoms de la fille et de la mère : l’acte jamais anodin de nommer revient ici à permettre aux deux femmes d’exister indépendamment l’une de l’autre, à leur offrir une vie en dehors du « nous » – à déplier le sujet. Là où la narratrice de Nous deux , pour parler d’elle-même, voguait entre la première et la troisième personne (utilisant le « elle » pour évoquer « l’enfant » qu’elle était), Da solo , porté par la voix du père et non plus par celle de l’enfant, vacille entre le « je » et le « tu » :
« Tu arrivais dans un meublé avec ta valise, tu faisais une saison quelque part et tu allais ailleurs quand tu voulais. En meublé, tu pouvais te permettre ça ; juste la valise et tu mettais tout dedans. Moi, je pensais que le monde était fait pour le parcourir, durant la vie. »
Le même jeu pronominal s’installe dans les dernières pages de Nous deux :
« La fille voit la mère comme chaque jour, mais aujourd’hui est un jour particulier car la mère ne la voit pas. […] Tu lui parles lentement, tout bas ; tu lui dis des choses réelles, à quoi se repérer. […] Elle veut lui dire quelque chose d’évident, de facile, qui pourrait servir de point de repère à la mère. À toutes les deux, peut-être. »
Et ceci avant de revenir au « je » dans la toute dernière partie – la page de fin : ainsi, à l’heure de faire face aux émotions, le sujet revêt les atours délaissés de sa plus franche et directe subjectivité, cesse de les différer. Si cette démultiplication du sujet-narrateur peut jouer, à dessein, sur le degré d’empathie face aux évènements rapportés ou les emballer d’un voile d’universalité (afin, justement, de s’en distancier), elle participe également du questionnement général sur la place occupée par chacun dans ce triangle familial aux liens (dis)tendus. Comment vivre à deux en étant trois ? Comment vivre seul, avec deux autres ? Nous deux comme Da solo interrogent le « nous », la construction d’un « nous », trop présent ou pas assez, que la démultiplication du sujet tendrait à pallier. Car le « nous » du premier récit n’est peut-être pas aussi englobant qu’on pourrait le penser. La précision du « deux », si elle consolide les murs élevés autour du duo mère-fille, a également pour conséquence de laisser entrevoir les sujets distincts que le « nous », si pressant, ne parvient pas à fusionner. Or, Marielle Macé souligne ceci, dans son livre Nos cabanes :
« […] « nous » ne désigne pas une addition de sujets (« je » plus « je »…) mais un sujet collectif, dilaté autour de moi qui parle : moi et du non-moi, en partie indéfini, potentiellement illimité, moi et tout ce à quoi je peux ou veux bien me relier. […] Peut-être « nous » est-il alors quelque chose comme le pluriel de « seul » : il ne se fait pas à partir de nos « je », affirmés ou vacillants, mais à partir de nos solitudes ; il les met en commun, c’est-à-dire qu’il les rassemble, les surmonte en les rassemblant, et à certains égards les maintient .5 »
Omniprésent mais fragile dans le premier récit (où se dit finalement l’addition du « elle » et du « je » plus qu’une expérience collective), le « nous » se lit entre chaque ligne de Da solo . Le personnage du père y déplie ses liens, au « nous » passé de la famille italienne, et à celui qui ne semblait pas vouloir de lui mais auquel il est finalement lié plus qu’à tout le reste : ce « nous » qui a pour origine la mise en commun de sa misère, de sa solitude, avec Lyse, la mère de sa fille.
« Un jour, quand elle ne faisait plus que s’asseoir sur sa chaise, elle avait dit : nous, au fond, on ne s’est jamais séparés. Quand je me rappelle ça, je préférerais encore la voir là, même rien qu’assise sur sa chaise. »
Aussi incisifs et bouleversants soient les récits pris séparément, c’est noués qu’ils déploient la pleine puissance d’un « nous » fédérateur de solitudes, porte-voix de ces mémoires entremêlées.