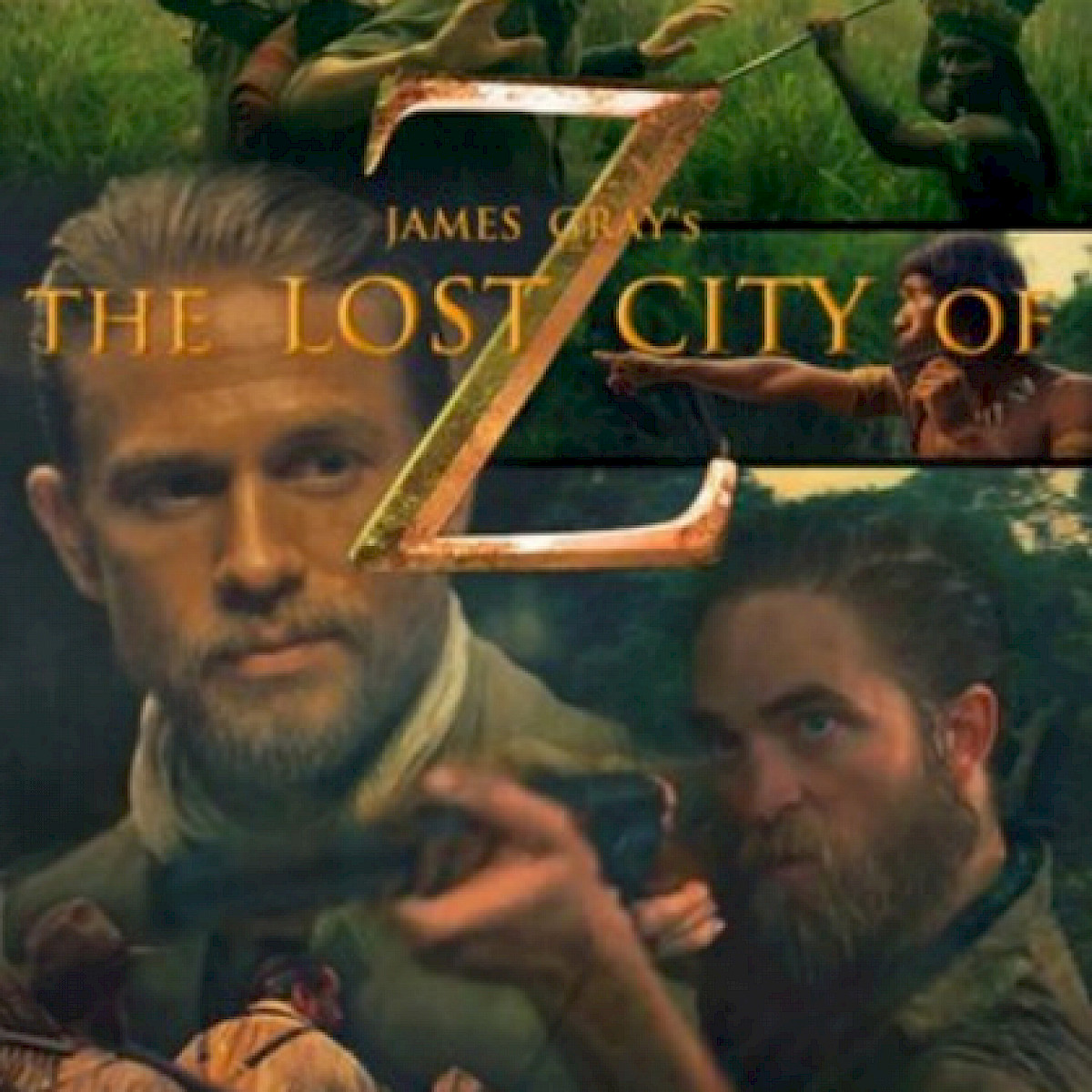
Parmi les réalisateurs actuellement adulés par la critique, James Gray fait figure de curiosité et de cas à part. Parce qu’il possède un style cinématographique fondamentalement distinctif, ou qu’il adopte une certaine forme de post-modernisme qui le distinguerait de la masse ?
Non, ce qui différencie James Gray de ses contemporains est son goût pour le conventionnel. Cinéaste classique, dans le sens le plus honorable du terme, il fait partie d’une espèce rare de réalisateurs pour qui la meilleure expression artistique est celle du cinéma traditionnel. Qu’il s’agisse d’aborder le film policier ( La nuit nous appartient ), le triangle amoureux ( Two Lovers) ou le film de gangsters ( The Yards ), il privilégie toujours le travail bien fait à l’innovation, le cadrage old school à une esthétique tape-à-l’œil. The Lost City of Z , son dernier long métrage, est une ambitieuse et imparfaite démonstration de ce cinéma particulier.

Pour son premier film d’aventures, Gray s’attaque à l’histoire vraie de Percy Fawcett, un des derniers grands explorateurs de l’Amérique du Sud. Colonel dans l’armée britannique et héritier d’une fâcheuse parenté, il se voit proposer l’opportunité de tracer la frontière entre la Bolivie et le Brésil ; un périple dangereux en cette période de l’Histoire (nous sommes au début du XX e siècle), mais qui lui permettrait d’obtenir le rang social auquel il a toujours aspiré. En compagnie de quelques militaires et d’un guide local, il se lance corps et âme dans un périple à travers la dure jungle amazonienne qui a pour destination finale la source du Rio Verde.
Si cette prémisse suggère une longue et progressive descente vers la folie, similaire à celle d’ Apocalypse Now , l’ambition du film n’est pas là, ou plus exactement, n’est pas uniquement là. Passé son premier acte, au cours duquel ses personnages sombrent effectivement dans la psychose, The Lost City of Z dévoile ses cartes : son récit n’est pas celui d’un périple dangereux, mais l’histoire d’une vie marquée par ce périple. En termes d’envergure et d’intention, le long métrage se rapproche donc plus de Lawrence d’Arabie que du film de guerre de Coppola. L’événement majeur de l’existence de Fawcett – la découverte fortuite de certaines traces archéologiques – cimente tout le film. Hanté par l’idée qu’existe au sein de cette jungle une civilisation disparue, Fawcett est animé par un désir brûlant d’exploration, qui entre en contradiction avec son rôle de père de famille – chacun de ses voyages vers l’inconnu signifiant son absence durant plusieurs années.
On devine que la nature familiale du drame est une des raisons principales qui ont amené Gray vers le projet : ce passionnant dilemme est parfait pour sa sensibilité cinématographique, et s’impose comme la continuation logique de thèmes qui lui sont chers. Malgré l’ampleur conséquente du film, et le poids de l’histoire raconté, c’est une œuvre mise en scène avec la même nuance et la même subtilité que ses précédents films. Seul bémol à son approche narrative : le rythme du long métrage souffre de son attachement à la réalité historique qui, aussi passionnante soit-elle, ne se prête pas toujours à la fiction.

On remarquera tout de même que The Lost City of Z marque une rupture pour le cinéaste, puisque aucun de ses acteurs fétiches (Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg) n’est au casting, laissant le film reposer en grande partie sur les épaules d’un « novice » du cinéma de Gray, Charlie Hunnam. Acteur capable mais au jeu peu varié, Hunnam livre ici une performance à moitié réussie : s’il est particulièrement convaincant lorsque son personnage fait preuve d’autorité, il l’est beaucoup moins lorsqu’il ne lui est pas nécessaire d’élever la voix. Face à lui, Robert Pattinson tente de faire oublier son passé de vampire pour la saga Twilight en s’affublant d’une barbe et de lunettes, qui le rendent presque méconnaissable. L’effort est louable, mais inadéquat : Pattinson disparaît tellement dans son rôle de compagnon de voyage qu’on finit par oublier le personnage qu’il incarne. La seule exception est Sienna Miller, qui incarne avec vigueur l’épouse déterminée de Fawcett ; le reste des acteurs n’impressionne guère.
Si The Lost City of Z n’est pas le meilleur film de la carrière de Gray, il reste néanmoins un de ses efforts les plus remarquables, notamment grâce à la photographie de Darius Khondji. Dans un superbe 35 mm, il capte avec sobriété la nature hypnotique de la jungle amazonienne, et la fascination qu’elle exerce sur le protagoniste. À l’ère du cinéma numérique, on pourra voir dans l’utilisation de la pellicule un coûteux caprice, mais c’est un choix qui semble plus motivé par une volonté de rendre le film beau et authentique que par une vaine nostalgie pour ce support.
Là est peut-être la force de James Gray. Son admiration pour le cinéma d’antan le définit, mais ses choix cinématographiques sont avant tout au service de sa vision personnelle, et de la qualité générale du film. Avec The Lost City of Z, il n’arrive pas tout à fait à la hauteur des chefs-d’œuvre qui l’ont inspiré, mais il est suffisamment talentueux pour ne pas avoir à rougir de la comparaison.