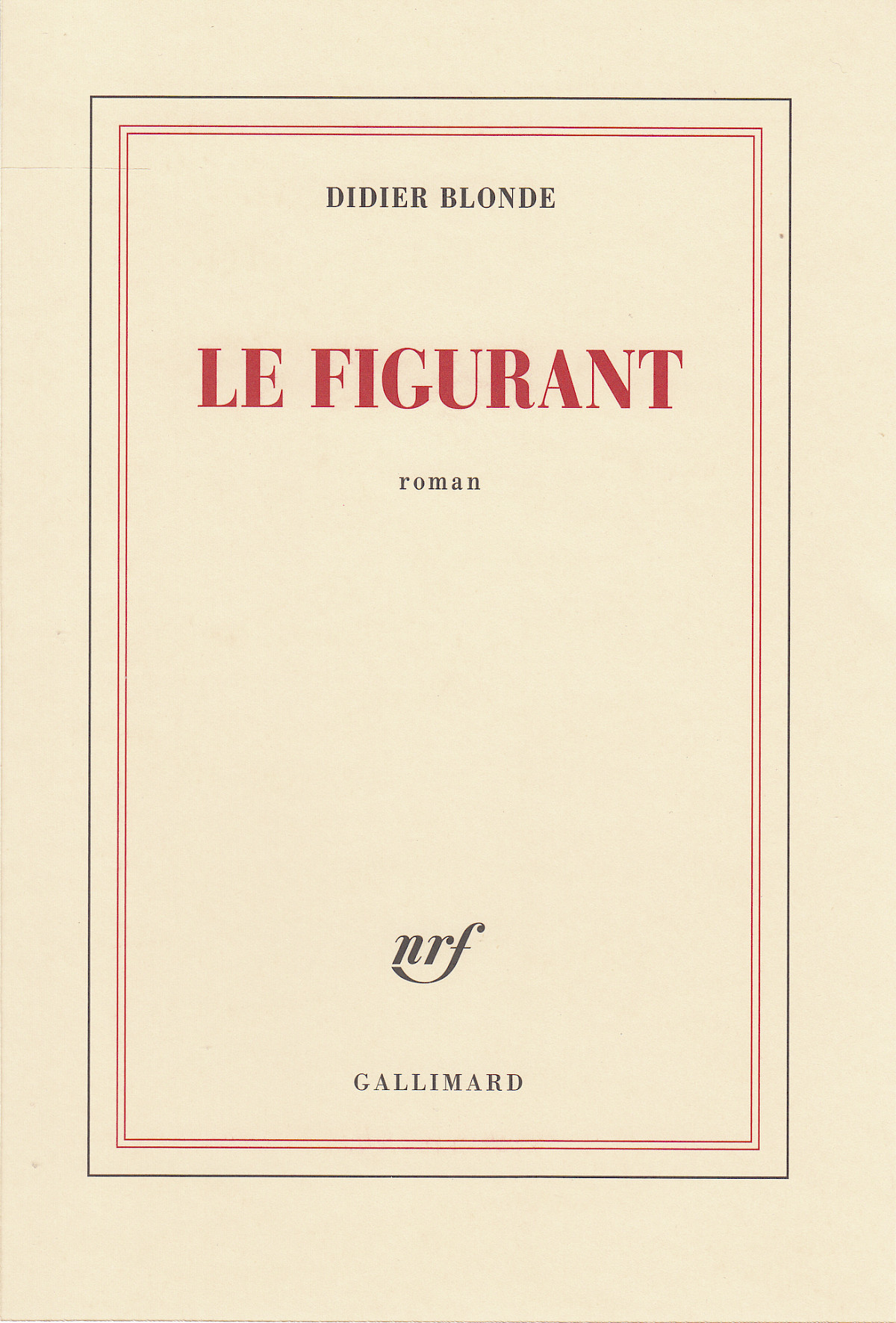
Baisers volés, rêves mouvants, bonheur fané… que reste-t-il de nos amours en fuite ?
N’est-on jamais que le figurant de sa propre vie ?
Le narrateur, aussi dépourvu de nom que de visage, a été quarante-cinq ans auparavant l’un des figurants du film Baisers volés , troisième épisode des aventures d’Antoine Doinel racontées par François Truffaut. À l’occasion d’une rétrospective organisée par la cinémathèque de Bercy, un ami journaliste lui demande un article sur les coulisses du tournage. L’article ne sera jamais fourni, mais une longue chasse aux fantômes commence, entre repérages, rencontres et plongées dans le brouillard des souvenirs.

C’est que le narrateur avait à cette occasion rencontré une jeune fille, Judith, et connu avec elle une trop brève idylle avant qu’elle ne disparaisse de sa vie à tout jamais. De cette jolie partenaire au visage lumineux et à l’allure faussement sage, attablée en face de lui, il ne reste désormais à peu près rien : un prénom et une image floue, sur une photo improbable, sur la pellicule du film, sur le fil ténu de la mémoire.
En exergue du roman, une citation de l’écrivain espagnol Julio Llamazares : « Dès lors, j’ai vécu en me tournant le dos. » On n’aurait pu trouver citation plus appropriée. Sur le seul cliché retrouvé où ils figurent ensemble, le narrateur apparaît de dos, en gros plan, cheveux longs tombant sur le col d’une veste de velours, face à ce visage angélique encadré d’un fichu d’où s’échappent quelques mèches blondes. Elle rit, qu’a-t-il pu dire pour la faire rire ? Comment se souvenir de la « conversation muette mais animée » qu’on leur a demandé d’improviser ? Il va s’accrocher à ces guenilles du passé pour tenter, dans une quête obstinée et vaguement désespérée, de donner corps à ces souvenirs évanescents.
Et la plongée s’avère vertigineuse.
Un peu comme dans la pièce de Tom Stoppard consacrée à Hamlet1 , l’auteur inverse la perspective, rejetant les protagonistes – réalisateur et acteurs – de Baisers volés au second plan et mettant en lumière ceux qui n’apparaissent que fugacement à l’écran : ces figurants, même pas crédités au générique et « qui ne représentent qu’eux-mêmes. » Mais le film de Truffaut et son ambiance nostalgique, sa quête incessante de l’amour parfait, ne cessent de déteindre sur le récit et sur l’âme du narrateur. Dans un Paris pré-soixante-huitard, à la fois mélancolique et en pleine mutation, où l’on sent sourdre l’effervescence qui va tout bouleverser (les deux figurants participent à la célèbre manifestation de soutien à Henri Langlois qui sera sévèrement réprimée2 ), Didier Blonde fait également revivre ce monde hétéroclite des figurants de cinéma, dont beaucoup cachetonnent en courant d’un film à l’autre pour composer d’anonymes et oubliables silhouettes. Il y a là ces figures à peine esquissées qui sont souvent familièrement désignées par un sobriquet ayant trait à leur allure, à leur emploi ou à tout autre élément futile caractérisant : « l’Allemand », « le mort », « les inséparables », « la bonobo », « Monseigneur »… Le narrateur sera Orangina, d’après les boissons trônant sur la table entre la fille et lui ; lors d’une prise, alors qu’il veut saisir sa main, l’inconnue en renversera accidentellement une bouteille, ce qui amènera le narrateur à entr’apercevoir une cicatrice lui barrant le poignet gauche.
Les images qui ressurgissent dans la mémoire du narrateur ne cessent de s’entrecroiser avec les images du film et pour les distinguer typographiquement, l’auteur a recours aux caractères romains pour les premières et aux italiques pour les secondes. C’est ce qui rend le roman encore plus fascinant et paradoxal. L’histoire d’Antoine Doinel est fixée sur la pellicule à tout jamais. Celle du narrateur doit être recomposée à partir de bribes de souvenirs, les siens mais aussi ceux de témoins souvent inattentifs d’une brève parenthèse enchantée qui n’a peut-être de valeur et d’importance que pour l’enquêteur improvisé. Et puis il y a les traces neutres, celles des documents de la Bibliothèque du film mis à la disposition des chercheurs et étudiants par la Cinémathèque de Bercy. Des archives qui répertorient soigneusement et impassiblement tout ce qui concerne les tournages de films. Le dossier qui intéresse le narrateur porte le numéro 93B-70. Ou comment retrouver les émois de son cœur dans des dossiers comportant les données techniques de minutage, de caméras, d’objectifs, de nombre de prises, de scènes, de plans. Au détour d’une note de la scripte, il retrouve la trace du moment magique où il a connu celle qui le hante : dix-sept prises pour trois plans tournés et les détails de la figuration lors de la scène du Disque Bleu : « Clients. Hommes : 6. Femmes : 1. Total : 7. Prêts à tourner : 12h. (ayant déjeuné) ».

Je nous découvris soudain dans ces quelques mots, et ces chiffres, anodins. Nous étions là, rangés à notre place, dans ce simple décompte. J’étais dans ces six hommes, Judith était cette femme. Anonymes. Sans âge ni identité. Catégorisés par sexe. Indifférenciés. Comme si nous étions vus de très loin, les différentes pièces livrées en vrac d’un scénario dont rien n’était joué encore, en attente d’une incarnation. Une boîte de bricolage sans mode d’emploi.
Mais le scénario dont parle le narrateur ici est-il vraiment celui du film ? Ils sont « vus de très loin », ces figurants insignifiants et c’est tout l’intérêt du livre de Didier Blonde de poser sa loupe sur eux, sur deux d’entre eux en particulier, de montrer que leur brève rencontre vaut tous les scénarios du monde. Si la recherche du narrateur est concentrée sur la mystérieuse Judith, ce n’est pas seulement de l’« identification d’une femme » qu’il est question, il s’agit sans doute aussi pour lui d’une volonté d’incarnation de sa propre identité dans une vie qui lui file entre les doigts, glissante, fuyante, insaisissable.
Derrière la recherche des lieux et des personnes au cours d’errances parisiennes aux allures parfois de flâneries, derrière ces rencontres avec les témoins involontaires de leur courte histoire (magnifique portrait de « la Gitane »), il y a petit à petit une femme qui affleure dans toute son indéchiffrable et peut-être insignifiante complexité, mais surtout l’autoportrait d’un homme en « profil perdu ».
On appelle en peinture ou en sculpture « profil perdu » la représentation d’une personne de dos avec la tête légèrement tournée sur le côté, de sorte que les traits du visage restent dissimulés. Ne sommes-nous pas parfois (souvent ?), nous aussi, aux yeux du monde, des profils perdus ?
Rarement le style d’un auteur aura-t-il tant vibré au diapason de son sujet. La précision ne nuit jamais à l’émotion et rappelle un peu Le stade de Wimbledon de Daniele Del Giudice, où la quête restait plus abstraite. On n’oubliera pas de sitôt la rue Caulaincourt et les autres lieux visités, les personnages rencontrés lors de cette quête obstinée, les émotions à peine esquissées mais qui résonnent longtemps après la lecture de la dernière page.
Et finalement, une lueur d’optimisme ? Car si les bulles d’Orangina sont éphémères et viennent se briser à la surface avant qu’on ne se soit rendu compte de leur matérialisation, chacune d’entre elle a pu englober toute une vie, en tremblotant de toute la légèreté de nos possibles.