Armel Job, Un parfum
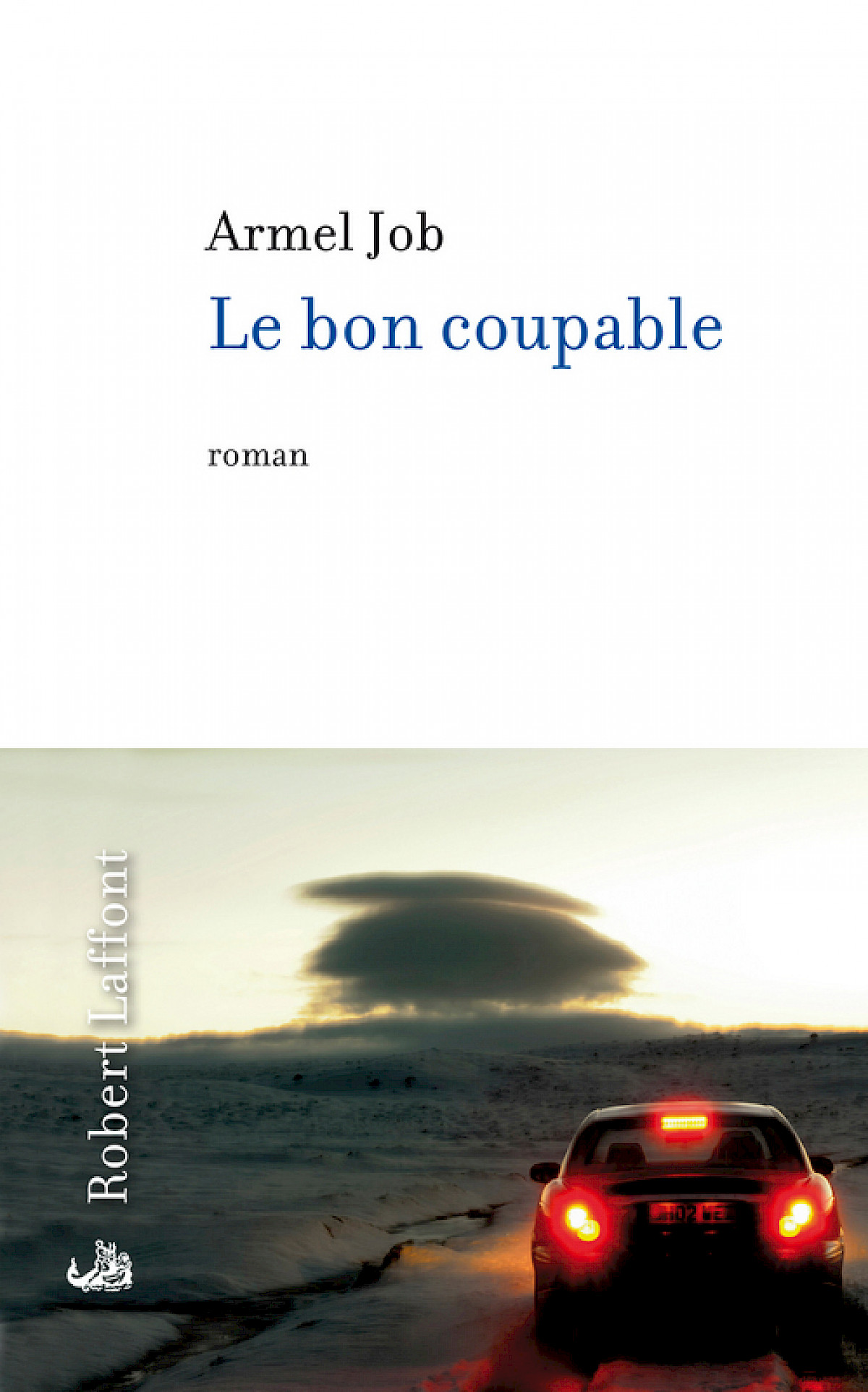
J’entendais évoquer Armel Job. Mais toute vie est une approximation. On entrouvre des millions de sillons qui resteront en friche, on avance entre des collines d’appétits empilés. La volonté voudrait imprimer sa marche, la submersion entrave. Puis, l’attente de l’occasion. Un débat à la Foire du livre de Bruxelles nous a réunis, j’ai plongé. Armel Job. Le Bon Coupable est déjà son… dixième roman chez Robert Laffont. En moins de quinze ans. Armel est donc, c’est indubitable, l’un de nos auteurs les plus valeureux et les plus reconnus. Jusqu’en France, jusqu’à Paris, cet Eldorado des Belges. Respect !
Mais… intrinsèquement ?
Dès les premières lignes, je suis rassuré. Et je comprends la labellisation Robert Laffont. Nous avons affaire à une écriture classique sans être empesée. Le style est clair, fluide, vivant, bref d’abord aisé mais sans facilités, avec juste ce qu’il faut d’audaces syntaxiques ou lexicologiques. Une patte d’écrivain ferme et sobre. On sent l’amour de la langue ou du mot, mais la maîtrise exclut la gratuité, le surjeu. Il n’est pas question d’épater. Mais de simplement raconter au mieux une bonne histoire.
Quelle histoire ? Nous voici dans un petit village des Ardennes belges. Bauval. Pas loin de la grand-route de Liège. La Wallonie profonde. Un dimanche d’été. Onze heures. Le temps de la messe. Rues désertes.
L’auteur s’attarde sur Hector, un carrossier qui s’interroge sur sa présence incongrue dans son atelier. Une dispute avec sa femme, une chanteuse lyrique. Banale. Une mélodie (!) usée jusqu’à la corde. Comment leur couple a-t-il pu s’édifier au-delà de microcosmes ô combien dissemblables ? Dans ces cas-là, c’est sa fille Clara qui finit par venir le chercher, le ramener docilement à la maison. Pour le déjeuner. Sauf que le temps passe. Quid ?
La caméra bondit un peu plus loin. Onze heures. Carlo Mazure, un sexagénaire, s’est attardé au comptoir d’un café. Plus que de raison. Pas trop envie de retrouver sa Valentine, cette femme qu’il a arrachée à l’ire populaire lors de l’épuration de 1945, ou son Valentin, qui n’est pas tellement le sien. Et ses trafics, sa vie qui cahote sans queue ni tête depuis des lustres sinon toujours. Pourtant, il lui faut reprendre la route, et son van, avec son cheval à l’intérieur, un cheval auquel il tient comme à la prunelle de ses yeux :
Il ne lui en voulait pas du tout d’avoir terminé lamentablement la course la veille à Sterrebeek. C’était à lui-même qu’il en voulait, pour avoir cru si naïvement qu’il pouvait l’aligner avec des cracks issus des meilleurs élevages. Qu’est-ce qu’il connaissait en chevaux ? Rien. […] Un des trous noirs de sa vie. Après un steeple-chase et la tournée des grands-ducs qui avait suivi, il s’était réveillé dans un haras, propriétaire inconscient depuis les petites heures d’un poulain dont le père et la mère avaient fait la fortune de son compagnon de virée. Le prix ? Les yeux de la tête, à quoi plus tard il avait encore ajouté un sulky et un harnachement complet de course attelée. Quel plaisir de débourrer le bel animal dans la prairie sous le regard également globuleux de ses cousins de basse extraction et des péquenauds de Bauval ! Irrésistiblement, le projet de courir un grand prix avait germé dans sa tête. Il l’avait couvé en secret des semaines et des mois. C’était peu à peu devenu l’espoir de sa vie qui n’en comptait plus beaucoup d’autres.
Rebond. Onze heures. Alma. Elle rumine sa colère à l’égard de son mari Hector, se demande comment la musicienne prometteuse, délicate qu’elle était s’est retrouvée projetée dans cette vie-là. Mais elle ravale son orgueil et appelle Clara.
Rebond. Onze heures. Le procureur Lagerman a quitté l’appartement de sa maîtresse Rita et lâche la bride à sa puissante Jaguar, comme d’habitude. Un homme qui semble pétri de principes tout en affichant un peu trop de certitudes. Manque d’empathie, de lucidité ? Quelques chapitres nous présentent les protagonistes du drame qui se joue. Qui va se jouer. Pressenti à travers des allusions, des anticipations :
Souvent, elle restait pensive devant les carcasses froissées des voitures. En tous cas, c’est ce qu’Hector crut se remémorer plus tard, comme si ces mécaniques ravagées avaient averti l’enfant de son cruel destin.
Manque le chœur antique, nous serions, sinon, dans une tragédie grecque. Les personnages sur les starting-blocks. Ceux que nous avons évoqués mais d’autres aussi, tous adroitement plantés, tous reliés par des fils plus ou moins évidents, plus ou moins celés. Scellés ? Juste le temps de se situer les uns par rapport aux autres, par rapport à eux-mêmes. Avant le point de bascule. Qui approche inexorablement et quasi sans suspens.
Au centre du drame, Clara, dix ans, la fille d’Hector et Alma, une pianiste en herbe des plus prometteuses, qui illumine la vie de ses proches et au-delà. Elle apporte une complicité et un amour débordant à son grand frère Franz, qui en a bien manqué. Elle comble les attentes de sa mère par son talent, celles de son père par ses attentions (lui moudre son café, s’extasier devant les prouesses de son atelier et lui renvoyer une image de démiurge). Oui, Clara est un astre qui donne de la chaleur et du sens à la vie des autres. Hélas, elle court vers l’atelier de son père, elle est très jeune, elle ne prend pas assez garde.
Le récit suit son cours. Avant et après le drame. Inéluctable. Le passage d’un chauffard. Qui culbute l’enfant. Qui ne s’arrête pas. Accident. Puis délit de fuite odieux. Qui ? Comment ? Pourquoi ?
Nous n’assistons pas à l’accident, nous n’aurons pas droit à une enquête haletante, à des rebondissements spectaculaires, à des actes de vengeance, etc. Non, du tout. L’art de Job est ailleurs. Dans une capacité de dévoilement des personnalités et des imbrications, des aléas des itinéraires. Car ce sont plusieurs existences qui s’esquissent devant nous avec brio. Un coup de pinceau et on pressent un caractère, une carrière, une vie. Des épisodes du passé des uns et des autres resurgissent. Des réactions, un geste, un mot de ci de là nous en disent long et nous captivent, nous émeuvent, nous font réfléchir sans qu’il soit besoin de fastidieuses descriptions ou de pesantes digressions. Tout est équilibré, juste, chirurgical. Et l’on découvre toute une société de province, ses heurs et malheurs. Lâchetés, compromis, désirs refoulés, secrets d’alcôves, hypocrisies, masques de façade, abus de pouvoir… On se croit parfois dans le Boucher ou dans Que la bête meure de Claude Chabrol. Pas une mince référence. Tout près de ce que le ciné francophone a produit de meilleur durant les années 1960.
Les années 1960. Il est vrai que le roman s’y déroule, quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont les remugles affleurent. Il est vrai que le récit d’Armel Job s’y ancre (écho des velléités rattachistes wallonnes du temps, du rapt d’Eichmann, de l’exécution de Caryl Chessman) tout en s’exhalant en apesanteur. Je veux dire… hors du temps, des contingences spatio-temporelles. Pour révéler des blessures ou des failles qui sont de tous les lieux et de toutes les époques.
Job est un très bon romancier mais cet ouvrage n’a pas tant de matière romanesque, d’ingrédients. Il excelle plutôt à les exploiter, à leur conférer un supplément d’épaisseur, de résonance. Bref, on est certes dans un vrai roman, au premier abord policier mais davantage psychologique, de mœurs, on est surtout dans le registre du conte, moral, philosophique. Cruel mais si réaliste. Avec ces confrontations entre résurgences des archétypes du publicain et du pharisien bibliques :
Il faudrait savoir ! Que veut l’appareil judiciaire ? La justice ou le respect des règles de droit ? Si les règles empêchent la justice, il faut mépriser les règles. Une justice qui ne cherche plus la justice, qu’est-ce que c’est encore ? Une judicature. Voilà où on en est. Tout cela, bien entendu, est un peu trop fin pour le bec des chicaneurs de prétoire.
Pourquoi pas ? Oui, mais si c’est un homme de loi, un procureur, Lagerman en l’occurrence, qui le pense… Quand ça l’arrange…
Un récit rondement mené. Qui ne s’embourbe jamais. Dont l’intérêt perdure de page en page. Sans temps mort. Jusqu’au dénouement. Taillé dans la subtilité. Qui laisse songeur.
Cet article est précédemment paru dans la revue Indications n o 397.