Comment un père

À l’occasion de la Foire du Livre 2017, nous souhaitions mettre en avant des premiers romans d’ici et d’ailleurs. Vous faire découvrir des voix qui surgissent et feront peut-être date. Parmi elles, celle de Laurent Demoulin, universitaire liégeois gouailleur, amoureux des mots et trois fois père. Dans Robinson , il nous donne à lire, entre intime et extime, joie pure et désordre, une épopée du quotidien touchante et très organique avec un fils autiste.
Robinson à la boucherie soudain se tourne vers moi, gémit, tend les mains vers mes épaules. Il a dix ans et ne voit pas pourquoi je cesserais de le porter. Que sait-il de son poids et de ma force ? Si je n’obtempère pas, il va crier ou frapper sur la vitrine derrière laquelle s’étalent de plantureuses charcuteries. Je le prends donc, le portant d’un bras, dégageant mon portefeuille grâce à ma main demeurée libre avec le sentiment d’être Jean Valjean avançant à l’aveugle dans les égouts de Paris, tâtant d’une main les murailles gluantes et soutenant de l’autre Marius agonisant. Pourquoi ne puis-je m’en aller dans la fleur de l’âge ? Pourquoi m’est-il tout à fait interdit de mourir jeune comme mon père ? Pourquoi ais-je l’ambition de mourir très vieux comme mon grand-père ?
Robinson, pour s’endormir, a besoin que je lui prenne la main.
Robinson
n’était pas le premier titre de votre récit… Qu’est-ce qui a fait pencher la balance ?
J’aimais beaucoup mon premier titre,
l’Amour et la Merde
, qui est venu très vite. Je le trouvais musicalement intéressant, avec ses allitérations, « l », « a », « m », « r » des deux côtés. Il est resté très longtemps mais beaucoup de gens qui ont lu mon manuscrit ont trouvé que c’était trop dur ou se méprenaient sur son sens. Pour moi, ce sont vraiment les deux thèmes du livre : au milieu de cette relation entre un fils autiste et son père, il y a le fait que cet enfant n’est pas propre. Peut-être ne fallait-il pas mettre autant l’accent là-dessus… Avec ce rejet de pas mal de gens, je cherchais autre chose mais je ne trouvais pas. J’ai fait lire le texte à mon ancien professeur Jacques Dubois : il m’a envoyé un mail pour me donner son avis. L’objet du message était « Robinson » (
ndlr
: pas le vrai prénom de l’enfant). Comme j’ai vraiment beaucoup d’affection et d’admiration pour ce professeur, que quelque part il est pour moi une figure paternelle, j’aimais que ce soit lui qui m’ait soufflé l’idée.

Vous adoptez une forme fragmentaire. Était-ce celle qui permettait de rendre le mieux compte à la fois de l’intime et de l’extime ?
Il y avait quelque chose de ça, oui, et aussi une sorte de rapport au présent. Le fragment me semble la bonne solution pour tenter de traduire l’instantanéité. Je n’ai pas l’impression d’inventer une forme : elle est employée par des auteurs que j’ai beaucoup lus, comme Jean-Philippe Toussaint ou Hervé Guibert. Je trouve que ça reflétait aussi quelque chose de cette existence discontinue que je voulais décrire. C’est une vie où la question du sens et de l’absence de sens se pose tout le temps. La forme plus traditionnelle du récit avec des chapitres qui s’enchaînent et où il y a une chronologie aurait moins convenu : il ne fallait pas qu’il y ait un récit unifiant pour introduire une fausse causalité.
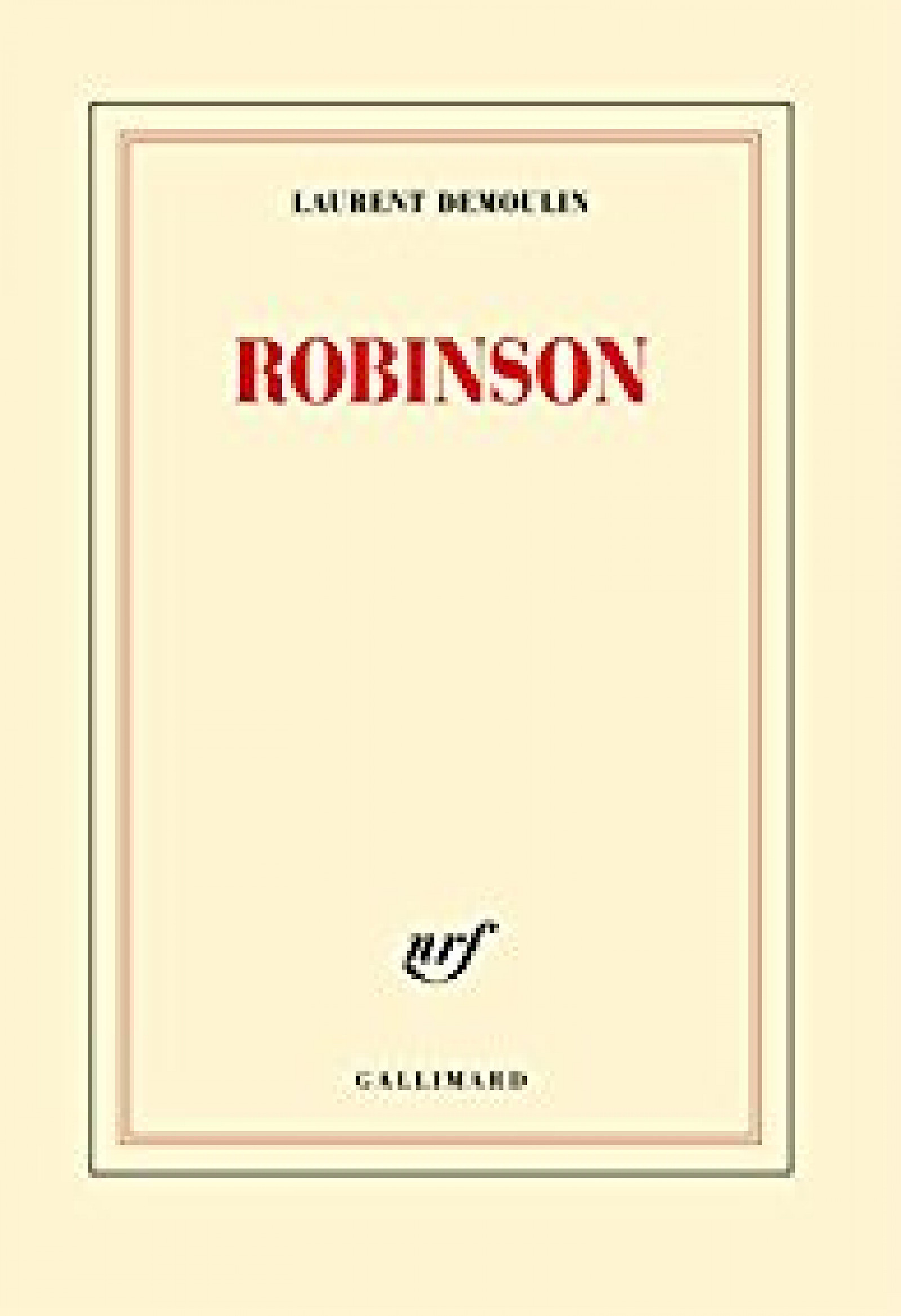
Vous interrogez également le genre. Vous auriez souhaité que figure « roman » sur la couverture, là où vos éditeurs chez Gallimard préféraient « récit ».
Ç’a été un compromis entre eux et moi de ne finalement rien indiquer. L’objectif pour moi était en tout cas que ce soit un roman tout comme
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
d’Hervé Guibert peut l’être. C’est aussi une narration au présent, au plus proche de la vie et autobiographique. Je ne voulais pas que ce soit un essai ni un témoignage. Je suis un peu dans un hybride entre les trois, mais j’ai vraiment freiné. À certains moments, je me montre quand même affirmatif concernant des idées sur l’autisme, mais j’essaie plutôt de laisser le lecteur tirer la conclusion de la scène que je raconte, plutôt que de faire de la psychanalyse. L’autre danger pour moi, c’était le témoignage.
Pour quelles raisons était-ce un danger ?
La première raison, c’est par rapport à mon vrai fils : comme il ne parle pas, je ne peux pas lui demander l’autorisation de publier ce livre sur lui et ça me pose un problème moral. Un livre brut de témoignage, je n’aurais vraiment pas le droit, par rapport à son intimité. La médiation par la littérature le protège. Je ne réponds jamais à des questions sur mon fils réel : je m’en tiens au personnage. La seconde raison, c’est que même si les incursions dans la fiction pure sont peu nombreuses, c’est écrit comme un roman. Les personnages secondaires sont souvent un mélange de plusieurs personnes dans la réalité, la promenade en ville en condense plusieurs. L’attention à la langue et l’ordre des chapitres témoignent aussi de ça : j’y ai beaucoup réfléchi, j’ai changé jusqu’aux épreuves certains passages pour des raisons de rythme, purement formelles. Pour le personnage de Robinson, je n’ai pas eu besoin d’en rajouter : parfois la réalité dépasse la fiction. Mais si cela avait été nécessaire je l’aurais fait : il n’y a pas de pacte autobiographique avec le lecteur.
Vous avez consacré votre thèse à Ponge et on sent cette affinité dans votre attention particulière aux descriptions précises.
Ponge est un de mes modèles : je pense que ce serait un problème de n’en avoir qu’un, mais pas plusieurs. Certains lecteurs m’ont dit que ça leur rappelait Savitzkaya et
Marin mon cœur
m’a marqué, d’autres me disent qu’il y a du Jean-Philippe Toussaint et je suis d’accord, d’autres encore mentionnent André Baillon. Pour le côté scatologique, on m’a mentionné Joyce. Je m’efforce d’exister entre ces différentes figures, je joue avec ça. Les petits détails descriptifs me permettent d’ancrer le récit dans le réel. Je raconte une expérience qui n’est pas commune mais j’ai été très étonné que beaucoup de lecteurs me disent que c’était prenant. Je pensais que c’était très poétique mais pas nécessairement ça. C’est peut-être grâce à ces injections précises : ça parle à tout le monde, on peut s’y accrocher. Dans les brouillons de Proust, quand il devenait trop abstrait, il notait dans la marge : « tangibilia ». Ajouter des choses concrètes. Quelqu’un a été frappé par ma description des épices au supermarché : ça me fait plaisir qu’on me parle aussi de ces passages, pas juste de ma réflexion sur l’autisme.
Grâce à Robinson, vous interrogez le rapport au temps mais aussi au regard. Ce personnage devient comme un tamis à travers lequel on peut filtrer le monde.
Ou l’inverse : il n’y a parfois plus du tout de filtre ! Ce père narrateur est un homme de langage. Il se retrouve face à un enfant qui ne parle pas et pourtant la communication est très forte. C’est une relation d’amour – il ne faut pas avoir peur du mot. On se demande par où elle passe. À certains moments, le père a l’illusion ou l’impression de retrouver ce type de contact qu’on a avec sa mère avant d’apprendre à parler. Une sorte d’amour – très certainement fusionnel – qui ne passe pas par les mots, contrairement à ce qui arrive avec ses autres enfants, sa femme ou ses amis. Dans ces moments-là, il a l’impression d’être lui-même un peu oui-autiste. Lors de la scène de la promenade, il a cette sensation très fragile – parce qu’en réalité c’est impossible de sortir du langage – de moins filtrer la réalité. De voir tous ces gens qu’il rencontre comme autant d’individus uniques, pour eux-mêmes. Pas comme « homme », « femme », « beau », « laid », etc. D’entrer dans une forme de temps immobile. Il se dit que c’est ça, cette sorte d’autisme sans mots. Une hypothèse, c’est que si les autistes se replient sur eux-mêmes, ce n’est pas parce qu’ils sont coupés du monde : ils se coupent du monde parce que le monde rentre en eux.
C’est aussi ce qu’exprime cette fin en forme de retour à la sauvagerie ? C’est devenir le Vendredi de Robinson ?
La fin va jusqu’au bout de la fusion et en même temps, c’est une sorte de rêve impossible. Le père tente – puisqu’il n’y a pas le langage – de trouver d’autres moyens de communication. Ces moyens de communication sont très forts, moins contrôlables puisqu’il ne sait pas endiguer l’émotion par les mots. S’il arrivait à s’extraire tout à fait de ce langage, ça serait la catastrophe. J’ai voulu qu’il y ait beaucoup d’humour dans le livre, mais là il y a quand même une part tragique, qui est aussi celle de tous les parents : la question taraudante de l’avenir. On ne veut normalement pas survivre à ses enfants, mais face à un enfant comme ça, on ne s’imagine plus mourir en paix. « Mourir en paix », ça a l’air d’être un thème un peu d’une autre époque, mais ça reste essentiel. La solution à la fin du livre est une réponse faussée à cette angoisse.
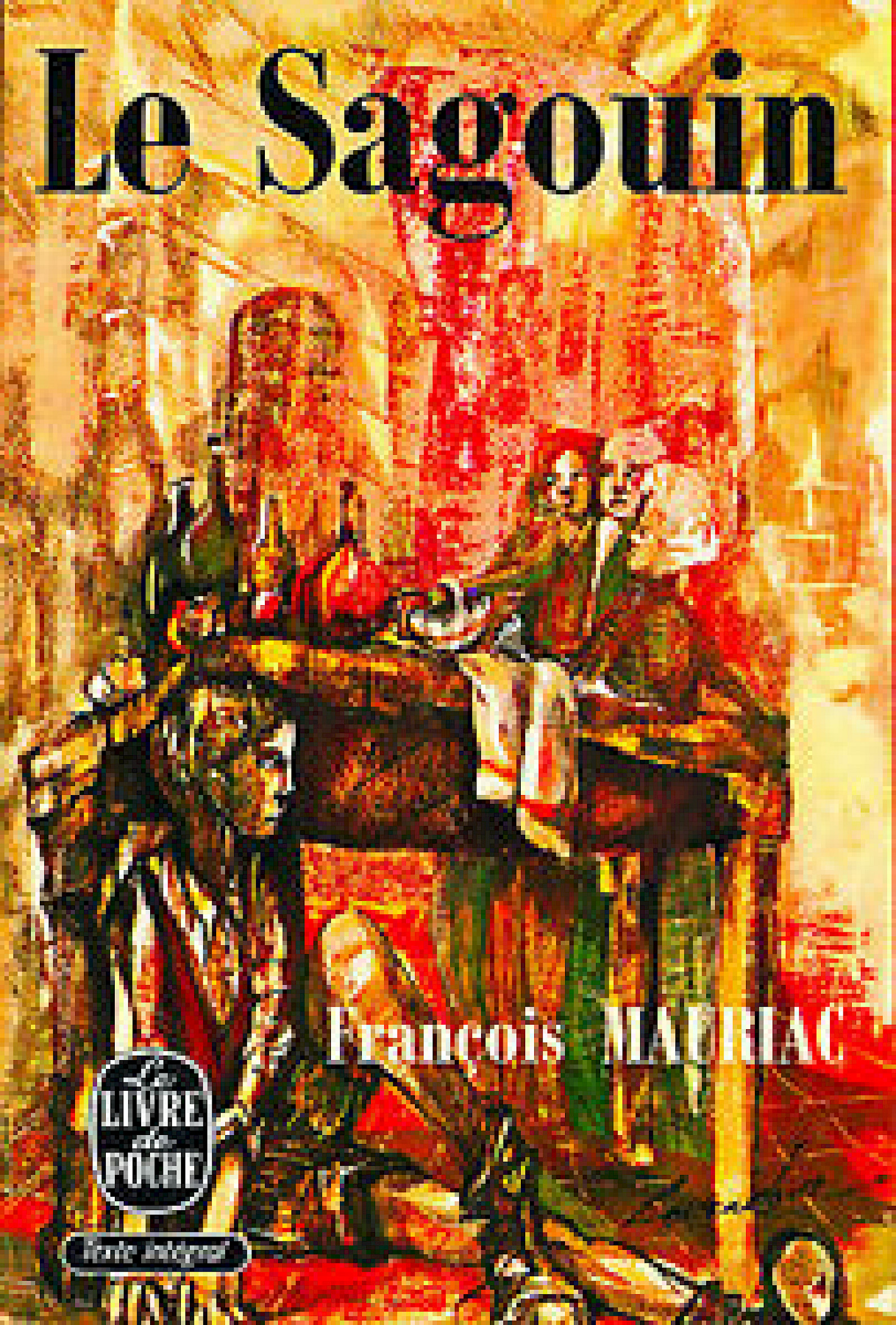
Cette fin, vous la choisissez à nouveau littéraire et sans concession là où on aurait pu imaginer une interrogation sur les institutions d’accueil, etc.
L’école, les institutions, ce sont des questions que je n’ai pas voulu mettre dans le livre : elles sortent du cadre de la relation père-fils. Ça aurait ouvert un autre texte, un autre ton. On aurait pu penser à un roman de suspense : est-ce que Robinson va entrer en institution ? Sans le faire exprès, sans doute de façon inconsciente – je ne l’ai encore dit à personne –, cette fin ressemble très fort à celle du
Sagouin
de Mauriac, que j’ai découvert à l’adolescence et qui m’avait marqué. Je l’ai relu, il n’y a pas longtemps, après la sortie de
Robinson
. Je me demande si ce
Sagouin
n’est pas un petit autiste : on n’employait pas le mot à l’époque. C’est très différent des autres livres de Mauriac, c’est beaucoup plus dense : j’ai trouvé ça magnifique.
Le thème de la Foire cette année était « Réenchanter le monde ». Est-ce que la façon poétique que vous avez eu d’aborder le texte était une façon de réenchanter le réel ?
C’est plus au lecteur de le dire qu’à moi. Je reçois beaucoup de courrier pour ce roman et certains allaient effectivement dans ce sens. D’autres m’ont dit : « Enfin un livre positif, qui aime l’humanité, dans cette rentrée littéraire si cynique ! » Ça va peut-être au-delà de ce que je voulais faire, mais je souhaitais montrer aussi les bons côtés de l’autisme. Pour moi, Robinson est un personnage riant. Fatigant mais gai. Ça correspond à ce que je vis, et on n’en parle pas assez. C’est aussi pour ça que j’ai forgé ce mot « oui-autiste », pour inverser le circuit du normal et de l’anormal, pour traduire le côté affirmatif. Réenchanter le monde par la littérature, c’est une crête entre deux dangers : marre du cynisme à la Houellebecq… Mais à l’inverse, au secours la nunucherie à la Christian Bobin ! Les écrivains que j’aime sont ceux qui résistent à ces deux penchants. J’adore cette phrase de W. C. Fields : « La situation est désespérée mais ce n’est pas grave. » C’est pour ce contraste que mon titre
l’Amour et la Merde
m’intéressait.
Comment se sent-on quand on a fait aboutir un texte aussi intime que celui-là ?
J’écris plus ou moins depuis l’âge de seize ans. Dans le bureau de mon père, je me prenais pour un écrivain. Toutes ces années difficiles – sept ou huit romans que je ne suis pas parvenu à faire publier –, je ne me donnais plus la permission d’avoir cette ambition. Si je n’y étais pas arrivé avec celui-ci, ça aurait été vraiment une crise. À vingt-deux ans, quand on refuse votre manuscrit, vous vous dites que vous avez encore de la marge de progression. À quarante-huit ou quarante-neuf ans, on se dit qu’on ne sera jamais meilleur. Le oui de la part de l’éditeur a provoqué de l’euphorie mais plus encore que ça, de l’apaisement. Les réactions des lecteurs me sont essentielles. C’est important pour moi parce que j’ai été un peu désigné par mon père pour cette mission. Il est décédé en 2008 mais c’est ce qu’il aurait voulu pour moi. À deux reprises et à deux ans d’intervalle, j’ai lu mes textes en public sur de la musique à Liège. On m’a dit la seconde fois que j’avais changé, que j’assumais, que je jouais désormais le jeu sans me dissimuler derrière des blagues.
Découverte d’un extrait de Robinson , lu par l’auteur et enregistré par SonaLitté :
[if lt IE 9]><![endif]