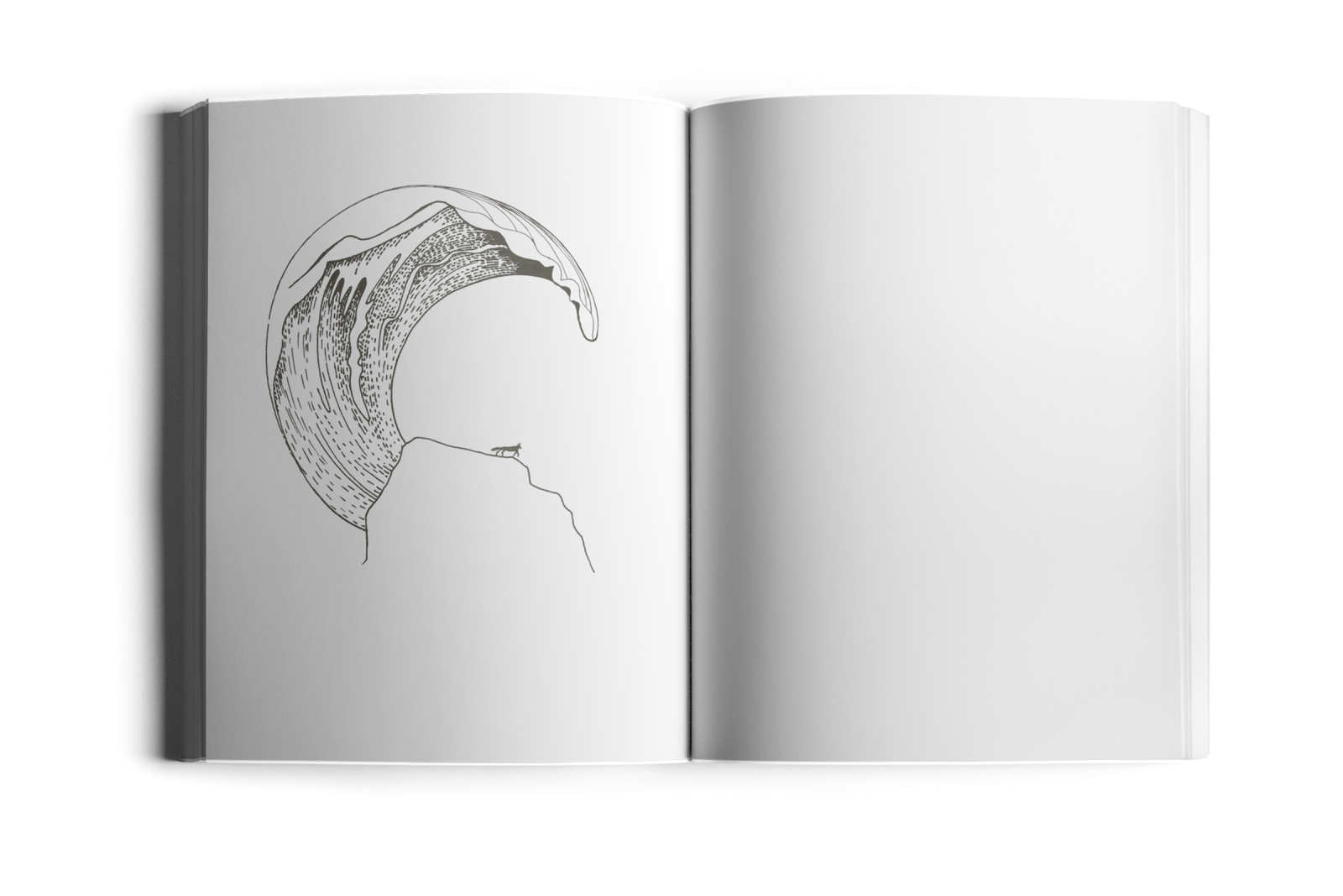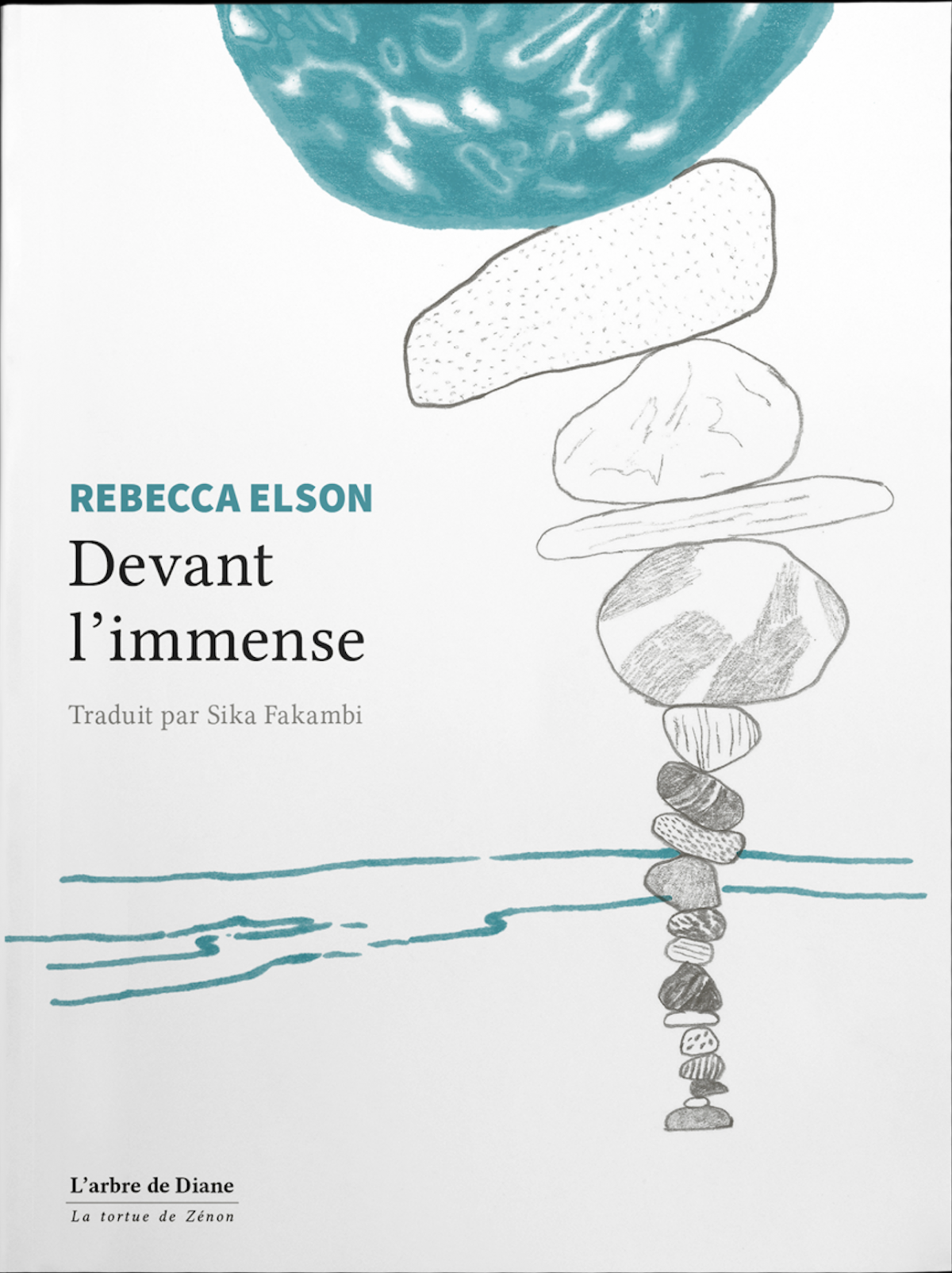
Curiosité poétique ou rêverie scientifique, le recueil de Rebecca Elson installe l’infini à portée de paume. Entre ciel et sol, naissance et néant, Devant l’immense arpente minutieusement un horizon tracé d’éblouissements familiers.
L’une de ces informations aléatoires entendues dans l’enfance me revient ponctuellement en mémoire : le ciel compte plus d’étoiles que la terre de brins d’herbe. Lire Devant l’immense appelle à dépasser cette projection, car il ne s’agit pas tant de quantifier l’inconnu en le rapportant au commun que de construire des ponts entre ici et là-bas. Pour Rebecca Elson, étoiles et brins d’herbe se rejoignent dans les frissons qu’ils déclenchent sur les peaux humaines. Autant de fils tendus entre les astres et les vivants, autant de chemins entre ciel et sol qu’arpentent les textes de la poétesse-astronome.

Vingt ans après sa parution originale dans le domaine anglophone, la traduction française 1 de ce recueil posthume a trouvé sa place au sein d’une maison d’édition bruxelloise, dans une collection qui n’aurait pas pu mieux lui correspondre : dirigée par Mélanie Godin et Renaud Lambiotte à l’Arbre de Diane, « La tortue de Zénon » abrite des textes d’une remarquable curiosité, mêlant sciences et littérature, mathématiques et poésie. Cette petite épopée géographique fait écho au mouvement perpétuel qui anime l’autrice : de la cime des érables canadiens aux pierres battues par le vent d’Angleterre, sillonnant les collines d’eucalyptus australiennes et les ruelles jaunes d’Italie, chaque page explore une lumière singulière. À travers les yeux de Rebecca Elson, les cailloux brillent d’un éclat semblable à celui des corps célestes.
Une lune entre nous,
Deux saisons,
Quoi d’autre ?
Quelques étoiles,
Pas le vent.
Les phrases sont flottantes, les paragraphes en apesanteur. Tous les textes composant le recueil2 égal devant l’immense et le minuscule. Rythmant le poème, un double regard se déploie, qui attache l’ici au là, le toi au moi, le jour à la nuit. Des pans du monde laissés de côté – pour cause d’inaccessibilité ou de trop grande familiarité – se parent de nouvelles lueurs. La frontière éclate. Tandis que le mouvement des astres fait face aux battements de cils d’une observatrice étendue sur l’herbe, un ballon rouge gonflé d’hélium héberge le fracas latent du Big Bang. Le quotidien se mêle de lointain, le prosaïque intègre l’extraordinaire : les moustiques sont astéroïdes, c’est à leurs « grosses bottes » qu’on reconnaît les « arpenteurs du ciel », l’espace est une paume enroulée autour d’une pierre-planète, nous sommes les vagues, « tu es l’astre filant » et les étoiles « sont des danseuses de lambada ». L’infini et le nul se fondent pour ne laisser qu’un présent frémissant, élastique – l’univers en expansion au cœur même du poème.
Ils disent que nous nous sommes éveillés
D’une longue nuit de magie,
De soifs insatiables,
Feu pour feu, terre pour terre.
Un vent se lève.
Et puisque rien ne se perd ni ne se crée, l’expression d’une constante transformation transparaît jusque sous les titres : expliquer , inventer , devenir , manger , mettre . Les infinitifs français, formes progressives des verbes dans la langue d’origine, installent une continuité ; le temps du mythe mêlé de conditionnel laisse entrevoir toutes les possibilités – en particulier celles « qu’on avait oublié d’imaginer ». Car les « petits miracles mouillés » que sont les vivants n’ont d’autre instruction que celle de devenir : grenouille ou grain de sable, écume ou océan, rayon de soleil dans un verre d’eau. Le temps d’une respiration, chaque poème déplie une petite mythologie. Un espace-temps éphémère où la seule préoccupation serait, peut-être, d’écouter les continents glisser sous les corps.
Sous le respire des roses
Nous nous étendons
Dans un été de mots blancs
Tressés comme des nuages
Images de mythe, de rêve ou véridiques, images sans âge qui secouent le fond du ventre. Il y a le corps dont les yeux regardent, les doigts touchent et comptent, dont le dos s’allonge sur la terre. Il y a le vent et les étoiles, le figuier, la bouillabaisse, les couleurs et la pluie, les grenouilles. Le feu, la terre, l’eau, l’air. Il y a surtout, dans ce recueil, deux manières d’appréhender le monde : en convoquant la raison (celle des mathématiques aux « dents parfaites »), et à travers les sensations. Comme l’araignée étend de sa toile les limites de son corps , c’est l’attention portée au monde par les sens qui, chez Rebecca Elson, distend les barrières entre soi et l’univers.
Juste ta lampe sur la neige
Et les choses qui ralentissent
Se font plus généreuses dans leur infinité.
Un vertige s’installe dès lors que l’on plonge dans l’immensité tapie entre ces pages. Car il ne s’agit pas seulement d’étirer l’instant pour la seule beauté du geste, mais aussi de balayer les injonctions capitalistes à la productivité et à l’action constante, lesquelles semblent peser sur les femmes jusque dans leur intimité (« Le travail d’une femme n’est jamais terminé »). Une capitulation amoureuse qui est celle, peut-être, d’un corps qui se sait malade. À travers son unique recueil, Rebecca Elson est parvenue à ériger l’écriture poétique en « antidote à la mort » – que cette mort marque la fin du voyage ou, plus discrète, accompagne la dissolution des éblouissements familiers. Qu’on agisse en poète ou en astronome, reste à ne pas oublier de poser, de temps à autre, un pas de côté. Le cœur au bout des doigts et des mains au fond des yeux, pour compter les étoiles.