Hors des rails en Haïti

À l’occasion de la Foire du Livre 2017, nous souhaitions mettre en avant des premiers romanciers d’ici et d’ailleurs. Vous faire découvrir des voix qui surgissent et feront peut-être date. Parmi elles, celle de Néhémy Pierre-Dahomey, dont les mots ciselés spiralent autour de Belliqueuse Louissaint, héroïne troublée mais forte qui, depuis une tentative de fuite jusqu’à un déraillement, et à travers amours rosses, enfantements et départs, cherche à en découdre avec la fatalité.
Elle déploya un mois durant sa plus grande énergie dans ce combat, faisant l’amour impitoyable à Désiré Désilus, tentant de prier pour raviver une foi qui lui était de peu de secours. Mais le simple et tendre souvenir de ses deux fillettes remontait sans cesse à la charge. Belliqueuse perdit contre elle-même. Elle reconnut enfin que les filles lui manquaient dans sa peau, dans sa chair, et plus loin encore, qu’elle donnerait tout pour les revoir, ne serait-ce qu’une minute, même pour seulement avoir des nouvelles. Ainsi commença l’exercice assassin de réclamer des êtres à qui la mer et les circonstances interdisaient l’accès.
En tant que jeune auteur, est-ce que ce fut difficile de vous faire éditer ?
Oui, très ! J’ai été refusé par toutes les maisons de la place de Paris. Il y a trois lettres types en général : une pour les auteurs que l’éditeur trouve mauvais ; une pour les passables ; une pour ceux qu’ils trouvent bons mais qu’ils ne vont pas publier par qu’ils n’entrent pas dans leur ligne. Entre ces étapes, j’ai énormément retravaillé le texte. À ma troisième tentative, le manuscrit a été repéré par le Seuil, notamment grâce à Tiphaine Samoyault.
Votre roman est coloré de déterminisme. Avez-vous été influencé par le naturalisme de Zola pour tracer la destinée de vos personnages ?
Je travaille effectivement avec le déterminisme socio-économique, parfois politique. À d’autres moments, même avec le contexte environnemental puisqu’un séisme intervient dans le texte. Mais je m’efforce que ce ne soient pas les seuls ressorts : il n’y a rien que les personnages ne puissent affronter. Au contraire, Belliqueuse Louissaint, la première à apparaître dans le roman, va toujours au devant de son destin. Elle ne se laisse pas faire, même face à toutes ces contraintes, à commencer par son genre : c’est une femme qui élève ses enfants pratiquement seule, qui n’est pas très riche, mais tout ce qui lui arrive dans le roman, elle en a quelque part l’initiative. Concernant mes attirances littéraires, je ne pense pas être influencé par le réalisme du XIX
e
siècle français. Mes influences sont peut-être plus à trouver du côté de ce qu’on appelait jadis le réalisme merveilleux ou magique, et encore. Je pense que c’est tout simplement la réalité elle-même qui est magique et merveilleuse ! J’ai un héritage de littérature haïtienne où ce déterminisme est bien présent ; mais je m’en défends parce que je fais de mon mieux pour ne pas verser dans la surdétermination.
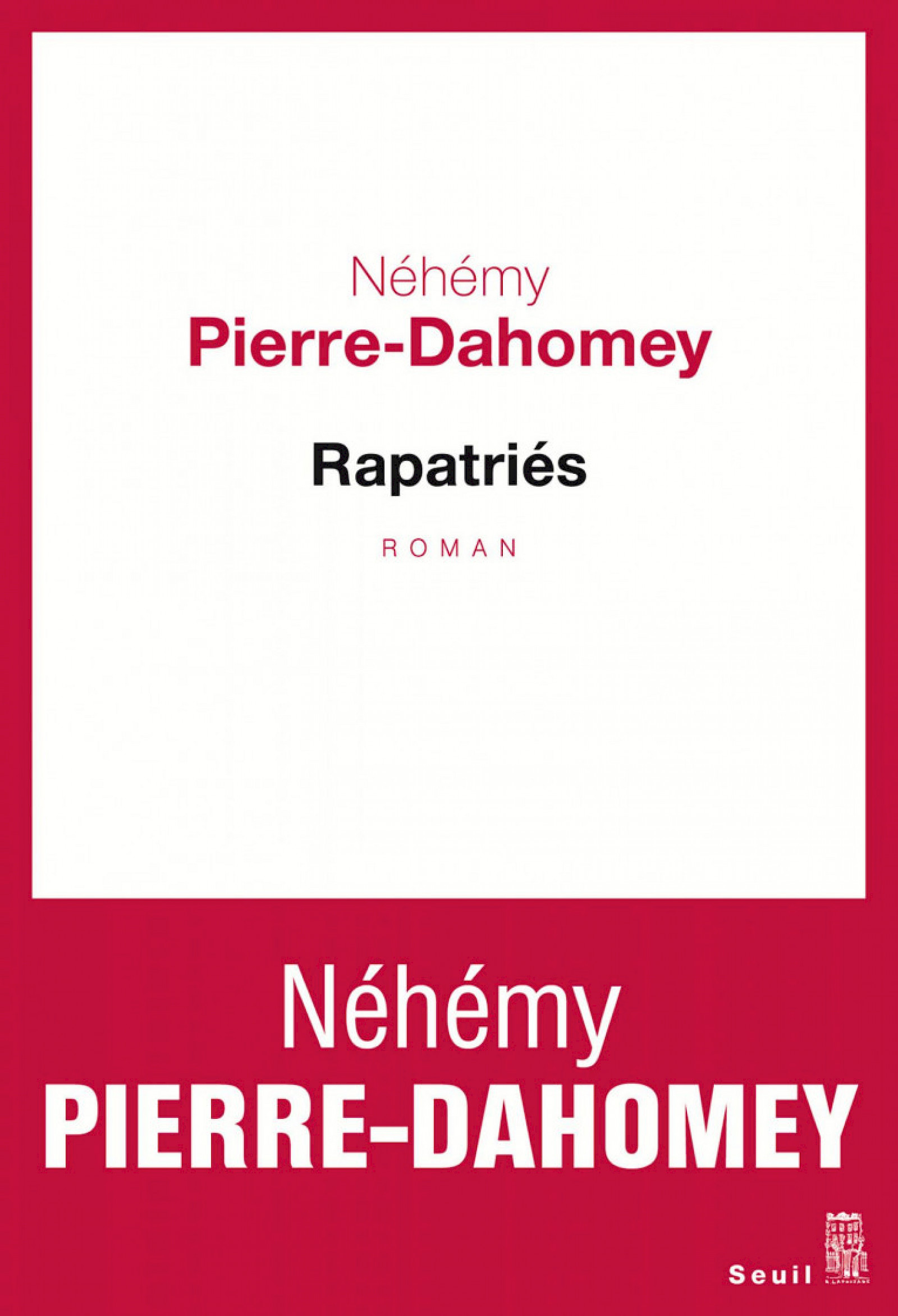
Une des façons qu’ont les personnages de sortir de rails qui sembleraient tracés, c’est leur façon d’endosser leur nom puis d’en changer. Ils transitent d’identité.
Tous ces jeux sur les appellations sont clairement un vecteur de contre-déterminisme. On naît tous dans un nom – comme on dirait qu’on est
dans
le langage – mais à un certain moment, mes protagonistes décident d’en changer en fonction de ce qui leur arrive, de ce qu’ils veulent devenir. Dans le cas de Belli, c’est par contre la rue qui la désignera autrement. Dans le nom « Mwanzè Filo »,
mwanzè
, c’est mademoiselle. Et Filo, c’est son côté philosophe des rues, déambulatoire. Je suis vraiment passionné d’onomastique. On naît avec un nom de famille, un clan auquel on appartient : ce qui nous laisse une petite marge pour créer notre personnalité, c’est notre prénom, même s’il est très largement partagé. Choisir de se rebaptiser, pour moi, c’est une initiative symbolique extrêmement forte. Bélial, fille de Belli et longtemps appelée « la petite dernière », se choisit seule son prénom : ça revient à dire qu’elle s’est faite elle-même. En s’isolant beaucoup une fois adoptée en France, elle cherche à se créer une personnalité. Même si je n’explique pas énormément comment elle en est arrivée à la danse, je pense qu’on sent que c’est un choix très assumé, une façon d’éloigner les tourments de l’esprit, de faire corps.
Dès la scène d’ouverture, vous n’épargnez ni le lecteur ni votre personnage principal, prise dans la spirale d’une traversée avortée vers les États-Unis. Doit-on selon vous prendre ou non des pincettes quand on écrit ?
Il ne faut pas martyriser celui qui vous lit
(rires)
. Mais à un moment, il faut pouvoir le conduire à la vérité de l’histoire qu’on lui raconte. Si on lui narre une histoire légère, le tout n’est pas de faire des blagues à chaque page : c’est davantage l’amener à voir ce qu’il y a de drôle dans ce qu’on lui donne à lire. Si l’on raconte une histoire tragique – dans le sens le plus grec du terme, où les personnages affrontent leur destin –, il faut l’amener par tous les moyens, y compris durs, à voir en quoi cette situation est intenable. Belli commence par jeter un enfant à la mer, ce sont les premières pages. Ç’a été un travail de finesse : j’ai beaucoup hésité, réécrit cette scène – il ne fallait ni épargner, ni tomber dans le pathos – mais je me devais de donner à lire ce qui avait eu lieu dix ans avant le roman, et qui influerait sur le reste. Si on ne comprend pas qu’elle a fait un voyage aux États-Unis qui n’a pas abouti et qu’elle a eu à jeter son enfant à la mer, on ne comprendra pas pourquoi elle finira par s’appeler Mwanzè Filo et devenir folle quand on va lui refuser un visa.
Vous dites que Belliqueuse ne se laisse jamais faire, mais la religion lui tombe dessus comme un dernier recours, et ne lui apporte pas tant de réconfort. Comment souhaitiez-vous traiter de cette question ?
Je ne fais pas partie de ces Européens qui ont une peur bleue de la religion, de tout ce qui est sacré.
Je pense que ce sont des phénomènes qu’il ne faut pas disqualifier : ils indiquent des pistes formidables pour un romancier. Certes, Belli est prise de cours par la religion, ça survient soudainement dans sa vie, mais le peu de rapport qu’elle a eu à Dieu était réel. Il en va de Belli comme de tous les croyants : c’est un mot qui donne l’impression qu’il y a une distance entre la personne et ce en quoi elle croit, mais je pense que les fidèles vivent vraiment avec l’entité ou la divinité au plus près. Ce qui veut dire que Belli, en épousant la religion, retrouve un certain réconfort, réel mais insuffisant.
Cela l’amène à faire des choix
assez radicaux : on la convainc de remettre le sort de ses filles entre les mains d’autres gens, elle se persuade que, dans une famille blanche, elles auront une existence meilleure.
Elle ne le fait pas pour des raisons économiques : elle le fait dans une idée de renouveau spirituel, elle veut se départir de tout et recommencer à son avantage. C’est du moins ce qu’elle croit. Elle se prend les pieds dans le tapis : cette autre vie meilleure que lui promet quelque part le message biblique, elle n’en verra pas la couleur. Elle fait adopter ses enfants sans même en parler à leur père. Avant le séisme, elle se rendra compte que sa décision était sans doute trop hâtive. Belliqueuse est quelqu’un qui exagère, c’est comme ça que je l’ai façonnée. Elle sort de ses gonds en permanence. On lui donne une petite impulsion spirituelle, elle décide de faire
tabula rasa
. Quand on lui tend la main, elle prend toujours le bras. Elle finira par passer d’un trop plein à un creux criant, comme c’est le cas pour tous les personnages excessifs.
À travers les yeux de Pauline, vous donnez à voir un certain rôle des ONG en Haïti. C’est un personnage animé de très bonnes intentions, mais lorsqu’elle adopte Bélial, elle cherche aussi à combler un manque, non ?
Je suis tout de même content que vous mentionniez son bon fond. Dans beaucoup de romans, les coopérant/es des ONG apparaissent : c’est un corps de métier très représenté en Haïti, encore aujourd’hui. C’est devenu une composante essentielle de la vie sociale. Certaines organisations – et ça se lit jusque dans certains rapports – sont par contre uniquement là pour faire leurs choux gras. Mais pour moi, ces dérives ont peu d’intérêt narratif. J’aurais été incapable de critiquer une entreprise tout à fait critiquable : pour moi c’est le rôle du journaliste. Celui de l’écrivain, pour moi, est de toucher le paradoxe de ceux qui essaient vraiment d’aider. Pauline Lagarde voudrait vraiment faire quelque chose à Port-au-Prince : quand elle s’est engagée dans son ONG vingt ans auparavant, ça n’était pas une question d’argent. Mais elle se retrouve prise dans un engrenage : le pays est devenu un terrain de travail divisé en zones, plus quelque chose de vivant.
L’adage « L’enfer est pavé de bonnes intentions » serait souvent vrai dès qu’il s’agit de situations humanitaires ?
Beaucoup de gens peu pragmatiques débarquent en Haïti, faisant plus de mal que de bien, pensant qu’il suffit d’être charitable pour aider. Ils ne sont pas préparés à un tel choc, et n’ont pas le savoir-faire pour y faire face. Plus loin encore dans le spectre, il y a ceux qui sont hypocrites dans leur bonté, comme madame Estimé : elle représente assez bien la bourgeoisie guidée par les bonnes œuvres. Elle s’érige quelque part en justicière de la misère des « pauvres petits enfants », ne manquant pas de prendre sa commission à chaque adoption : je pense qu’elle ne se pose pas la question du bonheur de ceux qui passent entre ses mains. Elle est persuadée que l’adoption d’un enfant noir pauvre par des parents blancs plus aisés est d’office une bonne chose. Dans les faits, ce n’est pas aussi évident que ça. La charité n’est pas un bon socle pour l’intervention sociale.
Le motif qui clôture votre roman, c’est le déraillement – dans tous les sens du terme – de Belli. Est-ce que vous voyez la folie comme une migration de l’esprit ?
Tout à fait, c’est un exil intérieur ! On visite d’autres territoires de soi-même, en soi-même. À un certain moment, Belli s’est dépaysé en elle-même, au point qu’elle a ressenti ce besoin physique de marcher, de partir en errance. Mais c’est le cas pour les autres : on négocie tous un peu – vous, moi, et tous mes personnages – avec une psychologie de travers. Sobner est alcoolique, très sensible. Diogène a le cœur dans la main mais ne sait pas ce qu’il fait dans la vie. Bélial est un genre de phénomène mystérieux. Si vous rencontrez quelqu’un qui est vraiment très droit et n’a aucune déraison, inquiétez-vous ! Ça risque d’exploser à bien plus grande ampleur
(rires)
.
Votre roman partage différents motifs avec
Tropique de la violence
(Nathacha Appanah à Maurice), avec
Petit Pays
(Gaël Faye au Rwanda) ou encore avec
Anguille
(Ali Zamir aux Comores)… Ça me donne à penser que vous élargissez tous le champ de la littérature française.
Absolument, la littérature connaît une déterritorialisation spectaculaire ! Cela ne tient d’ailleurs pas qu’aux auteurs dits francophones, aux auteurs qui écrivent en français hors-Hexagone. En France-même, on amplifie les choses, on brouille les cartes : j’ai lu récemment
Les Veilleurs
de Vincent Message, qui se passe dans une ville dont on pourrait supposer que c’est New-York mais ça reste incertain. Son second,
Défaite des maîtres et possesseurs
, se passe dans le monde où l’on est, mais complètement déterritorialisé, parce qu’habité par d’autres êtres, pas du tout humains. J’ai lu aussi dernièrement Jean-Baptiste Del Amo, son histoire se passe à Cuba. La littérature vit cet éclatement des lieux et c’est tant mieux ! Mon travail va d’ailleurs peut-être évoluer vers un certain brouillage : ne pas trop insister sur quel siècle, quel pays, quelle terre. Tout simplement parce que le narratif n’en a pas nécessairement besoin ! J’ai aimé des auteurs dont je ne soupçonne même pas la ville d’origine ou de résidence. Et d’autres qui vont jusqu’à créer des territoires littéraires fictifs, comme Gabriel García Marquez avec Macondo, dans
Cent ans de solitude
.
