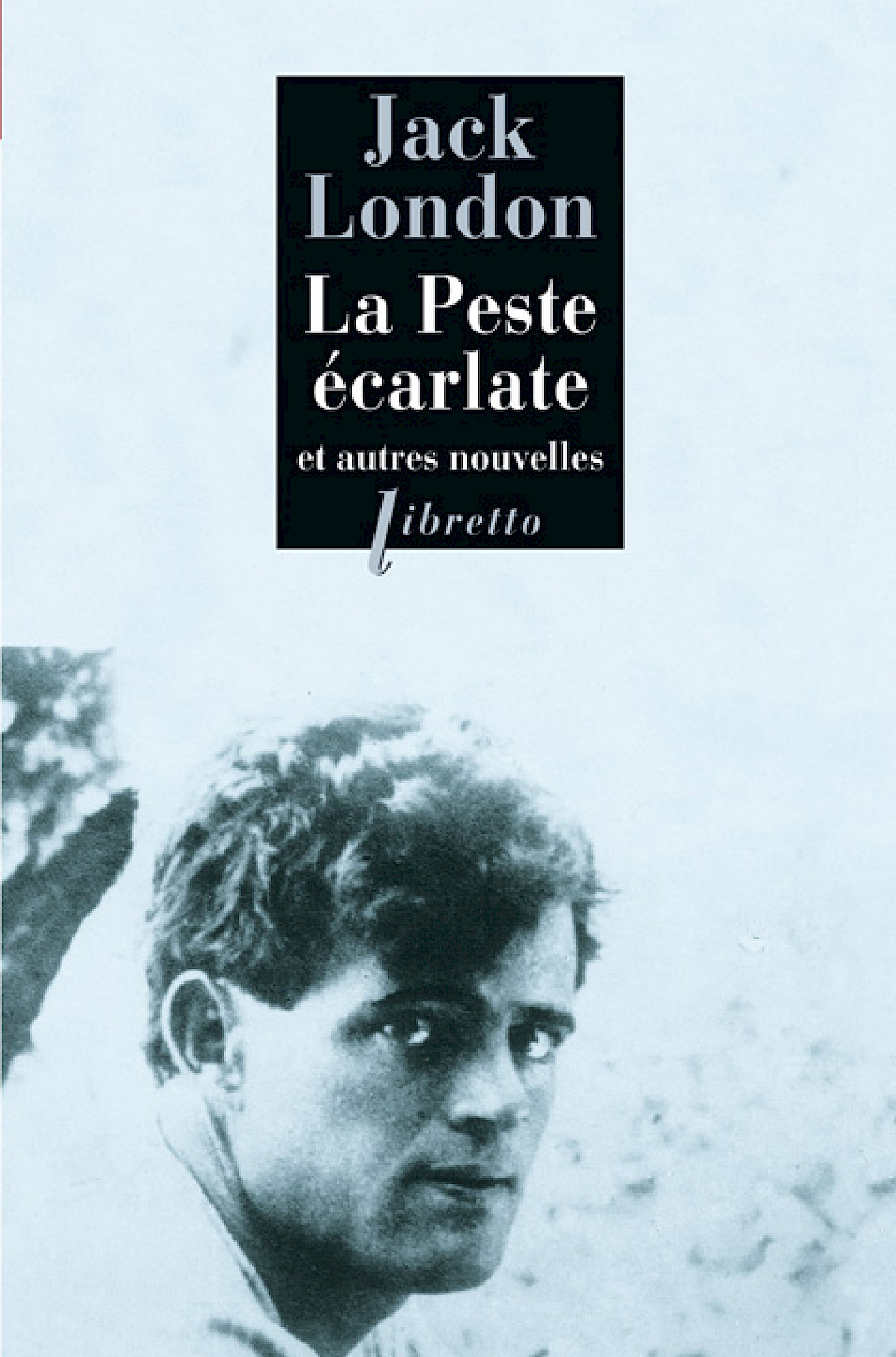
La Peste écarlate rassemble quelques nouvelles méconnues de Jack London, le formidable auteur du Loup des mers , de Croc-Blanc et de l’Appel de la forêt . À découvrir !
Alors que beaucoup de lecteurs réduisent Jack London à un romancier des grands espaces sauvages (la forêt, la mer…), sa plume a exploré bien d’autres horizons. Comme ici le fantastique, l’anticipation, la science-fiction.
Jack London n’est pas pour rien considéré par d’aucuns comme l’un des plus grands conteurs de tous les temps, à l’égal d’un Dumas ou d’un Stevenson.
Dès la première nouvelle de ce recueil, la Peste écarlate , nous voilà emportés par son art quasi cinématographique. Accrochés à sa caméra, nous plongeons dans un paysage où, si la civilisation apparaît en filigrane, la nature a repris ses droits. « Le chemin suivait l’ancien remblai d’une voie ferrée. Mais depuis bien des années aucun train ne l’avait parcourue (…) Çà et là, un morceau de fer rouillé apparaissait, indiquant que, sous les buissons, rails et traverses subsistaient. » Une description qui n’est ni trop courte ni trop longue, mais surtout signifiante, car chaque détail cache son lot d’informations. Puis deux personnages pénètrent dans le champ visuel, la caméra se rapproche et nous révèle un vieillard et son petit-fils, de nouveaux indices qui s’attachent à l’arrière-plan de notre histoire. Celle-ci, dans quelques lignes, démarrera et nous aurons la confirmation de ce que nous appréhendions.

Nous sommes dans un lointain avenir, en Amérique, en 2073, dans un monde retourné à la sauvagerie. Le vieillard, un certain… Smith, un ancien professeur d’université de San Francisco, vit entouré d’enfants qui ne le comprennent pas. « Les jeunes garçons étaient de vrais petits sauvages et ils ne connaissaient que l’humour cruel du sauvage. » Ils ne respectent plus rien, à commencer par l’âge, et ignorent les anciens concepts. « De l’argent, grand-père ? Qu’est-ce que c’est ? » (p. 22) ; « L’éducation, c’est quoi ? »
Alors, Smith, qui se veut le garant des valeurs d’hier, va entamer la narration du drame qui a frappé la Terre en 2013, lorsqu’une mystérieuse épidémie, la peste écarlate, sonna le glas de l’humanité et de la civilisation. Le récit qui suit est une sorte de chronique de fin du monde, un conte apocalyptique terrifiant. « Tout ordre social, toute loi avaient disparu. (…) Partout régnaient le meurtre, le vol et l’ivresse. »
Quel sera le destin de nos protagonistes ? Car, si Smith a caché une bibliothèque entière dans des grottes, ouvrant la perspective d’une renaissance, London paraît s’interroger sur le sens de celle-ci. A quoi bon lutter si le chaos, la mort, toujours, reviennent et l’emportent ? C’est que notre auteur, naguère socialiste et idéaliste, a subi le cataclysme de la Première Guerre mondiale et vu se délaver les couleurs utopiques de l’Internationale. Ses réflexions, semées de ci de là, font peur. « Pour sauver la masse, il fallait sacrifier l’individu. » Ou : « Je n’allais pas au secours de l’épicier. Le temps n’était plus où l’on se dévouait pour les autres. » Ou encore : « En plein cœur de notre civilisation, dans nos bas-fonds et dans nos ghettos d’ouvriers, nous avions fait naître une race de barbares, de sauvages ; et maintenant ils profitaient de notre funeste situation pour se retourner contre nous, comme les fauves qu’ils étaient, et ils nous détruisaient. »
Désabusé, London ? Pour un temps, oui, mais l’on appréciera la modernité d’un texte qui préfigure tout de même la Peste de Camus aussi bien que les films de zombies.
« Ça y était ! » Dès les premiers mots du Dieu rouge , nous sommes précipités dans un présent brutal et mystérieux, au cœur de l’action, appréhendée depuis les yeux d’un certain Bassett. Quelles sont la nature et l’origine de « ce bruit prodigieux, remplissant l’espace (…) rugissement d’un Titan du vieux monde tourmenté par la douleur et la colère » ? Tandis que le récit se déploie, haletant, il se voit entrecoupé de mille et un flashback, à la manière de la célèbre série Lost . Et des notations nous éclairent progressivement sur le personnage, son environnement, les éléments du drame. Nous sommes sur une île inhospitalière, Guadalcanal. Bassett faisait partie d’une expédition chassant un papillon des plus rares, mais il s’est éloigné de la plage où son navire avait accosté pour aller à la rencontre du son . Que sont devenus les autres ? Il ignore leur sort, sauf celui du fidèle moussaillon, décapité par les cannibales qui l’ont recueilli, lui, fascinés par son fusil. Loin de se fondre parmi ceux-ci, il ne survit, vieilli et malade, que pour assouvir sa curiosité : découvrir le Dieu rouge autour duquel sont fédérées douze tribus et qui émettrait le son . Quitte à braver le tabou protégeant l’aire sacrée. Quitte à risquer sa tête ou celle de qui l’aidera. Mais que va-t-il donc trouver ?
Au-delà des qualités narratives du récit, on appréciera la panoplie de l’écrivain, notamment quand il se plaît à décrire ce son aussi énigmatique que fantastique, « d’une douceur infinie, (…) d’une ampleur si puissante que seul un monstre au gosier d’airain eût pu le lancer ». Ou le Dieu rouge lui-même.
On admirera surtout l’élévation spirituelle de la nouvelle. De fait, au départ, l’exploration se veut très prosaïque : « il reviendrait à la tête d’une expédition (…) dût-il anéantir toute la population de Guadalcanal », parce qu’il veut satisfaire son ego et décrocher des lauriers. Et l’on songera ici à la cupidité des protagonistes de King Kong , à la frivolité de ceux du Jurassic Park . Mais, en cours de route, la recherche se fera quête. Quête de l’absolu, du mystère de l’univers. Et l’on s’étonnera de la modernité d’un London, écrivant en 1916, et qui envisage l’existence d’intelligences extraterrestres, préfigurant le formidable 2001, l’Odyssée de l’espace , avec l’atterrissage d’un objet qui apporte l’insolite, le transcendant, le métaphorique, le métaphysique, le questionnement du monde. Alors qu’en cours de route, l’athée London n’aura pourtant pas hésité à parodier la Bible. Que l’on songe aux douze tribus de cannibales, clin d’œil aux douze tribus d’Israël, ou à ce son qui évoque indubitablement les trompettes de Jéricho : « Les remparts des villes (…) pourraient fort bien s’écrouler devant la puissance impérative d’une pareille sommation. » Et que dire du fruit de l’arbre à pain, interdit à la fiancée de Bassett, Balatta, comme celui de la Connaissance l’était à Ève dans le jardin d’Éden ?
Une nouvelle remarquable, qu’on se le dise, à lire comme le testament de l’auteur. Car celui-ci, au milieu des malheurs ou de la maladie qui, bientôt, l’emporteront, dépasse le pessimisme de ses dernières années et retrouve l’énergie de ses grands romans, et la dépasse peut-être. Car, semblable à Bassett, il tend la main vers l’au-delà, l’or du temps, l’étincelle de pureté qui sourd à travers la fange. En route vers le Grand Mystère, la fusion apaisante dans le Grand Tout. Le Graal ?
Dans la troisième nouvelle, Qui croit encore aux fantômes ? , London nous présente un quatuor d’amis. L’un d’eux, George, veut convaincre les autres de l’existence des esprits et leur propose de passer une nuit dans une maison hantée. Quand Pythias et Damon pénètrent, les premiers, à l’intérieur de la sombre bâtisse, savent-ils qu’elle fut jadis le théâtre d’une partie d’échecs débouchant sur un meurtre ? A se confronter avec des forces inconnues, ne risquent-ils pas de revivre la scène ?
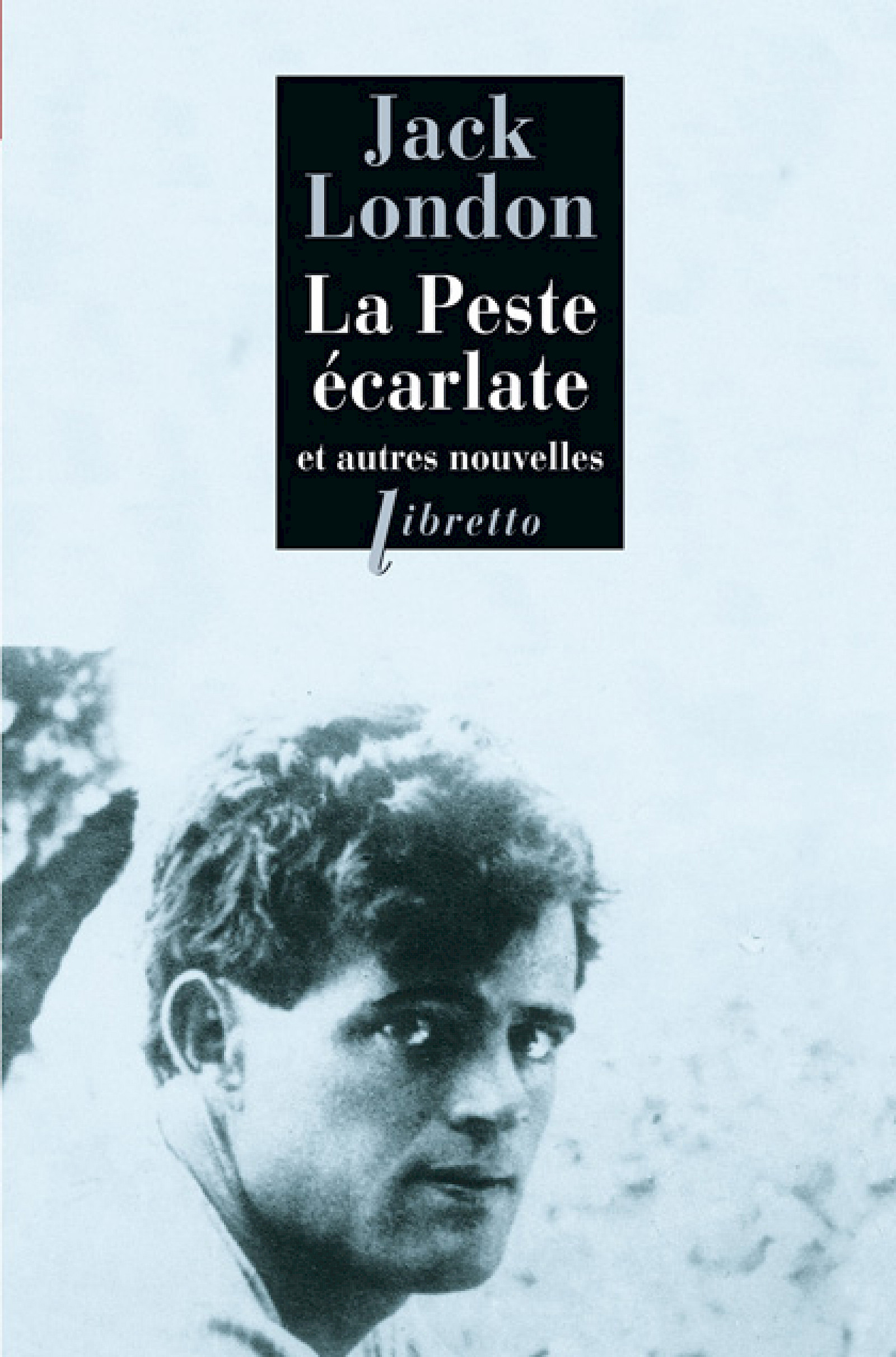
Amusant, ce texte, contrairement aux deux précédents, date de la jeunesse de l’auteur (il n’a alors que dix-neuf ans !) et se révèle un peu naïf dans son introduction et son épilogue mais très prometteur et même très réussi dans la peinture de l’irruption du fantastique.
Dans Mille Morts , autre nouvelle de jeunesse, London atteint déjà une impressionnante maîtrise narrative. « Il devait y avoir une bonne heure que j’étais dans l’eau. J’avais froid, j’étais littéralement épuisé, et une terrible crampe me tenaillait le mollet droit – je pensais que ma dernière heure était arrivée. » Il y a du Poe, et du meilleur ( Gordon Pym , le Puits et le pendule ), dans ce départ. La suite nous plongera dans un récit hallucinant d’humour noir et de burlesque. Car le héros, un fils déchu, retrouve un père qu’il avait quitté antiquaire fortuné et qui s’est transformé en savant dément, « le spécimen le plus dangereux de cruauté commise de sang-froid qu’il (lui) fût jamais donné de voir ». Car que rêve-t-il d’accomplir, ce père dénaturé ? « Prouver la possibilité de rendre la vie à un organisme qu’elle avait déjà déserté. » Donc, notre parangon de la paternité n’aura de cesse de… tuer son rejeton, pour le ressusciter ensuite. Comment cette collaboration aux allures de duel œdipien renversé va-t-elle tourner ?
Enfin, dans la Seconde Jeunesse du major Rathbone , un autre texte précoce qui poursuit la veine du précédent, le narrateur raconte comment il fut « mêlé à l’une des plus étranges expériences scientifiques » de tous les temps. De fait, avec un ami, il a joué aux apprentis-sorciers et découvert « le procédé de rajeunissement », qu’il va appliquer à un vieux major. Le récit pourrait basculer dans l’horreur, façon Docteur Jekyll et Mister Hyde ou Frankenstein , mais London en tire un conte drôle et optimiste, dénué d’ambiguïté, parce que le jeune auteur croyait encore alors passionnément au progrès.
Avec la Peste écarlate , la collection Libretto poursuit la réédition de l’œuvre (quasi) complète de Jack London. Et l’on ne remerciera jamais assez un éditeur comme Phébus de ce patient ouvrage de réhabilitation littéraire de la Grande Fiction, celle qui conjugue le plaisir de l’évasion et de l’aventure aux charmes du talent et de l’art. Oui, si vous cherchez des livres qui ont de l’esprit et du cœur, c’est-à-dire de l’âme, ce qui est le plus précieux des trésors, explorez cette maison. Des caves aux greniers, de Wilkie Collins à Palliser, en passant par Joseph O’Connor et… cent autres, il y a de quoi s’enivrer à satiété.
Philippe et Julien-Paul Remy