Le son, c’est la guerre
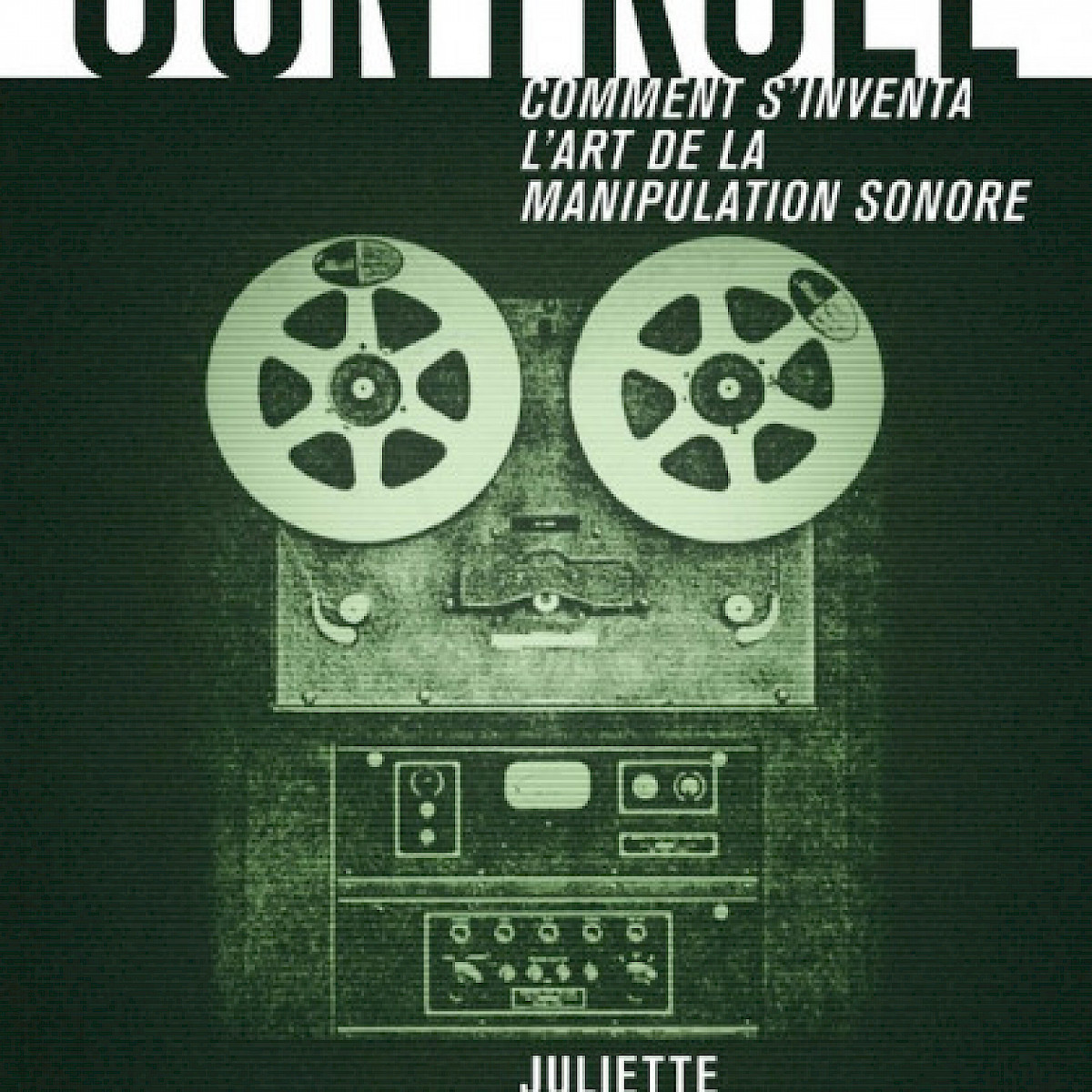
Dans son second livre,
Dans son second livre,
Contrôle. Comment s’inventa l’art de la manipulation sonore, Juliette Volcler convoque la figure trouble d’Harold Burris-Meyer, ingénieur, homme de théâtre et comportementaliste convaincu. En s’accrochant à ce fil rouge, l’auteure nous donne à lire l’essentiel impact du son dans le milieu de la scène, des lieux de travail et des champs de bataille et la tentation qu’eurent certains de s’en servir pour nous conditionner.
Déjà auteure d’un précédent essai – le Son comme arme. Les Usages policiers et militaires du son –, la chercheuse circonscrit ici son territoire d’étude aux États-Unis et s’intéresse plus particulièrement à la phase industrielle du contrôle sonore, au moment où le capitalisme se sert de la technologie pour forger un certain rapport au monde.
La scène
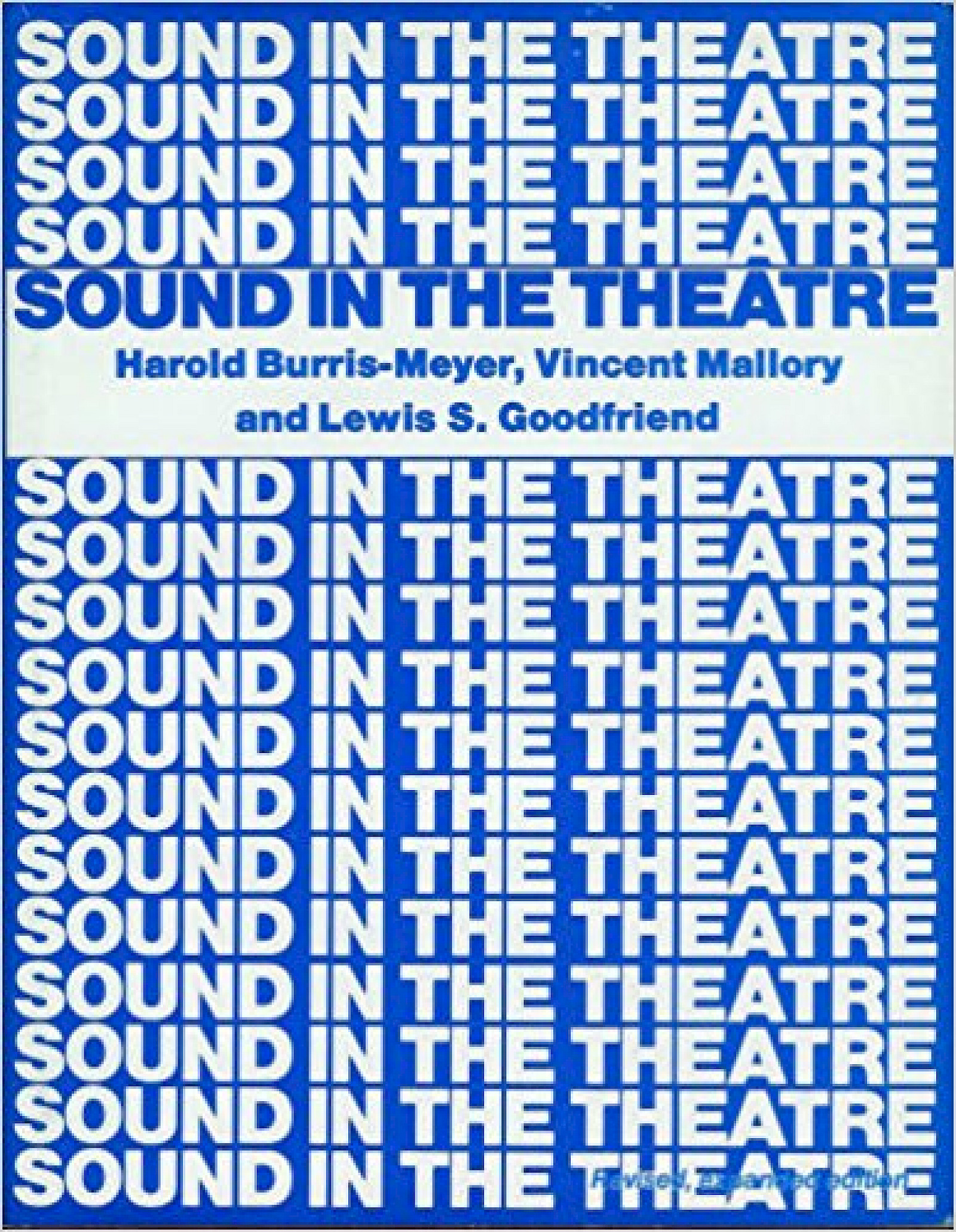
La figure principale de son récit, Harold Burris-Meyer devient en 1930 le directeur du théâtre de l’Institut Stevens de technologie et c’est cette année-là que naîtra son obsession majeure : le contrôle du son, en mesure de provoquer le contrôle du public et de ses émotions. Allumer les spectateurs grâce à ses inventions ne suffit bientôt plus à ce prosélyte du réalisme sonore pour qui « un son mal diffusé est pire qu’un décor qui s’effondre » : il veut être en mesure de quantifier les réactions. De pouvoir reproduire, voire programmer les instants de grâce ou d’effroi pour rendre les spectacles plus impressionnants et par la même occasion, plus rentables.
Volcler nous rappelle à bon escient que la vision pragmatique de l’ingénieur théâtral n’est pas si isolée : si à la même époque, Disney investit dans la technologie sonore, c’est qu’il pressent veau, vache et couvée de dollars si elle est bien exploitée. En novembre 1940, après dix années de recherches autour de la représentation animée de la musique – on se souvient notamment des Silly Symphonies , programmes courts toujours peuplés d’instruments étonnants – et du son multicanal, le studio de tonton Walt est en mesure de sortir son magnum opus , Fantasia . Les deux heures d’hippopotames en tutus, centaures et balais qui gigotent sont transcendées par un système de 6 800 kilos d’équipement, le Fantasound , qui préfigurera le son surround .
L’industrie
Reprenons le sillon avec notre sherpa, cette fois pour explorer les coulisses du monde du travail : à la fin des années 1930, Harold Burris-Meyer, même si très occupé par ses recherches sur l’acoustique théâtrale, devient consultant pour une entreprise florissante, Muzak Corporation. La compagnie s’était alors donné les moyens d’imposer sa domination sur la musique d’ambiance : réseau large de distribution, département de recherche, usine de pressage, label, studio d’enregistrement, maison de production radiophonique. Restaurants, magasins ou moyens de transports : jusque dans les années 1980, tous vibrent au son des compilations Muzak, « une sorte de liquide amniotique qui nous entoure sans jamais nous surprendre, jamais trop forte, jamais trop silencieuse, et toujours présente ». Une ubiquité qui, à force, rendra l’antonomase « muzak » synonyme de « musique d’ascenseur », voire même de soupe, avant que le fusil soit légèrement changé d’épaule pour devenir davantage de la personnalisation sonore d’espaces.

Quel fut le rôle de notre homme au sein de cette toute-puissante industrie ? Burris-Meyer était chargé de la rationalisation musicale. En 1937, était parue en Grande-Bretagne – à la suite d’autres recherches à travers les âges visant à démontrer la corrélation entre phénomènes sonores et physiologiques – une étude sur l’impact de la musique sur la productivité, assortie de données quantifiées, permettant au patronat une application directe. On équipe alors les usines de la perfide Albion de systèmes de haut-parleurs, permettant à la BBC d’émettre tout au long de la journée son programme Music while you work .
Muzak s’engouffre bien évidemment également dans cette voie qui, comme le rappelle admirablement Juliette Volcler, « parachève un travail de dépossession acoustique ». Là où jadis les ouvriers ou les esclaves chantaient pour s’exhorter mutuellement au courage ou faire catharsis face à des tâches aliénantes, la diffusion de musique standardisée, envisagée comme levier d’efficience par leur hiérarchie, les assigne à leur labeur et au silence. À travers les programmes diffusés dans les usines, Muzak cherche à influencer autant l’émotion que le temps des gestes et développe sa théorie de la progression du stimulus, imaginant une musique organisée en quarts d’heure d’intensité diverse et savamment distillée pour lutter contre la courbe de fatigue de l’employé.
La guerre
De cette vision disciplinaire de la musique dans les fabriques de matériel militaire à l’orée des années 1940 aux tranchées elles-mêmes, il n’y a finalement qu’un petit pas. Harold Burris-Meyer, toujours aussi convaincu que « le son exerce une influence profonde sur les réactions et les émotions de l’homme » trouvera dans la guerre un terrain d’expérimentation pour prouver ses théories. Non sans quelques ratés, les rumeurs sur les armes acoustiques soi-disant déjà existantes se révélant parfois décevantes – et ces anecdotes que nous conte l’auteure prêtent à rire : qu’importe leur taille et l’altitude depuis laquelle elles sont jetées, des bouteilles balancées depuis un avion ne provoquent aucun bruit susceptible de faire fuir l’ennemi au sol. Quant aux bombes sifflantes inspirées des techniques des stukas allemands, elles signalent un peu trop précisément à la victime où elles vont tomber.
Bien plus efficaces semblent avoir été les tentatives du projet Polly, destiné à faire capituler les ennemis japonais : on munit trois avions de haut-parleurs diffusant des incitations à la reddition, des promesses de soins et de vivres – l’opération connut un tel succès qu’elle fut réitérée lors de la guerre de Corée en 1950.
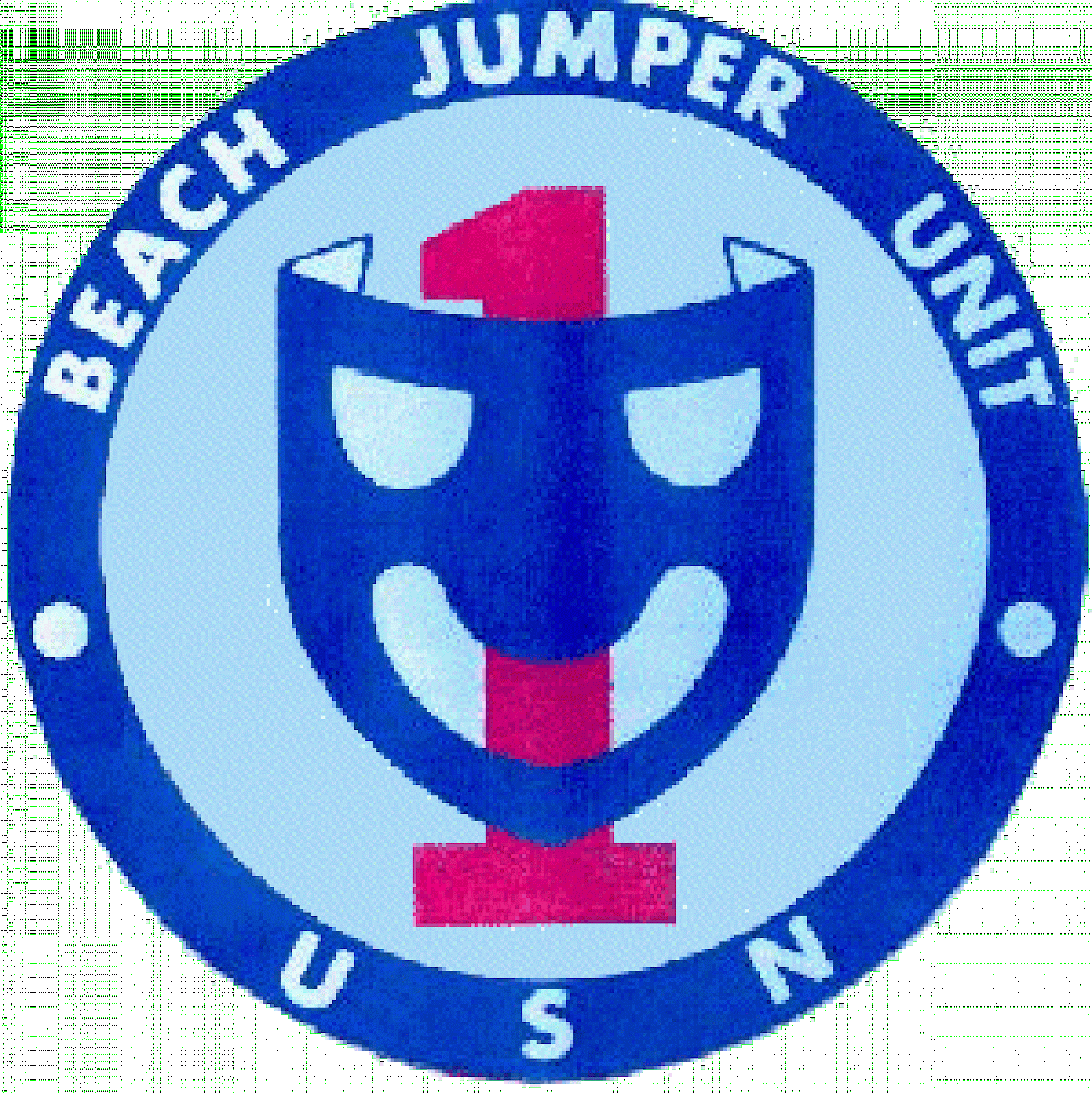
Burris-Meyer, nommé en 1945 responsable de la section F-28 (spécialisée en désinformation), participa également à ces conflits dans le Pacifique avec les Beach Jumpers (unité spécialisée dans le leurre et les opérations psychologiques), usant notamment des armes de harcèlement sonore : cris de tigres, voix d’outre-tombe, effets spéciaux, etc. Ensuite, après une période où il était devenu théoricien de la désinformation, il retourna à la vie civile, continuant à brouiller les pistes et les activités, collaborant notamment avec la toute nouvelle CIA… Mais aujourd’hui encore, les dossiers le concernant sont classés secrets.
Grâce à cet homme mi-Méliès mi-tayloriste et presque plus énigmatique qu’un personnage de fiction, Juliette Volcler parvient à nous tenir en haleine tout au long d’un livre qui ne manque ni d’arcanes retors ni de spécificités techniques. C’est peut-être la preuve qu’il est grand temps d’aborder à nouveau certains épisodes de l’histoire contemporaine à travers le prisme sonore (parent nettement plus pauvre que l’image), porteur de révélations étonnantes et d’anecdotes qui ne manquent pas de sel.
Rencontre avec Juliette Volcler ce vendredi 10 mars 2017 à 19 heures la librairie Par Chemins (Rue Berthelot 116, Forest) .