Moments charnières d’une émancipation féminine

Dans le cadre de la campagne Lisez-vous le belge ? , Karoo a voulu mettre à l’honneur une autrice belge ayant récemment publié son premier roman. Une belle opportunité de rencontrer Sophie d’Aubreby, autrice de S’en aller , lors d'une interview afin d'aborder plus en détails son roman qui avait déjà fait l'objet d' une critique sur Karoo .
Cette rencontre enrichissante aborde les thèmes de la désobéissance, de l'émancipation et des moments de basculement d'une vie. Une discussion abordant également la place de l'art pour questionner la norme et figurer des représentations plus diverses et inclusives.
Bonjour Sophie, enchantée de te rencontrer. J'ai eu l'occasion de lire
S'en aller
pour Karoo, et je suis à présent ravie d'en apprendre plus au sujet du roman et du processus d'écriture l'entourant. Mais tout d'abord, dans ton travail, exerces-tu déjà des compétences rédactionnelles, nécessaires à l'élaboration d'un roman ?
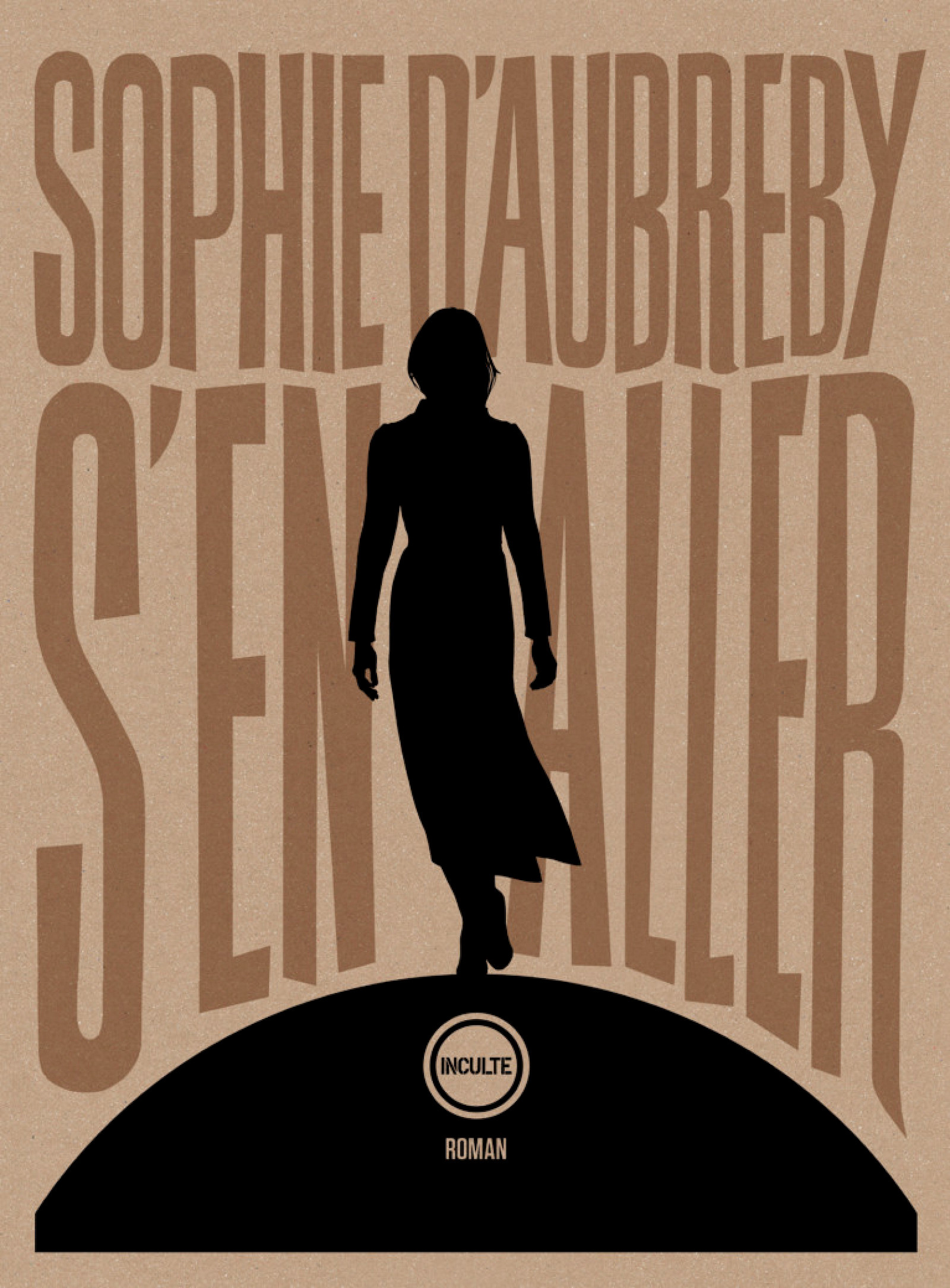
Bonjour Francesca. Oui, j’ai travaillé pour des agences de publicité pendant plusieurs années, avant de bifurquer dans le non-marchand. J’ai toujours plus ou moins gravité autour de la communication, donc ça impliquait de la rédaction, mais pas d'un point de vue culturel et encore moins d'un point de vue littéraire. Ce roman est fait d'improvisations et d'essais, parce que je ne peux pas dire que la publicité, avec ses formes très courtes et efficaces, m’ait formée aux formats plus longs. J’ai travaillé dans la pub parce que c'était une manière de gagner sa vie en écrivant, jusqu’au moment où j’ai ressenti l’envie d’écrire pour moi.
C'était peut-être l'envie de créer un projet individuel, loin des commandes que l’on te passe habituellement ? Une occasion de te réapproprier cet espace de créativité et de ne pas le mettre uniquement au service des autres, mais de l'utiliser pour toi et pour transmettre quelque chose de personnel ?
Bien sûr. Oui, c'est personnel, un roman. J'ai l'impression qu'on y met beaucoup de soi : si ce n’est dans la narration, au moins dans le travail que ça demande.
Cela fait écho à une des questions que je voulais justement te poser, à savoir qu'il y a forcément une part de nous dans chaque travail d'écriture. Quelle part de toi peut-on retrouver dans ce roman ? Est-ce que c'est le côté féministe, rebelle, aventureux ?
Ce sont en effet des thèmes qui me sont chers. Je ne peux pas dire que je sois aventureuse, par exemple. Pas du tout, je suis même plutôt très prudente. Donc la prise de risque était un sujet que j'avais envie d'explorer dans la fiction. Un trait qui, du coup, ne m'appartient pas en propre, mais qui est nécessairement déterminé par ma perception de ce que ça peut être. Le féminisme est évidemment quelque chose qui m'importe, et qui infuse l’histoire. On ne peut pas dire que Carmen soit féministe. À aucun moment dans le roman, elle ne prend conscience de ce qu'elle fait. On n'est pas dans une élaboration cérébrale, intellectuelle. Elle ressent des choses ‒ souvent de l'inconfort ‒ et elle réagit. Elle s'écoute, elle porte une très grande attention à elle - ce qui est encore aujourd'hui parfois inédit et rare (
rires
). Mais elle le fait. C’est ça qui m'intéressait, parce que c'est une question que je n'ai pas résolue. Où commence le militantisme ? Où est-ce que ça s'arrête ? La désobéissance, la résistance, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui déclenche le passage à l’acte, ce type de basculement-là ? C'est ça que j'essaye d'analyser au plus près.
Tu dis qu'elle est très à l'écoute d'elle-même et de ce qui l'entoure. Je trouve justement que ça passe beaucoup par les corps : le sien, mais aussi l'observation de celui des autres. Je trouve aussi que, par les mots, tu sculptes des images. C'est un récit très sensoriel : il y a d'une part la musique, en Europe et à Java, et d'autre part la danse. Les sens sont stimulés et c'est peut-être de ça aussi que Carmen s'inspire ? À travers les sens, elle s'approprie son corps individuel, mais aussi tel qu'il est inscrit dans la société, étant une femme du début du XIXe siècle. C'est la question de l’inscription dans cette fabrique sociale.
Bien sûr. C’est un personnage qui se situe en fonction de ce qu'elle ressent, pour qui être au monde revient à sentir la frontière entre elle et ce qui n'est pas elle. C’est l'affaire de sa vie de parvenir à identifier cette frontière-là. Je voyais le corps comme le point de départ ou comme un outil pour penser le monde : pour penser, il faut ressentir. Elle ressent la révolte avant de la penser, et ça la guide dans ce qu’elle accomplit ou dans ce qu’elle refuse. Le corps parle souvent bien plus vite que la conscience. Pour Carmen, c'est le cas tout au long de sa vie, elle reste à hauteur de ressenti et d'immédiateté. Et ça l'oriente, au fur et à mesure de ses actes, de ses choix et de son existence. Comme des vertèbres qui s'additionnent pour composer une colonne vertébrale.
Elle a tracé sa route à sa façon : elle savait qu'elle sortait des normes, de par sa relation avec sa grande amie, les voyages qu'elle a entrepris, le fait de s'émanciper de sa famille, de ne pas suivre le chemin tout tracé. Il y a toujours ce balancement entre le fait qu'elle sache qu'elle est hors de ce à quoi on s'attend qu'elle fasse et, en même temps, cette impulsivité qu'elle a de dire « J'y vais, je m'embarque sur un bateau de pêcheurs », alors qu'elle avait été jusque-là très conventionnelle. Et par rapport à ce qu'on disait sur le fait de suivre ses ressentis, c'est quelque chose de très moderne en un sens, parce que pendant très longtemps, on n'était plus connectés au corps et à l'émotionnel. Même maintenant, on ne peut pas dire qu'on ait basculé du tout au tout et que l'on maîtrise cet aspect émotionnel. Donc c'est très intéressant et c’est très moderne d'amener cette réflexion dans une échelle temporelle différente de la nôtre et de voir qu'elle a toujours été là quelque part, mais qu'on ne savait pas trop quoi en faire et comment l'aborder.
Au sujet de la place du ressenti et de ce qu'on en faisait, et de cette attention face aux émotions, aux impulsions, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment parler de linéarité. On peut dire qu'il y a eu des sortes d’oscillations et que l'entre-deux-guerres a été une période ‒ pour certaines femmes, en tous cas ‒ favorable à des trajectoires moins balisées et moins attendues. J'ai trouvé beaucoup plus d'exemples de femmes avec des vies atypiques que ce à quoi je m'attendais. Je ne saurais pas comment verbaliser ce ressenti justement, mais je crois qu'il y a eu des périodes qui se sont prêtées à des élans d'émancipation, davantage que celle qu’on vit aujourd’hui, où l’appel à être « singulièrement soi » vire parfois à l’injonction et où, dans le même temps, certains acquis féministes semblent fragiles et menacés.
N’est-ce pas aussi une histoire de contexte ? Car juste après la Première Guerre mondiale, les gens se sont relâchés, ont célébré, se sont offerts en quelque sorte une nouvelle identité ‒ beaucoup de femmes ont commencé à travailler à ce moment-là. Il y a eu un peu plus de liberté pendant une vingtaine d'années. Pour faire la fête, mais également pour se découvrir autrement.
Les
Roaring Twenties
!
Exactement. Une autre question me vient : tu dis avoir retrouvé pas mal de traces et d'histoires de parcours atypique de femmes entre les années 1920 et les années 1940. Cela a-t-il été facile de faire remonter ces histoires et ces archives à la surface ? Car cela relève également d'un travail d'archivage et de préservation de la mémoire de la vie des femmes à cette époque-là. Peut-être les femmes n'écrivaient-elles pas encore énormément, ne gardaient pas de traces de ce qui se passait dans leur vie ? Comment as-tu compilé les informations nécessaires pour l'écriture de ton roman ?
Oui, c'était une étape essentielle de l'écriture, ce travail de documentation. Je crois que je n'aurais pas pu basculer dans l'écriture sans avoir derrière moi un certain nombre de lectures et de recherches. Les études féministes, qui ne sont pas neuves, font ce travail d'archivage pour faire ressurgir des choses que l'histoire laisse dans les marges. Ce travail existe, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit encore complet. Il y a évidemment beaucoup d'archives, mais il faut les trouver, et ça demande beaucoup de temps et de moyens.
Comment as-tu mis tes recherches et tes réflexions en relation et organisé toute cette matière ?
Cela s’est fait comme j'ai pu le faire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, j’ai cherché, j'ai passé du temps dans certains musées. Dans le musée de la pêche à Coxyde par exemple, qui a été formidable et qui m'a fourni des archives, des photos, des informations. J'ai aussi passé du temps au musée royal d'Art et d'Histoire de Bruxelles, auprès d'une dame extraordinaire qui m'a parlé de l'Indonésie à cette époque-là. Et enfin aux archives de la Résistance à Bruxelles. Ensuite, ça s'est agrégé comme j'ai pu. Je ne me suis pas posé la question de l’ellipse dans la narration, par exemple. J'ai ajusté ma focale sur ce qui constitue un virage quand on le prend, qui ne ressemble pas forcément à un instant décisif au moment où il se produit. J’ai laissé de côté les petits jours et les petites nuits entre les instants charnières. Je crois que c'est cet intérêt précis, pour les basculements plutôt que pour ce qui les lie entre eux, qui a déterminé la manière dont le roman s'est agencé.
Il y a parfois des incohérences en lien avec la mémoire, que l'on peut également retrouver dans ce récit et ses ellipses. Parce que tu avais déjà fait ce travail de réfléchir à la mémoire, à la psychologie du personnage, pour établir comment on réagit dans ces moments-là. En fin de compte, est-on vraiment tout à fait structuré nous-même ?
Je ne connais personne d'entièrement linéaire, Carmen ne l'est pas non plus. Elle réagit souvent par réaction, et ça parle du lien qu'elle entretient au réel et à l'autre. Elle n'est pas capitaine sur son navire : elle se heurte à des gens, à des faits historiques et elle manœuvre là-dedans comme elle peut. Elle tente de se positionner en tant qu'individu avec son ressenti propre, au milieu d'un grand tissage de normes et de représentations collectives dont il est parfois difficile de s’extraire. On est petit face à la norme : c'est ça qui m'intéressait. Quand elle part en mer, il y a son référentiel bourgeois d’un côté, et l'émergence d'un syndicalisme marin de l’autre. Ce sont deux mondes complètement différents qui se rencontrent. Je voulais aussi confronter mon personnage au discours des années 1930 et à l’inconscient collectif autour de la colonisation, soutenu et déterminé par une propagande importante. Il y a une recherche d'affranchissement total : partir sur une île au milieu de l’océan pour apprendre une culture qui n'est pas du tout la leur. Et pourtant, la norme, la politique et l'histoire les rattrapent. Elles arrivent sur l’île, et la culture qu'elles ont complètement fantasmée est en train de mourir entre les mains de la colonisation. Autant d’obstacles ou de balises qui situent la petite histoire dans la grande.
C'est sûr qu'il s'est passé tellement de choses durant le XXe siècle, riche de beaucoup de crises et de questionnements, c'est très intéressant d'analyser cela. Puis surtout, c'est un roman qui parle d'émancipation. Mais comme tu viens de l'expliquer, ça ne peut jamais être une émancipation totale, même en partant à l'autre bout du monde. Même en pensant s'en être affranchi, en ayant une bourse de la famille, en ayant de belles conditions dans le pays d'accueil, il y a toujours quelque chose qui finit par vous rattraper, ou un idéal fantasmé qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Et qu'as-tu découvert d'autre au travers de l'écriture du roman ? Comment en es-tu venue à parler de Java, est-ce à travers des affinités personnelles, ou est-ce que ça t'est venu au fil de tes recherches ?
C'est un mélange de beaucoup de choses. J'ai été nourrie par ma mythologie familiale, qui m'a mise sur certaines pistes. Des événements, une personne que je ne voulais pas voir tomber dans l’oubli. Les trois fenêtres spatio-temporelles du roman viennent de là, d’une femme qui a plusieurs fois fait un pas de côté : en mer, à Java, pendant la guerre. J'avais envie d’explorer ces éléments-là et de les déployer dans la fiction. Je voulais une femme qui mène sa vie comme elle peut, pas toujours comme elle veut, mais qui essaie. C'est ce motif qui se répète, qui la définit : le départ, et le retour - qui prépare le départ suivant.
Dans
S’en aller
, tu te penches sur le passé et t'interroges sur comment une personne a pu vivre ces événements. Pour en revenir au présent, à ton avis, quel rôle la littérature contemporaine peut-elle jouer à notre époque, en lien avec les luttes sociales, écologiques etc. qu'il reste encore à mener ? Comment susciter la réflexion et l'engagement, au travers des écrits ?
C’est un rôle fondamental, je pense, et pas uniquement pour la littérature : le cinéma joue un rôle tout aussi important dans la construction de représentations différentes. La littérature, le cinéma, la musique, tout ce qui aide à concevoir des images mentales, des représentations de ce que peut être la norme, de ce qu’on veut pour soi, est important. Le langage structure la pensée, et à cet égard-là, je crois que la littérature et l’art en général, peuvent jouer un rôle dans les grands enjeux que traverse notre époque.
Ça me parle beaucoup que tu parles d'images, de créer un imaginaire collectif et de le propager le plus possible. Il me semble aussi que c'est une des pistes les plus envisageables.
Oui, c'est une manière infuse et efficace de faire passer un message. Dans des séries comme I may destroy you , ou même Sex Education , la narration est efficace, c'est drôle ou émouvant, on est pris par l'intrigue. Le message passe. Ce sont des séries qui déconstruisent et proposent autre chose, quelque chose d’attirant. De la même manière, Maggie Terry de Sarah Schulman, est terriblement efficace aussi. Sans rien sacrifier à l’intrigue, ni en faire le sujet central de l’histoire, l'autrice détricote l'hétéro-normativité habituelle et propose autre chose. Des rôles parfaitement fluides et crédibles, normaux en un mot, portés par des personnages gays, ou en proie à l’addiction ou au handicap. Elle les défait de l’extravagance qu’on leur associe habituellement, pour en faire quelque chose de simplement normal. Ça fait un bien fou.
Oui, comme tu le dis, c'est important de ne pas en faire le propos même d'un produit culturel, mais de simplement normaliser ça, sans même en parler directement. On propose juste un imaginaire ou une série d'images et le lecteur adhère à ce qu'on va lui proposer. Et pour finir, pour faire un lien avec la campagne Lisez-vous le belge ? , pourrais-tu nous recommander un produit culturel belge ?
Dernièrement j’ai beaucoup aimé La Fêlure , d'Emmanuel Regniez et le petit ouvrage Paysages possibles (impossibles) édité par Le Comptoir asbl, à Liège.