« Naître vierge au monde »

Au sein de la dense programmation du
Au sein de la dense programmation du
Festival Passa Porta 2017, nous souhaitions mettre en avant des textes qui nous avaient éblouis. Parmi eux,
le Garçon, roman initiatique gargantuesque qui – depuis 1908 sur les traces d’un adolescent soudain privé de mère jusqu’aux dommages de la Grande Guerre – plonge tête, cœur et corps dans ce que l’humanité a de plus tendre et de plus vil et se double d’une flamboyante déclaration d’amour à la langue.
Le soir venu, on les trouve tous deux assis de part et d’autre d’un petit feu de bivouac à manger des cailles rôties avec les doigts. Derrière le garçon stationne une roulotte sur les flancs de laquelle on peut voir écrit en lettres d’or tarabiscotées : Brabek, l’ogre des Carpates . L’or est défraîchi, de même que la roulotte. Le garçon n’a aucune idée de ce qu’est un ogre ni de ce que sont les Carpates et quoi qu’il en soit, il ne sait pas lire. L’homme a dû déchiffrer pour lui. C’est sous ce nom qu’il s’est présenté : Brabek. Il y avait une once d’orgueil dans sa voix lorsqu’il l’a prononcé. En réalité, il se nomme Ernest Bieule, mais la dernière à l’avoir appelé ainsi était une vieille femme à présent et depuis longtemps morte et enterrée. Cela fait partie des choses dont il préfère ne pas se souvenir. Que la postérité retienne seulement le nom qu’il s’est lui-même forgé et ce sera sa plus grande victoire. Ce sera la plus vaine et ce sera la plus belle.
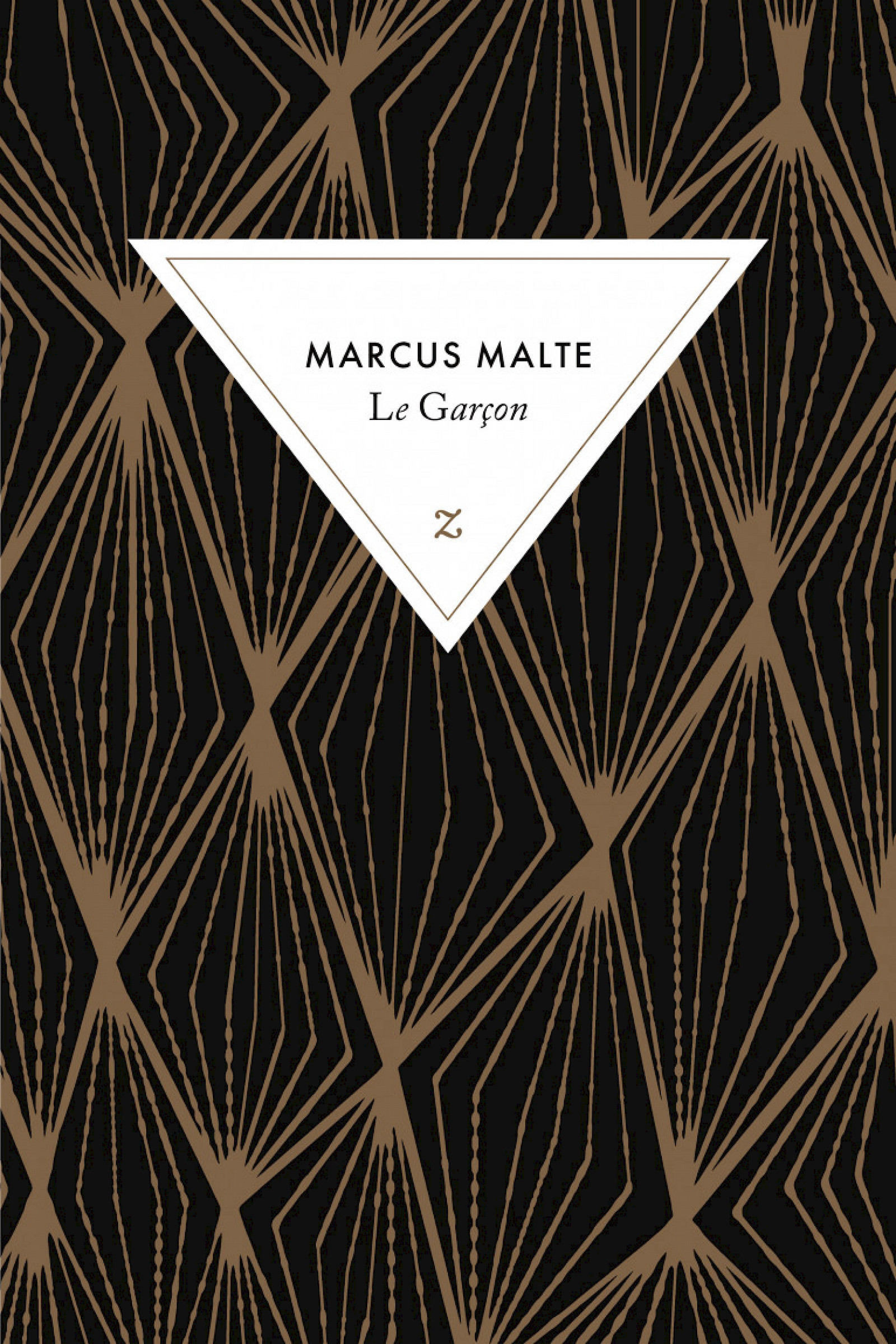
Vous avez obtenu le prix Fémina pour
le Garçon
. Ce prix a-t-il changé la façon dont vous considérez votre pratique ? Et le regard des lecteurs sur vous ?
Non, ce prix n’a rien changé de fondamental dans ma façon de concevoir l’écriture. C’est essentiellement un formidable coup de projecteur sur mon travail, qui permet à un public plus large de le découvrir. Je publie des livres depuis plus de vingt ans, et je m’aperçois que beaucoup de lecteurs ignoraient jusqu’à mon nom avant cette distinction (belle leçon d’humilité, au passage, s’il en était besoin).
Comment situez-vous votre corpus pour la jeunesse dans votre œuvre ?
Mes écrits pour la jeunesse font partie intégrante de mon « œuvre ». Je les aborde avec autant d’envie, de sérieux, de rigueur, d’exigence et de plaisir que le reste. La littérature est vaste et riche, et j’ai l’intention d’en explorer de nombreuses voies et méandres, sans restriction de genre ou d’âge supposé des lecteurs. L’art est peut-être le dernier espace où l’on peut encore franchir librement les frontières ‒ du moins, je l’espère et je fais comme si.
La musique constitue pour beaucoup de vos personnages (Mister et Bob, mais aussi Léna et Maria dans
Garden of Love
ou Emma et Gustave dans
le Garçon
) davantage encore qu’un fil rouge, un véritable carburant. Est-ce aussi votre cas lorsque vous êtes en phase d’écriture ?
« De la musique avant toute chose », a dit Verlaine, que je cite dans
le Garçon
. Entièrement d’accord avec ça. J’estime que je suis une sorte de musicien raté, et je fais de mon mieux pour que mes textes se rapprochent de compositions musicales. Tonalité, sonorité, rythme, silence : voilà mon point de départ et voilà mon principal souci lorsque j’écris. Le son d’abord, le sens ensuite. Le but étant, bien sûr, d’allier les deux pour en faire quelque chose qui soit le plus puissant possible. Chaque roman a sa propre tonalité, sa propre sonorité, et les artistes qui me nourrissent sont ceux dont les créations font alors écho au texte en cours.
Certains de vos livres ‒ comme
Il va revenir
‒ ont donné lieu à des fictions radiophoniques; d’autres, comme
les Harmoniques
, à des lectures musicales. Est-ce que cette potentielle mise en voix est un aspect auquel vous êtes attentif au moment de la rédaction?
Non. Encore une fois, je me soucie beaucoup du son, mais je ne pense pas du tout, au moment de la rédaction, à une éventuelle adaptation ou mise en voix. Je dirais que c’est plutôt le fait qu’il y ait cette approche musicale du texte, à la base, qui engendre, presque naturellement, l’envie de le décliner en pièce radio ou autre forme orale. Comme une sorte de prolongement évident. Cependant, chaque médium a ses spécificités et cela nécessite donc une adaptation du texte initial.
Les premières indications que nous avons sur
le Garçon
, c’est qu’il n’a pas de nom et qu’il ne laissera aucune trace hormis le texte. Construire votre roman à partir d’un protagoniste à ce point « page blanche » et de surcroît mutique, était-ce aussi une façon pour vous de tester de nouvelles zones narratives, d’être comme lui en apprentissage au fil des pages ?
C’est sans doute mon côté démiurge qui ressort : je suis celui qui va créer ce personnage, qui va lui donner vie et décider de son sort. Sans moi, il n’existe pas… D’un autre côté, symboliquement, métaphoriquement, le garçon peut représenter tout être humain, qui naît vierge et dont toute l’histoire est à inventer. Il est assez enivrant de disposer d’une page blanche et d’avoir, par conséquent tout à écrire. Le champ des possibles, au départ, semble infini. Je ne sais pas moi-même où cela va nous conduire, et j’aime cette idée de partir à l’aventure, sans chemin tracé d’avance, sans destination précise, sans filets aussi.

Votre roman est rythmé en années, mais votre personnage principal évolue au départ dans un véritable hors temps, une ruralité quasi médiévale. Avez-vous inséré les intermèdes anaphoriques « Cette année-là » pour nous montrer que loin des alcôves où ce garçon évolue (forêt, village, roulotte, chambre d’Emma), le reste du monde est dans une quête effrénée de progrès ?
Tout au long du roman, nous suivons le garçon de très près, en plan rapproché. Il me semblait important, de temps en temps, d’élargir ce plan, d’en faire un plan d’ensemble. Car le garçon, comme tout le monde, est aussi le produit de la société dans laquelle il évolue. Je voulais donner un aperçu du contexte historique et social de l’époque. J’ai choisi d’en donner quelques éléments, certains assez connus, d’autres moins, parce qu’ils me paraissaient intéressants à divers titres, notamment en effet parce qu’ils rendaient compte de l’évolution des événements, des mœurs, des pensées, des techniques, des valeurs. Et selon le point de vue, on peut appeler ça du « progrès » ou bien une « régression ».
Aviez-vous à l’esprit
les Nuits d’une demoiselle
de Colette Renard lorsque que vous avez construit la foisonnante et sensuelle scène du « sexique » entre Emma et Félix ?
Je n’ai pas pensé particulièrement à la chanson de Colette Renard pour cette scène. Je voulais surtout montrer l’aspect joyeux, foisonnant et libre de la relation entre Emma et le garçon. Que leur amour pétille ! Qu’ils s’aiment et s’amusent en même temps ! Je voulais associer, comme eux, le plaisir des sens et le plaisir des mots. Un jaillissement de foutre et de verbe !
J’ai également été marquée par la visite des deux amants dans la librairie de Chadenat et par le portrait quasi-monstrueux du tenancier du lieu… Quelle a été votre inspiration pour ce passage?
Pour la scène de la librairie, le point de départ m’a été inspiré par un texte de Blaise Cendrars (je crois que c’est dans
Bourlinguer
) où il parle de ce monsieur Chadenat, qui a vraiment existé et qu’il appelait : « le roi des libraires ».
Vos livres sont peuplés de personnages en proie à des fêlures, mais lorsqu’ils tuent, il s’agit souvent de règlements de compte personnels. Ici, nous sommes confrontés à une machine à tuer à échelle multipliée, dont vous rendez compte à travers des portraits d’anonymes que vous rendez tangibles (comme ce chanteur d’opéra devenu fou au combat).
Je crois qu’il ne faut pas perdre de vue que la guerre, c’est ça : des hommes qui meurent. Derrière les chiffres, derrière les statistiques, derrière les cartes et les rapports, il y a avant tout des êtres humains, des individus, qui souffrent terriblement et qui meurent lamentablement. Si je décide d’essayer de rendre compte de ce type d’événement, alors je m’efforce de rester à hauteur de ces hommes. Je voudrais faire ressentir, vraiment, ce qu’ils endurent dans leur chair et dans leur âme. Mon propre état d’esprit oscille entre l’incompréhension, le dégoût, la colère face à un tel gâchis, un tel mépris de la vie humaine. D’autant que la plupart du temps, ceux qui déclarent ces guerres, ceux qui poussent au crime, se gardent bien d’y aller eux-mêmes. À mes yeux, chaque homme compte, chaque vie compte, chaque mort compte.
