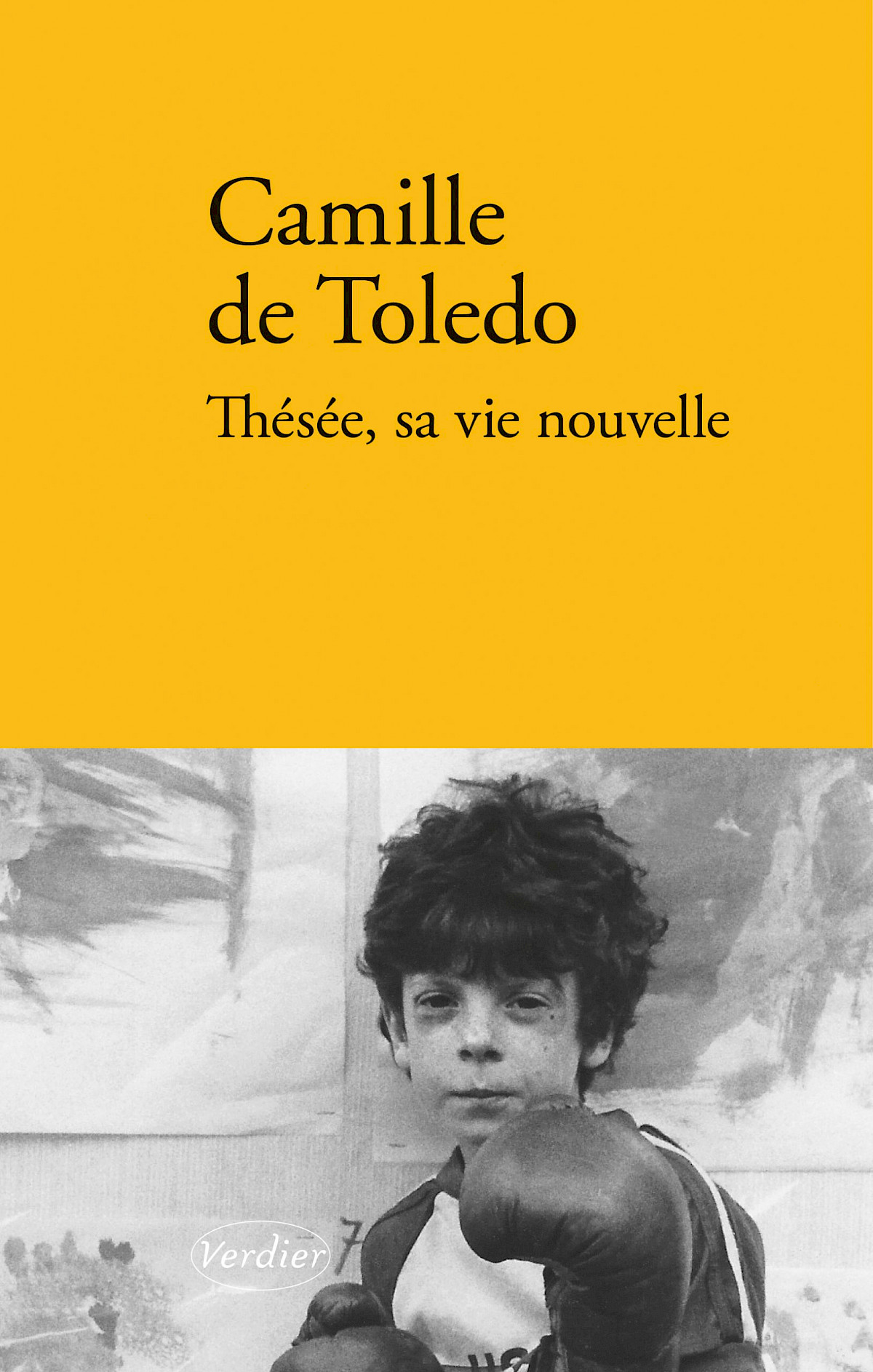
Avec Thésée, sa vie nouvelle , Camille de Toledo signe un livre essentiel où l’urgence de vivre tente de se frayer un chemin à travers les fictions et les rêves brisés des générations passées. Défiant toute catégorisation, cette quête du réel à travers le déni et le sacré fait la part belle à une écriture qui touche par sa brutalité et sa dimension cathartique.
Du poème en prose ouvrant le nouveau roman de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle , une question jaillit, nous heurte presque, nous marque sûrement : « Qui commet le meurtre d’un homme qui se tue ? » L’homme qui se tue, c’est le frère de Thésée ; Thésée, c’est celui qui pose la question fatidique. Après être resté seul avec ses souvenirs et les fantômes de sa famille, Thésée décide de fuir, avec ses enfants, cette « ville de l’ouest » pour cette ville-labyrinthe plus à l’est, où se perdre et perdre les traces de son passé, perdre ce lien qui faisait de lui un fils, un frère. Seuls trois cartons qu’il s’obstine à garder scellés, remplis de souvenirs, sont emportés dans ce déménagement furtif. Ce sont les affres de l’agonie de ce frère-qui-survit qui l’obligeront bientôt à les ouvrir et à élucider cette énigme du frère-qui-se-tue.
Thésée, sa vie nouvelle est une sorte de saga familiale, mais en plus intime ; une quête de la rédemption du corps et de l’âme, des corps et des âmes de toutes les générations passées. Reliées par un fil et dans une perspective très déterministe, elles semblent toutes avoir été condamnées par un même événement survenu un siècle auparavant, quand la « lignée des hommes qui meurent » a vu le jour et a mené au suicide de Jérôme, frère de Thésée. Ainsi, entre petite et grande histoire, toute la narration paraît n’offrir aucune échappatoire au lecteur. Comme un memento mori à l’envers – et non un memento vivere – , l’inéluctabilité de cette lignée immuable exprime un rappel incessant de l’insoutenable réalité d’être en vie, de vivre enfermé dans ce « corps-mémoire » soumis à des lois temporelles inatteignables, dans lequel l’esprit lutte pour ne pas savoir . Le corps de l’homme devient un espace où passé et présent ne font plus qu’un ; il se fait le témoin des traces du passé, des erreurs des générations antérieures. L’individu alors réduit à endurer les souffrances de ce corps qui, lui, sait, finit par partager le nom et la tâche d’un héros mythologique voué à résoudre le conflit des générations face à un Minotaure, synonyme de secrets et d’énigmes. Et la dimension my(s)thique ne s’arrête pas là. Les « synchronies », ces coïncidences de dates se répétant à travers les générations au fil du récit, viennent créer ces « lapsus du temps », ces moments durant lesquels « le passé se mêle à l’avenir, où le contour assuré des corps se trouble devant tout ce qui relie les noms entre les âges ». Ainsi, d’emblée, l’auteur dote son histoire d’une toile de fond dans laquelle le flux du temps est brisé, nous invitant à percevoir les choses dans une perspective temporelle non-linéaire. Une même date fait écho à des événements identiques à travers le temps, le corps perçoit une peur généalogique, une angoisse venant d’un passé que l’esprit ne veut pas voir, savoir .
Mais voir, est-ce savoir ? Sans répondre à cette question à l’origine de maintes et maintes réflexions, il est évident que le noble sens de la vue joue un rôle central dans l’élaboration d’une forme de savoir chez le personnage principal et dans la relation qu’il entretient avec le texte. En parsemant d’images son récit, Camille de Toledo fait le choix original d’inclure dans son œuvre – en plus, des différents caractères graphiques de son texte, nous y reviendrons – de la matière visuelle. Loin des récits photographiques de Plissart (tels que Fugues ou Droit de regards , pour n’en citer que deux) où l’image constitue la majorité de la narration, les photos, ici, apportent une nouvelle dimension à l’histoire, viennent la ponctuer en jouant avec le sensible. Grâce à ces représentations, l’écrivain laisse tout d’abord au lecteur une part de liberté dans la construction de sa perception du récit. Les images apparaissent d’ailleurs dans le texte avant que le narrateur n’en fasse directement mention, comme s’il ne pouvait les regarder. Les photos venant prolonger la narration, il laisse libre le lecteur de les interpréter. Par après, les références constantes à la recherche d’images manquantes par Thésée – « et il manque une image, je la chercherai longtemps ; celle du frère pendu » – confirme la nécessité de voir pour comprendre, pour accepter. Contrebalancée par l’aveuglement collant à la peau de ses ancêtres, il confirme le lien étroit existant entre les deux notions et, par la même occasion, rappelle la cruelle réalité des survivants à qui le refuge de l’aveuglement est refusé. Ce n’est que lorsque son corps tiraillé par la douleur le force à sortir de son déni que Thésée ouvre les boîtes en carton qu’il a emmenées avec lui et accepte de porter son regard sur les photos le contenant. Ces images, ces traces du célèbre ça-a-été de Barthes, sont autant d’éléments lui servant de preuves pour déconstruire le réel et le comprendre. La matière photographique s’éloigne alors tout à coup de son rôle de prolongement du texte et se fait support d’un texte en « je » où Thésée prend la parole. De cette relation d’interdépendance se dégage l’élaboration du savoir par Thésée, l’esquisse de l’acceptation, de la sortie du déni dans lequel il s’était enfermé. Il dira « pour moi qui vous regarde, les possibles se sont refermés ; je sais à quoi ressemble le frère (…) ; je sais qu’il est né, puis s’est tué trente-trois ans plus tard », se positionnant ainsi comme celui qui connait le futur et ce faisant acceptant que « les possibles » ne sont plus ; qu’il est celui qui voit et qui sait . De cette évolution du traitement de la matière photographique et de la relation du narrateur avec celle-ci se dégage donc le processus de connaissance élaboré par Thésée.
Comme mentionné précédemment, les rapports existants entre les images et le texte changent au fil du récit. Si les premières images ne sont pas citées telles quelles dans le texte, il en va autrement pour le reste des photos longuement commentées par Thésée, comme un album de famille auquel le lecteur aurait accès. Ceci fait écho au rapport que ce dernier entretient avec le texte. Le narrateur, qui revêtira tantôt la place d’un narrateur externe et omniscient, tantôt le rôle de Thésée, place le lecteur face à une pluralité des voix narratives, le perdant ainsi dans un récit polyphonique dans lequel l’appartenance des voix n’est pas identifiable à travers des indices clairs – comme c’est le cas chez Faulkner, par exemple – mais se juxtaposent. À propos du présent, le narrateur nous dit : « Le présent est un livre palimpseste. » Presque une mise en abyme, dès lors, pour cet auteur dont l’œuvre semble avoir été superposée, au propre comme au figuré, sur un « texte primitif » et qui, à travers son intertextualité – factice ou non –, force sans cesse le lecteur à chercher « le texte qui se cache en dessous », à revoir sa relation au texte.
Ainsi, alors qu’images, narrateur omniscient et Thésée se disputent la page à coup d’italiques et d’incursions, le journal intime de l’arrière-grand-père de Thésée, Talmaï, qui révélera au protagoniste principal l’un des grands secrets de son histoire familiale, vient s’ajouter à notre vue. Et quel plaisir pour nos yeux que d’avoir accès non seulement au texte du manuscrit mais également à des photos de ses pages originales. Une fois encore, passé et présent se retrouvent et tentent de faire résonner leurs voix sur la page. En parallèle de ce manuscrit, les références à Thésée se font à la troisième personne par un narrateur externe omniscient. Thésée, lui, n’a pas encore ouvert le manuscrit et ne prend alors la parole qu’à travers quelques incursions en totale asynchronie avec le reste du texte. Dans une langue juste et déchirante, il révèle sa souffrance dans un autre présent, dans une autre réalité parallèle. Mais cette polyphonie asynchrone, véritable expression des non-dits, des vérités enfouies, s’amenuise au fil du récit. Ce n’est qu’à travers le processus d’acceptation du voir , et par conséquent du savoir , par Thésée que le narrateur basculera progressivement dans les bras de ce « je » conscient et synchronique. Et alors que les réels semblent s’aligner, l’écho de la voix du narrateur ressemble de plus en plus à celle de Thésée. Ainsi, à travers le flux de la pensée, le texte retranscrit, la poésie en prose, la poésie visuelle ou encore l’absence de majuscules, les italiques, le regard du lecteur cherche à tâtons son chemin et comprend la nécessité de toujours être porté au-delà du sens des mots pour comprendre. L’œil navigue ainsi à travers les pages du récit à la recherche du « texte sous le texte », de l’asynchronie. Avec Thésée, il s’attèle à reconstruire le(s) passé(s) pour comprendre le présent et la signification de ce qu’il a sous les yeux se dessine petit à petit.
Ce n’est que très tard dans le récit que le roman deviendra autobiographie. Le voyage terminé, Camille de Toledo apparait sous les traits de Thésée. C’est le processus même de l’écriture qui lui a donné accès à la parole. Les indices de l’histoire étaient pourtant flagrants : les références à cet art de la plume ne sont-elles pas multiples ? Son frère Jérôme ne porte-t-il pas le nom de ce saint traducteur ? Cet ancêtre n’a-t-il pas trouvé comme refuge à son chagrin l’écriture ? Cette mère n’était-elle pas journaliste ? L’écriture n’est-elle pas la clé de tout ? Au fil des pages, c’est en aiguisant la précision de ses mots et en reprenant d’abord son rôle de narrateur en « je » à travers Thésée et puis son nom, que l’auteur parvient à se défaire de cette carcasse immobilisante. Acérée et toujours très juste, son écriture désillusionne et déconstruit les mensonges et les faux-semblants de ses ancêtres. De ce passé idyllique et romancé, il en fait une réalité froide et grise, mais réelle. Chez de Toledo, l’écriture finit par défictionnaliser ce théâtre mis sur pied depuis des générations, ces Trente Glorieuses aux couleurs pastel ; par désacraliser ces coïncidences en leur ôtant toute aura. Lui, le moderne, réapparait défait de cette cape de héros grec, de ce corps-mémoire, de ce passé, maintenant liquéfié sur la page et prêt à être lu à travers ces mots venant du présent, sans artifices, sans théâtralité. Plus que dans « la lignée des hommes qui meurent », Camille de Toledo s’inscrit dans la lignée de ces grands hommes qui mettent de l’ordre dans le réel avec leurs paroles, qui font de leur écriture la nécessité de vivre.