Des nouvelles de la ville universelle
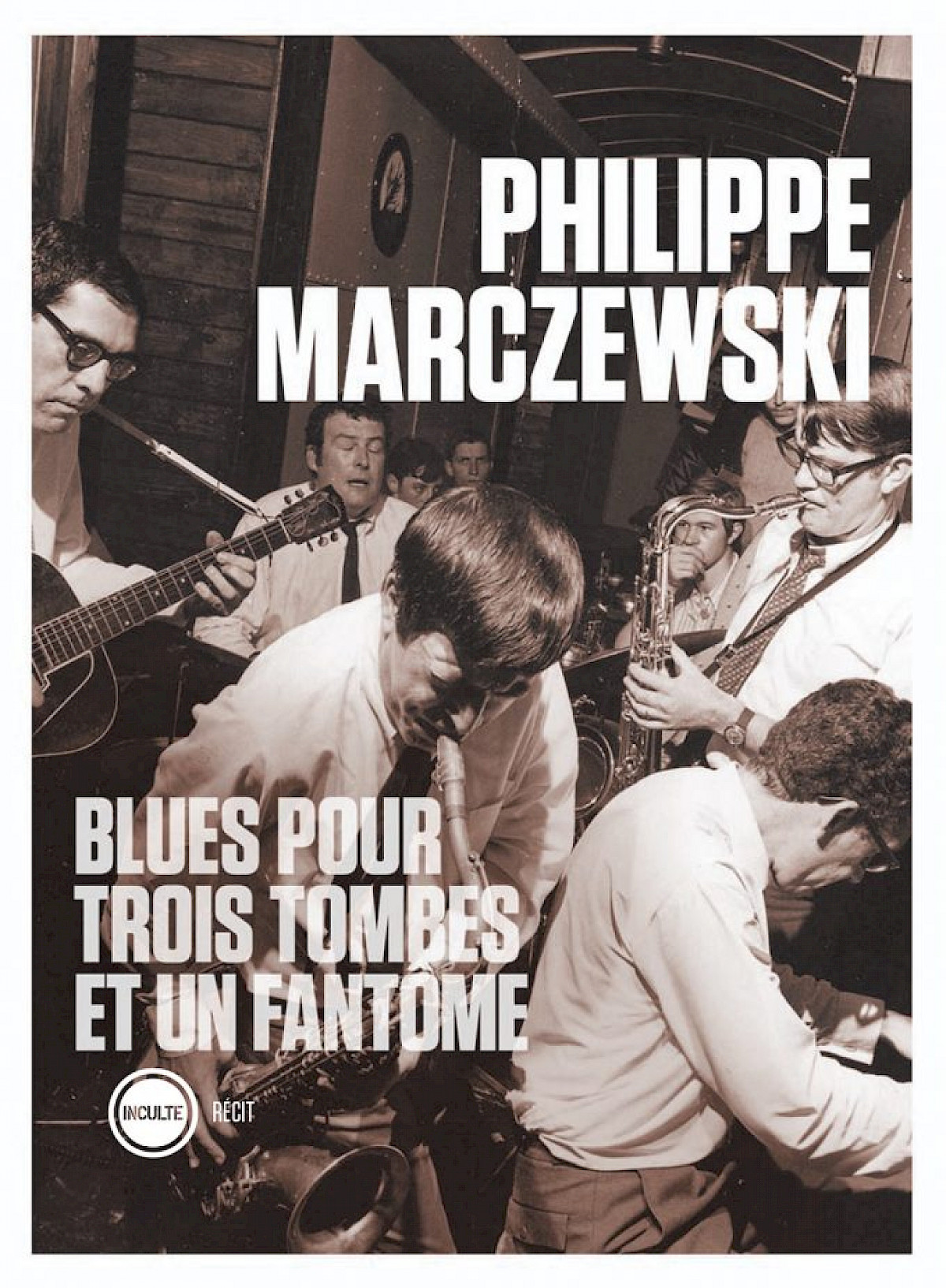
Dans Blues pour trois tombes et un fantôme , on lit de Liège à la fois tout le mal et tout le bien que l’on en pense. C’est une réjouissante lecture cathartique autant qu’une plongée sensible dans les plis d’un paysage, que celui-ci soit ou pas familier au lecteur.
On pourrait platement dire, si l’on voulait prestement vendre ce livre à des amis, que Blues pour trois tombes et un fantôme est un livre sur Liège écrit par un Liégeois. Mais Blues... est d’abord un livre sur toutes les villes du monde, surtout celles qui n’existent qu’en esprit. C’est aussi un très beau livre écrit par quelqu’un qui a longuement étudié la ville avec ses pieds. Il est connu que la marche stimule le cerveau, et c’est ce même frétillement neuronal que provoque l’écriture de Philippe Marczewski, aussi fluide qu’un pas devant l’autre ou que la Meuse qui s’écoule sans discontinuer, d’un naturel désemparant. Il faut se faire violence pour s’extraire du flux des mots afin de considérer de plus près la richesse des phrases, l’agilité de la syntaxe : Blues... appartient à cette catégorie de livres dont je n’ai pas recopié une seule formule, de peur d’en recopier la totalité si seulement je commençais – en bon moine copiste « devenu assez idiot pour ne plus même penser au salut de son âme mais vivant sa tâche de copieur dans l’absurdité mystique de chaque instant1 ».
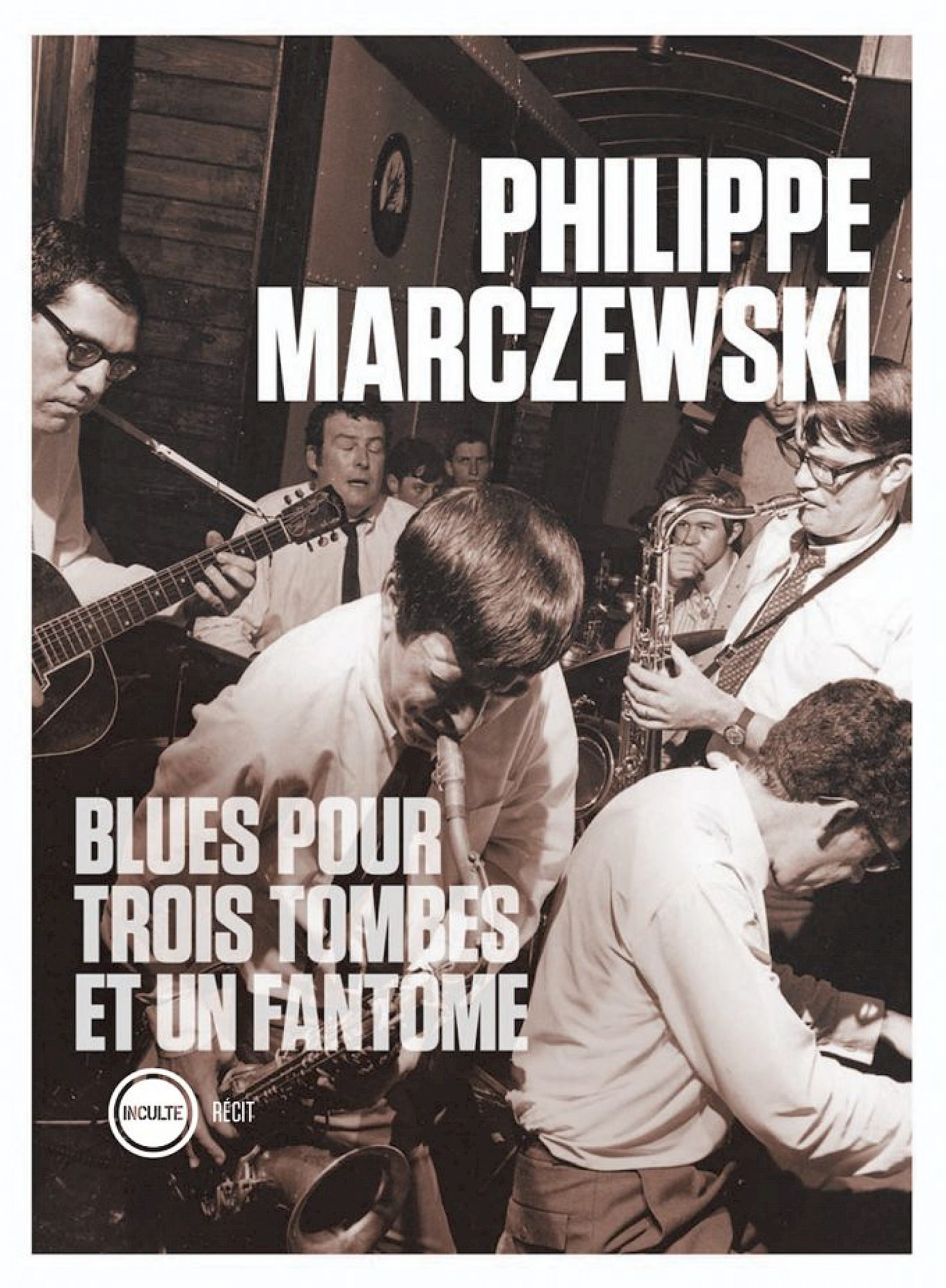
Si la Meuse jamais ne cessera de couler, il est dit qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve : la ville, comme la Meuse qui lui offre son souffle, est en perpétuel changement. Ce mouvement incessant est véhiculé tant par le dispositif qui sous-tend le livre et lui prête son rythme, la marche, que par une ingénieuse narration évoquant le Ici de Richard McGuire2 : Blues… construit le récit d’un lieu à différentes époques, superposant les couches de temps en gardant le verbe au présent. Grâce à cette manœuvre, tout (re)prend vie : les musiciens de jazz, les copains, les buveurs au café du coin, les ouvriers polonais et italiens, voire même les forêts médiévales emplies de loups et de sorcières. Le point de vue, fixe et pourtant mouvant, est foncièrement celui d’un marcheur : il s’agit de partager une vision de la ville et un rapport d’attention aux choses qui nous entourent (de près comme de loin) en même temps qu’une mythologie personnelle tirée de cette ville qui a vu grandir l’auteur. Dans ce livre, Liège apparaît polymorphe et plurielle, tantôt monstre des marécages dont il faudrait escalader l’échine pour espérer saisir du regard l’étendue de la cité, son histoire et sa géographie tourmentées, tantôt serpent fantastique lové sous les pavés, gardien et guide de la ville ondoyante, Virgile d’écailles pour un Dante en chaussures de randonnée. Car Liège est semblable à une personne, elle grouille de vie comme de mort dans un cycle continu de rouages qui s’enchaînent, changeant sa surface et ses habitants, ses voyageurs passagers et ses gisants. Tour à tour laide et sensuelle, cruelle et protectrice, revancharde et flegmatique, la ville égrène ses mille visages tout au long d’un récit découpé en quartiers. Philippe Marczewski l’épluche comme une orange, avec douceur et bienveillance, sans pour autant se départir d’un humour cinglant, qui pique le récit d’éclats de vérité élégamment formulés.
L’ouvrage réveille au passage l’histoire de Liège en dépassant, de loin, le cours ex cathedra chauvin ou le florilège d’anecdotes : c’est l’histoire de ceux dont le corps s’inscrit en creux dans les plis du paysage qui s’écrit entre ces pages. Blues… est parcouru de spectres au présent, transpercé de la poésie des grands noms qui ont sillonné la ville et y ont trouvé, si pas toujours l’inspiration, au moins une forme de réconfort familier : entre autres, Jacques Izoard, le poète-père ; Eugène Savitzkaya, qui a tatoué la ville de ses mots ; ou encore Chet Baker, Jacques Pelzer et René Thomas, dont les notes ricochent encore entre les murs des impasses les jours de pluie. Mais les grands noms voisinent ceux des oubliés, des anonymes, de la foule, des métiers en voie d’extinction et des arbres sauvages – pas ceux que l’on contraint, coupe, cisaille, enferme derrière des grillages et entre trois places de parking ; un très bel éloge leur est d’ailleurs adressé dans le morceau intitulé « Retour au bois des cochons », c’est là notamment que se cristallise toute la capacité d’attention et la valeur poétique de cet arpentage du sensible.
Que l’on construise ou que l’on détaille avec l’auteur l’image de la ville, il n’est certainement pas nécessaire d’être Liégeois pour jouir de cette déambulation à la chronologie personnelle, semblant suivre le flux d’une pensée qui se formule au gré des associations visuelles rencontrées sur son chemin. L’image finale restera flottante, car il en existe autant qu’il y a d’individus pour la concevoir. Ceux qui aiment Liège comme ceux qui ne peuvent la sentir (ce sont souvent les mêmes) prendront un égal plaisir à arpenter les lieux connus, ceux dont ils ont entendu parler, ceux qu’ils ne situent pas ou plus, ceux, enfin, dont ils ignoraient l’existence : à leur endroit se trouvait un trou béant sur la carte mentale, un trou qui se comble au fil des pages et des enjambées, de la poésie de la langue et des rencontres inattendues que recèlent les murs de cette ville rendue universelle.